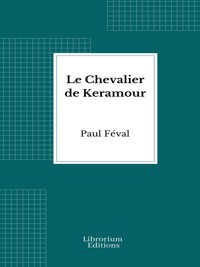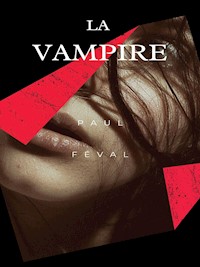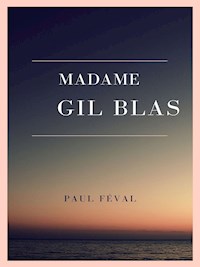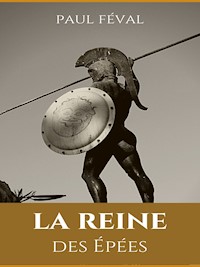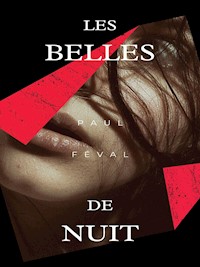3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Les Compagnons du Silence
- Sprache: Französisch
Au tout début du XIXe siècle, le comte Mario de Monteleone, cousin de Ferdinand, roi de Naples, mène en secret le combat contre les Français. En secret : tout est là. Les conjurés n'ont pas d'armes, mais ils possèdent le sentiment de leur bon droit et savent pouvoir compter sur l'allié le plus sûr : le silence.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Les Compagnons du Silence
Paul FévalLes Compagnons du SilencePremière partieDeuxième partiePage de copyrightPaul Féval
Les Compagnons du Silence
Le roman est ici présenté en deux tomes.
Les Compagnons du Silence
I
Prologue
Les sept anneaux de fer
I
Le Martorello
C’était autrefois un paradis terrestre. Pythagore, fils de ces contrées heureuses, les appelait le jardin du monde. C’était la grande Grèce, baignée par trois mers : la Daunie, où naquit Horace ; la Lucanie, où Annibal porta ce coup terrible à la puissance romaine, la bataille de Cannes ; c’était aussi l’Apulie et la Campanie, où le même Annibal s’endormit délicieusement sur son lit de roses et de lauriers. Depuis Parthénope jusqu’à Sybaris, depuis Solmone, patrie d’Ovide, jusqu’à Drepanum, tout au bout de la Sicile, Cérès favorable épargnait à l’homme le travail des champs. Fleurs et fruits venaient sans culture. Maintenant, cela s’appelle le royaume de Naples ou des Deux-Siciles. En cherchant bien, Annibal y trouverait de quoi refaire ses délices de Capoue. Mais Cérès, détrônée, ne protège plus la mollesse de ces peuples.
Il y a eu comme un grand châtiment. Cette luxuriante écorce qui recouvrait la terre des Calabres s’est violemment déchirée, un vent de ruine a soufflé, laissant çà et là dans la campagne désolée d’adorables oasis, comme pour faire regretter mieux aux fils déshérités des heureux les splendeurs de l’Éden perdu. Ainsi, quand le fléau de la guerre a passé sur une cité illustre, quelques colonnes restent debout, échappées à la stupide massue du Cyclope ; et ces débris de bronze ou de marbre suffisent à la pensée pour reconstruire le passé glorieux.
On dit qu’un soir d’hiver, en l’année 1783, la terre se prit à rendre des sons profonds et inouïs ; un voile de sang couvrit le ciel, et ces mers sereines qui baignent les golfes de l’Italie méridionale eurent comme un long frémissement. La terre trembla treize fois entre le coucher et le lever du soleil. Dans la nuit noire, l’Etna et le Vésuve flambaient comme deux sinistres phares se regardant à travers l’espace. Le lendemain, la mer Thyrrhénienne, la mer Ionienne et l’Adriatique, étaient couvertes de débris. Vous eussiez dit qu’une trombe immense, partie des plateaux de l’Abruzze, avait passé sur l’Italie, déracinant les villes et les forêts. Les Calabres, le pays d’Otrante, la Basilicate et la principauté citérieure, étaient bouleversés de fond en comble. Le citadin, qui croyait faire un rêve hideux, cherchait sa ville natale et ne la trouvait plus. Le villageois essayait en vain de reconnaître le champ qu’il avait ensemencé la veille. Les futaies centenaires étaient couchées et terrassées comme les frêles tiges du blé sur lesquelles a passé l’ouragan. Du sol éventré jaillissaient d’étranges vapeurs, les rivières avaient changé de lit ; des cités entières avaient disparu, dont il ne reste que le nom.
Ces peuples fainéants sont faciles à dompter ; ce fut après cela, des deux côtés de l’Apennin, un découragement lugubre. Le laboureur se coucha sur la lisière de son champ ravagé. Les prêtres vinrent et prêchèrent la croisade du travail. Un instant on vit, ce qui est un miracle, des Italiens pris par la fièvre laborieuse. Mais la charrue traçait à peine les nouveaux sillons, mais à peine la pierre équarrie marquait à quelques pieds du sol l’enceinte de la maison reconstruite, que la montagne lança une seconde fois son cri de détresse. La mer, chose inouïe, éleva tout à coup son niveau de vingt-quatre pieds, et couvrit les plaines qui n’avaient jamais senti le vent du large.
Il y avait un prince qui gouvernait la ville de Scylla, en face de Charybde, sur la côte sicilienne. Il quitta son palais et monta, ainsi que toute sa cour, sur ses vaisseaux. Mais, de même que le voyageur, si l’on en croit la poésie antique, ne pouvait fuir jadis, dans cette passe redoutable, la mort qui était à droite comme à gauche, de même que cette Scylla évitée renvoyait ses victimes à Charybde, de même la terre et la mer, toutes deux ennemies, s’unissaient aujourd’hui contre l’homme condamné. Le palais fut détruit ; la flotte fut broyée ; le prince périt avec quinze cents de ses sujets. Et, à dater de ce jour, bien que la Méditerranée fût rentrée dans les profondeurs de son lit, la terre d’Italie, épileptique et délabrée, eut périodiquement ses attaques de haut mal. Trois mille secousses eurent lieu pendant les quatre années qui suivirent, C’est plus de deux secousses par vingt-quatre heures. Il se forma des lacs sans fond à la place où avaient été les villes. Non loin d’Oppido, se voit un trou rond qui semble produit par un prodigieux boulet lancé du ciel. Autour des lèvres du gouffre, la terre est crevassée en étoile comme ces vitres qu’une balle a percées.
L’Apennin est fort. Il résista longtemps. Mais enfin les couches stratiformes glissèrent par larges places et, décharnant tout à coup le colosse, laissèrent voir le granit sombre de ses ossements. Au bout de quatre années, cette pauvre belle terre, épuisée et vaincue, tomba dans le sommeil ; elle dormira longtemps. Un demi-siècle écoulé n’a pas fait disparaître les cicatrices gigantesques de ces blessures.
La partie méridionale de la baie de Santa-Eufemia, située dans la Calabre ultérieure deuxième, en face des îles d’Éole, forme une belle grève semi-circulaire dont la courbe, vue de la pleine mer, rappelle exactement l’idée de l’amphithéâtre antique. Il y a là quelques cabanes de pêcheurs, grises comme le roc qui les abrite. Le matin, sur l’azur foncé de la mer, on voit se détacher la voilure latine d’une demi-douzaine de barques. La longue antenne sous-tend la toile triangulaire, et vous diriez de loin l’envergure allongée d’un de ces grands oiseaux du large. Parfois le paquebot à vapeur qui fait le service de Naples à Palerme, passe et rejette en arrière sa longue chevelure de fumée.
De la plage, où le sable d’or se mélange à une poussière brune qui ressemble à de la lave pulvérisée, on aperçoit, quand le ciel est clair, une tache sombre au milieu de la mer Tyrrhénienne : c’est Stromboli, la plus septentrionale des îles Lipari, où le fameux brigand Fra-Diavolo se cacha, dit-on, pendant près d’une année. Du côté du midi, la vue est bornée par le cap Vatican. Au nord, ce sont les hauteurs du Pizzo, où Murat fut exécuté au mois d’octobre 1815. Le paysage est beau, mais il parle de solitude et de tristesse. On éprouve là quelque chose du sentiment qui vous serre le coeur en parcourant des ruines. Et pourtant il n’y a point de ruines. Le cirque de sable arrondit sa courbe immense. Çà et là quelque fille au pas hardi, au galbe antique, descend, la cruche sur l’épaule, le sentier qui monte en terre ferme. Le chant fatigué des pêcheurs étendant leurs filets sur la plage, arrive, et quelquefois, par le calme, une felouque carguant ses voiles pour border ses avirons, envoie au rivage la chanson rythmée des rameurs siciliens. Le soir, s’il vente frais, une tartane effilée bondit tout à coup sur les courtes lames et attaque la côte avec une témérité folle. La nuit tombe. Là-bas, du côté du cap Vatican, où sont les douaniers, on entend des coups de carabine. La tartane retourne à Lipari. La contrebande est à terre.
Vers le centre de la courbe, la Brentola, qui prend sa source au-dessus de Monteleone, débouche sur les sables et va éparpillant son cours en des milliers de minces filets d’eau. C’était sur la Brentola que travaillaient autrefois, avant la restauration de 1815, les chevaliers forgerons (cavalieri ferraï) du Martorello.
Il n’y a pas de ruines visibles le long de cette grève, mais il y a des souvenirs. Le Martorello est une vallée assez vaste qui arrive de biais sur la plage par un court défilé, où la Brentola coupe la petite chaîne des rochers. Des grèves, on n’aperçoit le Martorello que si l’on est placé juste en face du détroit.
Une guérite de douaniers, bâtie en quartiers de rocs, s’élève sur la falaise qui est en dedans. L’autre angle est recouvert de terre végétale. Quelques figuiers nains, des myrtes et des citronniers sauvages y forment un petit bouquet que surmontent deux grands troncs de chênes verts. Ce bouquet est connu sur la côte et sert de point de relèvement aux marins.
Une route charretière, défoncée en maints endroits, passe entre la rive gauche de la Brentola et le roc où est située la guérite. Elle tourne brusquement, comme la rivière elle-même, et s’enfonce dans la vallée au milieu de terrains vierges où poussent, dans les bas-fonds, le riz clairsemé, et, au sommet des plis, la moutarde odorante. À cinq cents pas du défilé, on trouve plusieurs traces de barrage, les deux piles d’un pont de bois dont le tablier a disparu, et quelques décombres envasés dans une sorte de marais.
La rivière ici a fait des siennes, achevant et dissimulant à la fois des ravages qui furent l’oeuvre de l’homme. Grossie par le barrage, elle a pris possession du lieu où fut jadis la plus belle forge des Calabres et peut-être de l’Italie. Ce marais, c’est l’emplacement même des bâtiments qui furent détruits et mis au ras du sol à l’époque des désastres de 1815.
Près de cent familles furent dispersées et transportées, les unes en Sicile, dans le Val-de-Demona, les autres dans les principautés. Les logis de ces familles, construits en bois, pour la plupart, avaient été brûlés.
Point de ruines encore pour témoigner de cette destruction, car les assises de pierre de ces humbles demeures étaient enfouies depuis longtemps dans les ronces et dans les hautes herbes. La population nouvelle, composée de montagnards pris au versant nord-est des Apennins, savait à peine l’histoire des anciens habitants du pays. Elle avait déserté les environs de la forge, envahis par les eaux. Ce qu’on appelait le village, un groupe de quinze à vingt cabanes, était situé beaucoup plus au sud, au-delà de la route qui mène de Monteleone à Messine. Il n’y avait là qu’une seule masure, faite de bois et de débris de marbre, occupée par une vieille femme de près de cent ans. On disait dans le pays que les esprits hantaient ces ruines cachées sous l’herbe. On avait entendu, bien que la vieille Berta eût perdu tous ses enfants depuis des années et qu’elle demeurât seule dans sa pauvre cabane, collée au revers de la falaise, on avait entendu des chants sortir de sa porte entrouverte. Et souvent une lueur courait le long de la rivière au milieu de la nuit, tandis qu’une voix brisée appelait un nom que nul n’avait pu distinguer... Ce qui est certain, c’est que les eaux, gagnant toujours de proche en proche, avaient détrempé au loin cette terre, fendillée et comme gercée par les secousses volcaniques.
Ce marais nouveau, et dont les fermentations s’opéraient à de grandes profondeurs, couvait la malaria, malgré le voisinage des côtes. La malaria, dont le foyer était probablement aux ruines mêmes de la forge, s’étendait au loin et désolait tout le pays. Le dimanche, quand les cloches du couvent del Corpo-Santo annonçaient l’office du matin, c’était une procession de fantômes qui gravissait la colline.
À un mille napolitain des marais de Martorello, tout au fond de la vallée qui court presque parallèlement au rivage, derrière l’abri de la falaise, on trouve la route de poste allant de Monteleone au petit port de Tropea, puis à Nicotera et à Palmi. Tropea est une station de bateaux à vapeur entre Naples et la Sicile. À l’endroit où la route passe à Brentola sur un petit pont de pierre, s’élève une maison carrée, solidement bâtie et qui paraît âgée de cinquante ans pour le moins. Une inscription peinte en lisibles caractères au-dessus de la maîtresse porte, annonce aux voyageurs qu’ils sont en face de l’auberge du Corps-Saint, l’osteria delle Corpo-Santo. À quelques pas de l’auberge, la route, la vallée et la rivière font un coude brusque pour prendre une direction perpendiculaire au rivage. La rivière, la vallée et la route se détournent ainsi pour côtoyer une montée rocheuse et fort abrupte, au sommet de laquelle se dresse le majestueux couvent du Corpo-Santo, qui a donné son nom à l’humble osteria.
Le 15 octobre 1823, Battista Giubbetti, véturin de Monteleone, revenait du petit port de Palmi, menant quatre voyageurs dans sa carrozza toute neuve ; trois dans l’intérieur, un dans le cabriolet servant de siège. Sa voiture était attelée de deux bons chevaux de l’Abruzze citérieure, ferrés de frais et bien empanachés de houppes de laine : un bel attelage dont la toilette avait été faite au départ de Monteleone par la jeune femme de Battista. Dans ces jeunes ménages, tout est coquet, tout se ressent des gaietés de la lune de miel.
Battista était un joyeux gaillard, un peu pâle et fort maigre (c’est le pays), mais bien découplé et portant fièrement sa frisure de femme. Il marchait ferme, plus pressé d’arriver que les voyageurs eux-mêmes. Dans l’intérieur, il y avait un homme d’une quarantaine d’années, d’apparence maladive et portant, sur sa tête chauve, un bonnet de soie noire. Il occupait le fond, lui tout seul, aux termes exprès de son contrat avec Battista Giubbetti. Sur la banquette du devant, un adolescent et une jeune fille étaient assis à reculons. L’adolescent portait ce costume semi-clérical qui, par tous pays, fait reconnaître les élèves des séminaires. La fillette avait une petite robe de toile grise et un chapeau de paille de France. Ce n’était pas une mise opulente, mais la jeune fille n’y semblait point tenir. Elle avait, malgré les espiègleries de son regard et la finesse de son charmant sourire, l’air encore plus réservé que son compagnon. C’était une petite religieuse en herbe, comme l’autre était un candidat à la prêtrise. L’un et l’autre abondent dans le royaume de Naples.
Elle était jolie, et belle aussi. Nous dirions presque qu’elle était plus belle que jolie, sans les gentillesses enfantines et imprévues de ce charmant sourire qui perçait à chaque instant sous son masque décent et austère. Ce masque appartenait à l’éducation. La nature avait fait ce sourire. Et c’était quelque chose de vraiment original que la lutte engagée, sur le terrain de ce délicieux minois, entre les pétulances naturelles et la réserve enseignée.
Le dessin de son visage était à la fois délicat et hardi. Le front, intelligent au plus haut degré, se couronnait de cheveux noirs dont la richesse dissimulée plutôt que mise en montre, allait se perdre sous un petit bonnet de linon sans garnitures. Sans ce bonnet, le pauvre chapeau de paille eût été presque élégant. L’oeil pensait, mais il se faisait grave à plaisir. Une collerette montante donnait à la robe cette tournure que le bonnet jaloux infligeait au chapeau. Et cependant, sous cet accoutrement sévère, il était bien facile de deviner les fines souplesses d’une taille déjà formée et qui eût fait craquer les plis miroitants du satin. Ce visage, qui indiquait à la fois la bonté, la grâce enfantine et je ne sais quelle pointe d’esprit aventureux et hardi, s’éclairait d’un sourire si affectueux quand elle regardait son frère, que les plus indifférents eussent senti naître en eux l’intérêt, presque l’affection.
Ce devait être son frère, ce séminariste aux longs cheveux blonds qui attendait la tonsure. Il y avait entre ces deux enfants une ressemblance qui ne pouvait tromper. La gravité du jeune homme était seulement plus sincère et plus naïve. Au jugé, le frère avait dix-huit ans et la soeur seize. En se parlant tout bas, ils employaient, tantôt l’italien, tantôt le français, et, dans les deux cas, leur langage était d’une égale pureté. Mais, réciproquement, ils ne prononçaient leurs noms qu’en français. Le frère s’appelait Julien, la soeur Céleste.
L’homme aux deux places du fond avait aussi un nom français. Quand le véturin avait casé son monde au moment du départ, il avait d’abord appelé M. David. M. David gardait le silence depuis le commencement du voyage. À peine avait-il donné un regard morose et distrait au jeune couple qui lui faisait face. Seulement, Céleste ayant prononcé le mot brigand, M. David avait haussé les épaules avec une grande affectation de dédain.
Ceux qui voyagent dans les Calabres prononcent souvent ce mot brigand. Les poltrons frissonnent. Les sceptiques font comme notre malade en bonnet de soie noire : ils haussent les épaules. M. David avait ses raisons particulières pour hausser les épaules quand on parlait ainsi de brigands. C’était une figure bilieuse et pensive : une tête de Génevois, un peu étroite, mais tranchante et de parti pris. On ne peut pas dire qu’il avait la physionomie méchante. En nos siècles utilitaires, ce mot méchant arrive à n’avoir plus de sens : il faut le remplacer par des expressions plus précises. Il y avait dans le regard froid et triste de M. David une profonde fatigue qu’on pouvait aisément traduire par le mot misanthropie. Il y avait dans les lignes de sa bouche de l’amertume et de la sévérité. Son front fuyait, mais il avait de la hauteur. La courbe busquée de son nez était provocante. En somme, l’aspect général de ce visage indiquait la réflexion, la réserve, l’austérité, l’égoïsme.
Il ne nous reste qu’un personnage à peindre : c’est le compagnon du véturin, celui qui est assis dans le cabriolet auprès de Battista Giubbetti. Celui-là se nommait le chevalier d’Athol sur le livret du véturin. Il arrivait de Sicile par le paquebot, et n’avait arrêté sa place que jusqu’au couvent del Corpo-Santo. C’était un beau garçon à la mine éveillée et souverainement vaillante. La méditation ne l’étouffait pas, en apparence du moins. Son regard, clair et insouciant, se promenait sur le paysage, tandis que ses doigts effilés, blancs et jolis comme des doigts de comtesse, roulaient une mince cigarette. Il était tout jeune. On lui aurait donné à peine vingt-deux ou vingt-trois ans, sans la soyeuse moustache noire qui ombrageait sa lèvre supérieure. Demi-couché qu’il était dans le cabriolet, on ne pouvait juger sa taille ; mais vous l’eussiez deviné grand, et la nonchalance même de sa pose décelait je ne sais quelle merveilleuse souplesse. Il semblait que tout fût aisé à ce beau lion paresseux, sauf peut-être la gaucherie roide et nouée de nos gentlemen à la mode. Encore ne faut-il jurer de rien. La maladresse est à la portée de tous les gens adroits, et les hommes d’esprit ont cette heureuse faculté d’être idiots à l’heure dite.
Ce chevalier d’Athol eût peut-être, au besoin, empesé tout à coup la grâce souple de son torse et posé en mannequin sans ressorts sur un trotteur anglais tout aussi grotesquement qu’un sportman empalé. Son costume indiquait un voyageur d’habitude.
Bien que les touristes n’abondent pas précisément dans ces parages, il en vient cependant chaque année. Une cinquantaine d’Anglais prennent le soin d’emporter dans leurs poches quelques mottes de la terre qui entoure le gouffre d’Oppido.
Notre voyageur, dont la bouche laissait passer une parole musicale et sonore, ne pouvait être un Anglais. Et pourtant Battista, l’honnête homme, l’appelait milord ! Tel est le résultat de cette fièvre de voyages qui a pris depuis cinquante ans les couteliers de Birmingham. Quiconque se promène en Grèce ou en Italie passe auprès des indigènes pour un fabricant de rasoirs, et reçoit à bout portant ce titre de milord. Du reste, le nom d’Athol est illustre de l’autre côté du détroit ; il appartenait aux anciens souverains de l’île de Man. Il est inscrit, avec titre ducal, au peerage du Royaume-Uni. C’est un grand nom porté par de très grands seigneurs. Mais, disons-le tout de suite, notre chevalier d’Athol n’avait aucun droit de succession à la pairie. Il avait la sève hardie de sa jeunesse et le sort.
La route qui remonte de Tropea à Monteleone s’enfonce d’abord dans les terres, puis revient sur ses pas, repoussée par la base du Mont-Mimo, de telle sorte qu’elle range un instant le bord de la mer avant d’arriver au cap Vatican.
– Regardez-moi cela, milord, dit Battista au moment où le coude de la route démasquait la Tyrrhénienne ; voilà une vue !... En arrière, on aperçoit très bien la Sicile, l’ancienne Trinacria... ou Sicania, capitale Syracuse, du temps des Romains... présentement Palerme ; produits : vins excellents, fruits, blé, huile, soie, laine, coton, sucre, manne, miel, cire... air pur et sain, mer poissonneuse, célèbre par son volcan qui a nom l’Etna, lequel est élevé de trois mille et tant de mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y a des mines d’or, d’argent, de cuivre, plomb et fer... carrières de porphyre, marbre, jaspe, agates, émeraudes. Elle produit de l’alun, du vitriol, du soufre. Mais Votre Excellence en vient, s’interrompit trop tard Battista.
Tous les véturins sont un peu cicérones ; ils saisissent avec un certain plaisir l’occasion de placer leur boniment.
– À gauche, avec votre permission, milord, reprit Battista, ce sont les îles Lipari, dont la principale...
– Qu’y a-t-il maintenant au Martorello ? demanda brusquement le jeune voyageur.
Battista fut sur le point de lâcher les rênes.
Il regarda le chevalier d’Athol en dessous.
– Son Excellence est déjà venue dans le pays ? dit-il.
– Je te demande, l’ami, répéta le chevalier d’Athol, ce qu’il y a maintenant au Martorello ?
– Eh bien, répondit le véturin, au Martorello, milord... il n’y a rien, que je sache.
– Que sont devenus les Six ?
– Les Six ?... répéta Battista d’un air innocent.
En même temps, il allongea un maître coup de fouet à ses bêtes. Le chevalier d’Athol se prit à siffler tout doucement l’air de Fioravante :
Amici, alliegre andiamo alla pena !...
– Un joli air napolitain, milord !... murmura le véturin, dont l’agitation était visible.
– Que sont devenus les Six ? répéta le voyageur.
– Ohimé ! grommela Battista, il ne manque pas de gens qui savent la musique !
– Donne ta main, ordonna le Chevalier d’Athol, si tu connais le charbon et le fer.
Battista, tremblant, donna sa main.
– Bien ! bien ! fit-il en sentant la double croix que l’étranger traçait sous sa paume, j’ai entendu parler de cela par un agent du roi Ferdinand qui cherchait sa vie du côté de Monteleone...
Le chevalier d’Athol sourit et dit :
– L’ami, tu es un garçon prudent.
Puis, lâchant la main de Battista et le regardant en face :
– Il y a quelque chose de plus fort que le fer ! prononça-t-il distinctement.
– C’est la foi, répliqua le véturin sans hésiter.
– Il y a quelque chose de plus noir que le charbon, ajouta le jeune voyageur.
– C’est la conscience du traître.
– Tu es compagnon ?
– Vous êtes maître !... À la grâce de Dieu !... J’ai une femme et un enfant qui va venir... Mais, par saint Jean mon patron, précurseur du Christ ! s’il faut aller, on ira !
– Que sont devenus les Six ? demanda pour la troisième fois Athol.
– Excellence, répondit Battista, si vous êtes maître, comment ignorez-vous cela ?
– Parle ! commanda le jeune voyageur, au nom du charbon et du fer !
– Ils étaient sept... murmura le véturin.
– Je ne sais où est le tombeau du septième, prononça le chevalier d’Athol avec mélancolie.
II
Mario Monteleone
Battista se découvrit respectueusement et fit le signe de la croix.
– Le septième était un saint ! dit-il.
Puis il reprit d’un air sombre :
– Quand on eut assassiné Mario Monteleone, trois fois comte, deux fois baron, et maître des chevaliers forgerons, les six gentilshommes furent proscrits... je répète ce qu’on m’a dit, Excellence. Ils vinrent une nuit : c’était le 15 octobre 1816. Ils se firent ouvrir les portes du couvent del Corpo-Santo, là-bas, au-dessus du Martorello, et déclarèrent la vendetta au meurtrier de Mario Monteleone.
– Le nom de ce meurtrier ? demanda Athol.
Comme le véturin hésitait et devenait plus pâle, Athol ajouta :
– N’oserais-tu le prononcer ?
– Il y a aujourd’hui quatre semaines, répondit Battista en baissant la voix, que le marquis de Francavilla est mort...
– Comment, mort ?
– D’un coup de couteau calabrais au travers du coeur.
– Et ce marquis de Francavilla était gouverneur du Pizzo lors des exécutions ?
– Oui, signor... et, au moment de son décès, intendant de la Calabre ultérieure deuxième.
Dans les États du roi de Naples, l’intendant est le chef de l’administration provinciale. Ses pouvoirs sont beaucoup plus étendus que ceux de nos préfets.
– Francavilla était coupable, dit le chevalier d’Athol comme en se parlant à lui-même ; mais ce n’est pas lui qui a tué le saint Monteleone... Les Six n’ont-ils pas été plus haut ?
– Plus haut ? répéta le véturin ; non... Giacomo Doria est mort dans son lit... ses deux enfants ont son héritage.
– Le comte Giacomo était-il donc soupçonné ? demanda vivement Athol.
– Je répète ce qu’on dit, fit Battista pour la seconde fois ; ce sont les Doria qui ont les biens de Monteleone... Et le comte Giacomo était dans le pays quand le malheur arriva.
Le jeune voyageur rêvait.
– Et plus bas ? fit-il tout à coup.
– Plus bas ? répéta encore Battista.
– La vengeance des six a-t-elle été plus bas ?
– Ah ! voyez-vous, signor, je ne peux parler que d’après les on dit... Il y a le colonel.
– Trentacapelli ?...
– Juste... Trentacapelli a été trouvé, voilà déjà longtemps, sur la route de Cosenza, la figure dans une mare... la lame du couteau calabrais lui sortait derrière le dos.
– C’était le couteau d’un compagnon ?
– C’était le couteau du Silence.
Dans l’intérieur, l’homme au bonnet de soie noire avait fermé les yeux. Il semblait dormir.
– C’est bien vrai, petite soeur, disait Julien, qui tenait les mains de Céleste dans les siennes ; je suis destiné à un ministère de résignation et de charité ; je ne devrais avoir que des pensées pacifiques. Eh bien, je me sens malgré moi saisi et entraîné au récit des batailles guerrières et même de ces autres batailles qui se livrent dans le monde, avec un salon pour champ-clos et la passion pour arme. J’ai peur quelquefois...
– Rien ne te force à recevoir les ordres, Julien, mon frère chéri, répliqua la jeune fille.
– Rien ?... et ma vocation ?
– Si tu regrettes le monde ? commença Céleste.
Il l’interrompit avec un mouvement. de colère.
– Ah ! tu es bien heureuse, toi, dit-il ; tu ne regrettes rien !...
Céleste étouffa un soupir. Cependant elle répliqua, tandis que ses yeux cachaient leur brillant rayon derrière ses paupières demi-closes :
– Je ne connais rien, mon frère.
– Ni moi non plus, fit Julien naïvement.
– Alors que peux-tu regretter ?
Le séminariste prit un air d’importance.
– Sais-je expliquer ce qui se passe en moi ? s’écria-t-il, et saurais-tu le comprendre ?... Je souffre !
Céleste releva les mains de son frère et les appuya contre ses lèvres. La voiture arrivait au sommet du cap Vatican, et tout ce grand paysage, calme et morne, de la baie de Sainte-Euphémie, se déroulait au-devant de nos voyageurs.
Maintenant que Julien ne parlait plus, Céleste avait comme un remords de l’avoir interrompu. Entre gens qui s’aiment, la supériorité est presque toujours un esclavage. On a beau ignorer cette supériorité, elle perce par l’amour. Céleste pressa la main de Julien entre les siennes.
– Voyons, frère, dit-elle, le voilà, ce fameux golfe dont tu m’entretiens depuis le commencement de la route... Raconte-moi deux ou trois chapitres des Victoires et Conquêtes.
– Ceci est un chapitre des Défaites et Revers, ma soeur, répondit Julien ; l’histoire est là, dans ma tête bien mieux gravée que si je l’avais lue quelque part. C’est un témoin oculaire qui me l’a rapportée, le bon Manuele.
– Notre cher Manuele était là ? s’écria la jeune fille. Oh ! je t’en prie, Julien ! fais-moi ce récit ; ce sera comme si nous parlions de notre excellent père !
À ce moment, les yeux de M. David s’ouvrirent imperceptiblement. Il glissa un regard rapide et tranchant sur les enfants qui lui faisaient face ; puis il laissa retomber ses paupières.
Sauf ce mouvement tout physique de la paupière et le rayon subtil qui jaillit un instant de sa prunelle, sa physionomie n’avait point changé.
– Penses-tu que Manuele soit réellement notre parent, Céleste ? demanda tout à coup Julien.
– Je serais désolée qu’il ne le fût point, répondit vivement la jeune fille.
Elle attendit avec une sorte d’anxiété, pensant que son frère allait ajouter quelque chose à ce sujet ; mais Julien rompit l’entretien.
– Oui, oui, reprit-il, Manuele m’a bien souvent raconté cela. Il y a là-dedans un comte de Monteleone qui ressemble aux héros de la Grèce et de l’ancienne Rome. Ce n’est pas à cause du roi Murat que j’ai si présente à la mémoire l’histoire de Manuele, c’est à cause de Mario Monteleone.
– J’écoute, dit Céleste, qui prit un air attentif et croisa ses belles mains blanches sur ses genoux.
Julien cependant semblait rêver et ne parlait point.
– Eh bien ? fit la jeune fille avec reproche.
– Je songeais, dit Julien en jetant un regard du côté de M. David pour constater qu’il dormait encore, je songeais à notre présent et à notre avenir, Céleste. Notre passé est court et ne nous a rien appris, sinon que nous devons le jour à une famille française, exilée et proscrite. Les révolutions sont partout les mêmes, elles jettent ça et là sur une terre étrangère de pauvres orphelins condamnés. Je songeais aux enfants orphelins de ce Mario Monteleone.
– Ils avaient des enfants ? interrompit Céleste.
– Trois enfants, qui lui furent enlevés tous les trois par une fatalité inexplicable et qu’il n’a jamais revus, trois enfants dont il porta successivement le deuil, et qu’il fit chercher longtemps, bien longtemps en France, en Allemagne, partout... et toujours en vain ! trois enfants qui étaient, les deux derniers surtout, le coeur de leur pauvre mère. Si bien qu’après leur enlèvement, Mario Monteleone fut seul avec une morte dans sa maison déserte. Sa femme avait perdu la raison !
Céleste écoutait. Ses yeux étaient pleins de larmes.
– Notre mère à nous, murmura-t-elle, est morte en Sicile. Manuele me l’a dit.
Julien passa la main sur son front, et son visage, plus pâle, prit une expression de découragement.
– Je ne sais pas, non, je ne sais pas, Céleste, d’où me vient cette tristesse profonde qui, à certaines heures, me dégoûte de la vie. Il me semble qu’un grand malheur est sur nous et autour de nous, un malheur, un malheur qui a commencé avec nous et qui ne finira qu’avec nous... J’ai fait bien des efforts pour deviner ; je n’ai pas pu. Mais il y a dans mes souvenirs un point précis et ineffaçable. C’est le jour où, pour la première fois, nous vîmes notre bon Manuele. Nous étions dans cette ferme du val de Mazzaro où l’on nous élevait par charité. Je le vois encore accourir vers nous les bras ouverts... et nous, timides, ombrageux, fuir à la vue de cet étranger.
– Il nous dit que nous étions ses enfants, ce jour-là ! murmura Céleste.
– Il nous dit que nous allions être riches et heureux. Nous le suivîmes dans cette riante maison, non loin de Catane. Chaque jour, il écrivait des lettres, et je me souviens qu’une fois il me dit : « Si je n’étais pas ton père, Julien, est-ce que tu m’aimerais tout de même ? »
– Il te dit cela ? fit Céleste, curieuse.
– Oui... Et il me parla de ma mère, qui venait de loin pour me chercher, de France, sans doute. Tout à coup, il fit une absence. Quand il revint, il était bien changé !
– Je me souviens de cela ! s’écria Céleste ; il fut malade...
– Et dans son lit, quand nous approchions, il nous regardait avec des larmes pleins les yeux.
Céleste répéta :
– Je me souviens de cela.
– J’étais déjà grand, reprit Julien ; c’était à la fin de l’automne, il y a six ans... Dès qu’il put se relever, il nous mena à Girgenti acheter des habits de deuil.
– Il nous dit que son frère était mort, interrompit Céleste ; j’eus une robe noire...
– Était-ce bien son frère qui était mort ? murmura Julien.
La jeune fille répondit :
– Pourquoi nous aurait-il trompés ?
Leurs mains étaient réunies. Ils se regardaient. Julien détourna les yeux le premier.
– Céleste, dit-il, je crois que je mourrai jeune.
Puis il ajouta :
– Je prie Dieu qu’il te prenne avant moi, Céleste, afin que tu ne restes point seule ici-bas !
– Tu es bon ! murmura la jeune fille, dont les paupières devinrent humides ; tout ton coeur est dans ces paroles !
– Manuele est triste, reprit Julien, n’essayant pas même de lutter contre le courant de sa mélancolie ; Manuele nous a quittés la mort dans le coeur. Je ne sais pourquoi, en recevant sa dernière lettre, où il nous envoyait dix ducats en nous donnant rendez-vous dans ce pays inconnu, l’idée de sa pauvreté m’a saisi pour la première fois. Nous n’avions jamais manqué de rien, ma soeur ; mais où Manuele prend-il l’argent qu’il nous donne ?
Céleste releva sur lui ses grands yeux.
– Je me suis fait cette question-là bien souvent, prononça-t-elle à voix basse.
– Avant moi !... dit Julien avec surprise. Tu ne me dis donc pas tout ce que tu penses, Céleste ?
– Tout ce qui peut te rendre heureux, Julien, répliqua la jeune fille, je te le dis.
À ce moment, soit avec intention, soit involontairement, M. David s’allongea sur sa banquette et rouvrit ses paupières à demi.
– Écoute, petite soeur, dit Julien abandonnant aussitôt ce sujet de conversation intime ; il nous faut prendre les choses de plus haut... Mario, des princes de Bénévent, comte de Monteleone, de Palazzi et Viserte, baron de Civita-Galla et de Vittole, était le cousin du roi Ferdinand et le plus grand seigneur des Calabres. Orphelin de père et de mère, il avait été élevé à la cour avec l’héritier des Doria, et François, prince royal de Naples, fils unique de Ferdinand. Le roi aimait les trois adolescents d’une tendresse presque égale, et, s’il donnait parfois à l’un deux une part plus grande de caresses, c’était à Mario Monteleone. Le roi disait :
« – Mon fils François de Bourbon et Giacomo Doria sont des gentilshommes : l’enfant Monteleone est un prince.
« Il fallait que l’affection du roi fût bien grande, car il ne cessa point d’aimer Mario Monteleone lorsque celui-ci, entraîné par ces idées de liberté qui saisirent tous les généreux coeurs à la fin du dernier siècle, prit parti pour les réformateurs. Giacomo Doria le suivit. Le prince François lui-même, séduit par l’éloquence de Monteleone, donna, dit-on, les mains au mouvement, et ambitionna le titre de libérateur de l’Italie. Mais Mario Monteleone ne voulait pas d’étranger et quand le général français Championnet vint faire le siège de Naples, en 1799, il se mêla, bras nus et la ceinture rouge autour du corps, à ces bataillons de pécheurs et de lazzaroni qui défendirent Naples avec tant d’héroïsme. Le roi Ferdinand pressa cette main noire encore de poudre. Il tint longtemps Mario embrassé en l’appelant son fils. Puis il lui demanda :
« – Neveu, que veux-tu ?
« Sire, répondit Mario Monteleone, je veux la liberté de l’Italie.
« Le roi Ferdinand Ier, le même qui nous gouverne aujourd’hui et dont le règne dure déjà depuis cinquante-quatre ans, promit des réformes. Mario Monteleone attendit ; puis, las d’attendre, il dit un jour adieu à Ferdinand de Bourbon, quitta la cour pour jamais et se retira dans ses domaines.
« C’était vers le commencement de ce siècle. Monteleone vécut d’abord dans la solitude. Il n’avait qu’un ami : Giacomo Doria, son ancien compagnon d’armes et de plaisirs. Quand Giacomo Doria retournait à Naples, Monteleone restait seul avec une jeune parente élevée par charité dans sa famille et qui lui tenait lieu de soeur. Celle-ci avait nom Barbe de Monteleone. Mario l’aimait pour son esprit généreux et soumis, pour son éducation choisie et sa piété. Peut-être Barbe aimait-elle Mario d’une autre manière.
« Il me semble voir cette femme dont Manuele ne m’a fait le portrait qu’une fois. Elle avait la beauté du visage, mais un accident, survenu dès son enfance, avait déformé sa taille. Ses épaules inégales, son torse raccourci et dévié, imprimaient à toute sa personne un cachet de difformité. Elle portait, pour dissimuler cela, des vêtements amples et de couleur sévère, semblables à ceux des nonnes. Elle avait quelques années de moins que son parent et protecteur.
« Quand Monteleone épousa, vers l’année 1801, la belle Maria des Amalfi, Barbe fit à la jeune épousée un accueil plein de grâce et d’affection. Mais on la vit maigrir et pâlir. Elle fut prise d’une maladie de langueur. On crut qu’elle allait perdre la vie. Le secrétaire du comte de Monteleone, un Allemand, fit venir de son pays un médecin savant. Barbe fut sauvée, mais son visage garda toujours un masque de livide pâleur.
« Maria des Amalfi, la nouvelle épouse du comte, était de grande famille, mais sans fortune. Le comte n’en avait pas besoin. Qu’eût ajouté une dot à ses immenses domaines ? Elle avait la beauté d’un ange. Son coeur était plus angélique encore que sa beauté. Elle apporta au comte sa jeunesse charmante, sa douce âme pleine d’amour, son esprit cultivé, son coeur noble sachant compatir à tous les malheurs.
« Peu de temps après la guérison de Barbe, Dieu voulut mettre le comble aux joies de Monteleone, Maria lui donna un fils. Que d’espérances autour de ce cher berceau ! et que d’amour. Barbe, plus folle que la jeune mère elle-même, ne pouvait se rassasier de caresses. Elle disputait le nouveau-né à la nourrice et le voulait toujours dans ses bras. C’était un spectacle calme et doux qu’offrait la grande salle du château dans les longues soirées d’hiver. La noble figure de Monteleone semblait refléter tous ces sourires amis qui s’épanouissaient autour de ce berceau où se concentraient ses espérances. Mais tout à coup un voile de deuil couvrit ces allégresses de famille et ces tendres espoirs.
« Un matin, la nourrice en pleurs apporta le berceau vide. Barbe s’arracha les cheveux. Sa douleur fut en quelque sorte plus poignante que la douleur du père et de la mère. Après le premier moment de stupeur, on se demanda quelle main avait pu porter ce lâche et terrible coup. Que répondre ? La nourrice avait sa mère dans le pays : une vieille femme qui avait nom Berta. Berta put dire seulement qu’une troupe de zingari avait campé dans la vallée. Cette Berta appartenait à Barbe. Comme Barbe, elle adorait l’enfant et la mère.
« Des courriers partirent dans tous les sens. Barbe attendait leur retour à la fenêtre la plus élevée du château. Dès qu’elle les apercevait au loin, elle courait à leur rencontre. Mais nulle part on n’avait vu ni bohémiens ni enfants. Le dernier espoir mourut. Une tristesse morne emplit le château, naguère si joyeux. Cela dura une année.
« Mais Monteleone avait dans son coeur des ressources contre cette mort anticipée, qui est le découragement. Il regarda autour de lui, et vit qu’il y avait des misères à secourir, des plaies à cicatriser, du bien à faire. Ce jour-là, il se réveilla. C’était ce domaine de Monteleone, toute une grande contrée, ruinée à la fois par les tremblements de terre, par les épidémies qui suivent toujours les cataclysmes et par la paresse invétérée des habitants. Monteleone se dit :
« – Voici ma tâche... Dieu verra mes efforts et me prendra en pitié.
« Il se dit encore :
« – Je ferai des hommes avec ces misérables. On verra dans les Calabres, pour la première fois depuis cent ans, un peuple de travailleurs.
« Le grand comte Giacomo Doria, son ancien frère d’armes et de plaisirs, avait autrefois partagé ses idées de liberté. Monteleone voulut l’avoir pour associé et lui fit part de ses généreux desseins. Les domaines de Doria confinaient aux siens et se trouvaient dans un état pareil. Mais Doria ne se souvenait plus des aspirations de sa jeunesse ; et, quand Mario lui eut confié ses desseins, il n’en fit que rire. Il répondit :
« – Les Doria ne se sont jamais servis que d’un seul outil, qui est l’épée.
« – Mon cousin, dit Mario, nous autres Monteleone, nous passons pour être d’aussi bonne maison que vous... Si vous ne voulez point m’aider, j’agirai seul.
« Et il se mit à la besogne.
« Pendant son règne, car il fut roi dans cette partie de la Calabre ultérieure, on vit l’olivier grandir et fleurir, la vigne monter à l’orme, le maïs d’or onduler à la brise sur le versant jadis désolé des collines ; le frêne donna la manne et le riz ensemencé jeta sur les marécages un opulent manteau de verdure. Ce n’était pas assez. La nourrice du monde a deux mamelles : l’agriculture et l’industrie. Mario Monteleone voulut l’industrie après l’agriculture. Et, comme la fierté stupide du Calabrais contrecarrait son dessein, il prit un jour à la main le marteau et battit le fer sur l’enclume. Cela fit grand bruit. Dans tout le royaume de Naples, on ne parlait que de Mario Monteleone il Benefattore, comme on l’appelait. Les jeunes courtisans riaient de bon coeur en songeant à son marteau de forge ; mais le peuple le bénissait. Le roi Ferdinand entendit parler de ses forges, dont la principale était à Martorello, à quelques milles d’ici. Le roi dit en riant :
« – Une fois en ma vie, je veux voir travailler mes Calabrais.
« Mais ce qui l’attirait surtout, c’était son ancien pupille, qu’il appelait ingrat, et qu’il accusait de l’avoir abandonné. Il partit de Naples avec l’intention de le ramener à tout prix. C’était en 1805.
« Mario, comte de Monteleone, reçut Ferdinand de Bourbon avec le tablier de cuir et le marteau à la main. Quand le roi eut vu travailler ses Calabrais, il changea d’avis et dit à Monteleone en l’embrassant :
« – Reste ici... tu m’as ressuscité un royaume.
« Il lui donna la grand’croix de l’ordre de Saint-Ferdinand, et autorisa solennellement l’Association des gentilshommes forgerons dont Monteleone était le grand-maître. (Cavalieri ferrai) Six hommes de confiance qu’il avait, ses amis et ses parents pour la plupart, composèrent cette Association des gentilshommes forgerons. Elle fut rompue peu de temps après par le même roi Ferdinand.
« Les forges du Martorello étaient fondées ; une ville avait surgi de terre, une ville qui est morte maintenant. Pendant quelques années, Tropea fut un port de commerce. Les vaisseaux anglais apportaient la houille et remportaient le fer. Le bois venait de la Sila, cette grande forêt qui est dans l’Apennin, à l’est de Cosenza, cette forêt où l’on pourrait prendre, sans l’épuiser, cent mille troncs de chênes, de hêtres et de châtaigniers tous les ans, jusqu’à la fin du monde. La révolution était faite, la révolution pacifique. Le pays vivait. Chose étrange ! la race se relevait visiblement. La beauté physique, chassée par la misère, revenait dans cette grande Grèce, qui avait été si longtemps sa patrie.
« Lors de événements de 1808, Mario Monteleone et ses adhérents résistèrent du mieux qu’ils purent à l’influence française. Mario fit même le voyage de Sicile, afin d’offrir à Ferdinand de Bourbon, son maître et son ami, le secours de son épée. Le roi lui dit :
« – Je t’attendais.
« Mario lui baisa la main, les larmes aux yeux. Le gentilhomme se réveillait en lui.
« Ce fut pendant ce voyage de Sicile que la foudre éclata pour la seconde fois sur la maison de Monteleone. Dieu avait eu pitié de son serviteur. Le bonheur était revenu dans la famille. Le temps n’eût point suffi à cicatriser la plaie qui saignait aux coeurs du comte et de la comtesse, pleurant leur premier-né. Mais deux fois l’union bénie de ces belles âmes avait été féconde, Maria des Amalfi, toujours jeune et plus charmante dans l’épanouissement de sa beauté, avait mis au monde deux autres enfants : un fils et une fille.
« Tu vas te croire au beau milieu d’un récit romanesque, ma pauvre Céleste, s’interrompit ici Julien, et pourtant c’est Manuele qui m’a raconté cela. Manuele qui n’est pas un poète ! Je n’ajoute rien à ses paroles tant de fois répétées.
« Ce bon Mario Monteleone avait le coeur qu’il fallait pour savourer passionnément les saintes joies de la famille. Il était si heureux, cet homme, qu’il voulut concentrer son bonheur, rassembler en cher faisceau toutes ses allégresses et bâtir un temple à sa félicité. Au centre de cette vallée dont la prospérité était son ouvrage, au centre du Martorello, un pavillon tout en marbre s’éleva. Dans la chambre du rez-de-chaussée, aux murailles rafraîchies par sa position même, qui était un peu au-dessous du sol, on plaça le lit nuptial et les deux berceaux. Le lit nuptial était entre ces deux blanches couchettes où dormaient deux amours. C’est là qu’il se retirait avec Maria des Amalfi, plus belle par ses tendresses de mère heureuse ; c’était là qu’il goûtait dès ce monde tous les délices du paradis. Ai-je besoin de te dire qu’un premier malheur avait éveillé la prudence du père et de la mère ? Ai-je besoin de te dire quelles précautions minutieuses entouraient ces deux berceaux ?
« Les enfants grandissaient. Si Monteleone pouvait passer pour la Providence du pays, Maria des Amalfi en était l’ange. L’amour de tout un peuple faisait bonne garde. Quand Monteleone revint de son voyage de Sicile, personne n’accourut à sa rencontre sur la route où il cherchait des yeux Maria, sa femme, et les deux gais chérubins. Personne ! Quand il franchit le seuil de sa maison, un silence morne accueillit son entrée.
« – Ma femme ! s’écria-t-il, mes enfants ! Où sont mes enfants et ma femme ?
« Point de réponse. Enfin, l’un des six gentilshommes forgerons, cet Allemand qui avait été son secrétaire, lui dit :
« – Maître, rassemblez tout votre courage. Dieu vous a frappé. Vous n’avez plus d’enfants et votre femme se meurt !
« Monteleone entra dans la chambre de marbre. Il vint s’asseoir au chevet de sa femme, qui ne le reconnut point. Dans son délire, elle parlait à ses enfants ; elle les voyait, elle les baisait, et ces chimériques caresses mettaient la mort dans le coeur du malheureux père. Voici ce qui s’était passé :
« La vallée du Martorello n’est séparée des grèves que par une étroite colline ou falaise, au sommet de laquelle habitait cette vieille femme nommée Berta, mère de la servante qui s’occupait des enfants. Quelques jours avant le retour de Mario Monteleone, la servante alla voir sa vieille mère et emmena les deux enfants dans le petit carrosse qu’elle avait coutume de traîner. Le soir, elle revint en criant et en pleurant. Des hommes masqués étaient entrés dans la chaumière de Berta ; ils avaient volé les deux enfants, et la servante avait vu, du haut de la colline, les ravisseurs faire force de rames vers une felouque barbaresque, à l’ancre dans les eaux de Stromboli.
« Monteleone ne put interroger la servante, elle s’était noyée dans les eaux de la Brentola. Barbe, frappée aussi violemment que la mère elle-même, ne pouvait que gémir et pleurer. Monteleone fit murer le pavillon de marbre, où restèrent là le lit nuptial et les deux berceaux. Ce fut comme le tombeau de son bonheur.
« Maria des Amalfi ne put rendre son âme à Dieu. Elle guérit. Mais Dieu clément eut pitié d’elle et ne lui rendit point la raison. Sa folie était de se croire morte.
« Un soir, les Six se réunirent dans la maison de Mario Monteleone, et l’Allemand dit :
« – Maître, ceux qui vous sont dévoués réfléchissent pour vous... Le hasard ne frappe pas précisément deux fois à la même place ; il a fallu, pour porter ces deux coups pareils, la main d’un traître... Qui fait le mal, sinon celui qui est intéressé à mal faire ? Maintenant que vous n’avez plus d’enfant, Giacomo Doria devient votre héritier légitime...
– Quoi ! s’écria ici Céleste, interrompant le récit de son frère, il se pourrait ?...
Julien reprit :
– Voici ce que répondit Monteleone à cette insinuation :
« – Giacomo Doria est mon cousin. Nous avons longtemps vécu en frères... Barbe, ma parente, m’a parlé déjà comme vous le faites : je l’ai sévèrement réprimandée... Que Dieu conserve à Giacomo les deux beaux enfants qu’il a ! Je défends à quiconque m’aime et m’obéit de rien entreprendre contre la maison de mon cousin Doria !
– C’était un saint ! murmura Céleste.
– Oui, dit Julien, c’était un saint... et Dieu le traita comme tel, puisqu’il fit de lui un martyr !
« Monteleone fut proscrit par le nouveau gouvernement et vit confisquer ses comtés avec ses baronnies. Cependant, le roi Joachim laissa subsister les forges de Martorello, qu’il mit sous la surveillance d’un intendant ou préfet spécial : il n’y eut ni exactions ni violences. Les Six, comme on appelait les chevaliers forgerons, en l’absence du maître, qui était le septième, continuèrent leurs travaux et organisèrent réellement une société secrète. Cette société, qui, dit-on, subsiste encore, malgré les proscriptions prononcées contre elle, prit des proportions considérables et contribua puissamment à la révolution de 1815.
« Il y avait une chose étrange. Monteleone, exilé en Sicile, eut le même sort que le roi Murat sur le trône de Naples. On essaya deux fois de l’assassiner. Ce fut pendant le séjour que fit auprès de lui Barbe, sa parente, et un des Six, son bras droit, son homme de confiance, l’Allemand, dont j’ai déjà parlé plusieurs fois. Barbe et l’Allemand accusèrent les Doria. Monteleone ne crut pas. Il avait retrouvé Giacomo Doria en Sicile ; Giacomo, heureux père de deux enfants, un fils et une fille. Le fils de Giacomo avait déjà l’âge d’homme.
« Quand la chute de Murat et la restauration de Ferdinand mirent un terme à l’exil, Monteleone, Doria et son fils Lorédan traversèrent le détroit dans la même barque et s’assirent côte à côte dans le même carrosse. Au commencement du mois d’octobre de l’année 1815, Mario Monteleone fut ramené en triomphe au milieu de ce peuple des Calabres qui était sa famille.
« Ce fut treize jours après que Joachim Murat, proscrit à son tour, vint tenter un débarquement dans le royaume de Naples. Mais la fortune n’était plus avec lui. En un instant il vit ses espérances s’évanouir. Il se trouva en quelques heures sans armée et sans suite, errant dans un pays qui avait été son royaume. Aux dernières lueurs du crépuscule, le roi, qui était seul avec Franceschetti et un Français fidèle, voulut lire un écriteau suspendu à une perche, pensant qu’il saurait ainsi le nom du lieu où il se trouvait. L’écriteau était une pancarte signée par le marquis Francavilla, gouverneur du Pizzo. On y promettait une prime de vingt-cinq mille ducats à quiconque livrerait la tête du brigand Joachim Murat, se disant roi de Naples. Cela le fit sourire, et il dit :
« – C’est bien peu !
« Cependant, il n’y avait pas d’autre ressource que de se rembarquer. Les deux compagnons de Murat interrogeaient l’horizon avec désespoir. Aussi loin que leurs regards pouvaient se porter, on n’apercevait point trace de navire. Le patron, Maltais qui se nommait Olivier Barbara, avait reçu son paiement. Craignant les suites de cette téméraire entreprise, il avait mis à la voile quelques heures auparavant. Le roi, le général et le Français étaient alors sur la grève, au pied de cette couche que tu vois là-bas, petite soeur, et sur laquelle s’élève la guérite d’un garde-côte. Derrière le monticule s’ouvre une vallée où coule la petite rivière de Brentola. Nos fugitifs se croyaient descendus beaucoup plus au nord.
« Après avoir erré longtemps sur le rivage, cherchant toujours leur navire, qu’ils ne devaient point trouver, ils arrivèrent, épuisés de faim et de fatigue, à cette route où nous sommes. Une grande maison s’élevait à mille pas du rivage, au bord de la vallée, qu’ils prenaient maintenant à revers. Cette maison était pleine de bruit et de lumière, il y avait festin. Ils frappèrent ; on leur ouvrit ; l’hospitalité leur fut accordée. Dans la salle à manger, il y avait une douzaine d’hommes attablés autour du maître, sombre et triste au milieu de cette fête. Vis-à-vis du maître, une place restait vide. C’était la maison de Monteleone, dont on célébrait le retour. La place vide appartenait à Maria des Amalfi, sa femme folle. Les convives étaient les Six d’abord, puis quelques gentilshommes du parti de Bourbon, parmi lesquels Giacomo Doria et son fils Loredano. Monteleone avait ordonné que les hôtes nouveaux fussent introduits.
« Franceschetti s’avança jusqu’à la porte. Il n’eut besoin que d’un coup d’oeil pour reconnaître la mâle et noble tête du maître.
« – Que Dieu nous aide ! dit-il tout bas en se repliant vers Murat ; nous sommes au pouvoir de Mario Monteleone !
« Celui-ci demandait :
« – Pourquoi nos hôtes n’entrent-ils pas ?
« Et déjà on chuchotait autour de la table. Le bruit de la fusillade qui avait eu lieu cet après-midi était venu jusqu’au Martorello. Joachim appela Mario Monteleone par son nom.
« – N’allez pas ! s’écria-t-on de toutes parts.
« Le maître s’était levé. Tous firent de même et voulurent le suivre. Il leur dit :
« – Restez !
« Et il se rendit seul à l’appel de l’inconnu. Il y avait des valets dans la salle d’entrée. L’étranger dit au maître :
« – Je ne puis me nommer qu’à vous.
« Le maître fit retirer les valets. Murat et Monteleone ne s’étaient jamais vus avant ce jour. Murat regarda Monteleone avant de parler. Monteleone demanda :
« – Que voulez-vous de moi ?
« – Un abri, répondit le roi : je suis accablé de fatigue... du pain et du vin ; j’ai faim.
« – Ce sont des choses qu’on ne refuse à personne, seigneur, dit le maître.
« – Je suis proscrit, reprit Murat.
« – Je l’étais hier, fit Monteleone.
« – Je vous ai fait du mal... Peut-être injustement.
« – Que Dieu vous le pardonne, seigneur... Moi, je vous ferai du bien.
« – Sans me demander mon nom ?
« – Sans vous demander votre nom.
« Le sang remonta aux joues pâlies de l’étranger, qui rejeta en arrière le manteau drapé autour de son visage et dit en avançant d’un pas :
« – Je te le dirai, Mario Monteleone : je suis Joachim Napoléon, roi de Naples.
« Le maître s’inclina profondément, et resta désormais tête nue.
« – Sire, dit-il, je remercie Votre Majesté d’avoir honoré ma maison de votre visite.
« Il prit un flambeau et sortit le premier par une porte latérale.
« Murat le suivait en silence. Ils montèrent au premier étage de la maison.
« – Sire, dit Mario Monteleone en présentant un siège au roi, Dieu veuille que l’Italie n’ait plus jamais de plus dur maître que vous !... Ce que vous avez fait contre moi regarde votre conscience : je ne vous veux pas de mal... Je suis, il est vrai, le serviteur fidèle de Ferdinand de Bourbon, mais vous êtes mon hôte... Sous mon toit, j’en fais le serment, vous mangerez en paix et vous dormirez tranquille.
« Il sortit et revint bientôt, apportant lui-même les mets et le vin.
« – Pour ce qui est de moi, reprit-il, je me fie à mes amis et à mes serviteurs... Pour ce qui est de Votre Majesté, je ne me fie qu’à moi-même.
« Le roi s’assit à la table et mangea avidement. Monteleone le servit la tête découverte.
« Après le repas, Monteleone guida le roi par la main jusqu’à sa propre chambre. Il lui dit :
« Sire, pour arriver jusqu’à Votre Majesté, il faudra que vos ennemis passent sur mon corps mort.
« Et il se coucha sur un matelas, tout habillé, en travers de la porte du roi. Mais la trahison veillait.
« Vers trois heures de la nuit, la porte de la maison fut enfoncée. Cent cinquante gendarmes et plus de cent hommes de la troupe à pied étaient là. On ne fit pas même les sommations d’usage. Cinq officiers parvinrent jusqu’à la chambre du roi, après avoir mis des gardes à toutes les avenues.
« Dès le premier choc, Monteleone tomba sur ses genoux, percé de trois blessures. Il ne lâcha point son épée. Franceschetti et le Français, réveillés en sursaut, déchargèrent leurs pistolets dans le corridor au moment où Murat se présentait à la porte de sa chambre. Aucun des cinq officiers n’eut le triste honneur de mettre la main sur le roi de Naples. Les soldats trouvèrent leurs cinq cadavres couchés autour de Monteleone évanoui, mais l’épée à la main. Murat, Franceschetti et le Français étaient parvenus à s’échapper par la fenêtre. On ne les prit qu’au bord de la mer, après une résistance désespérée.
« Tu sais le reste, petite soeur, du moins en ce qui concerne Murat. Murat fut jugé, condamné, exécuté en deux fois vingt-quatre heures. Monteleone fut également condamné comme ayant pris les armes contre son légitime souverain. Mais il n’y eut personne dans le pays pour croire à l’exécution de Monteleone, le père des Calabres, le bienfaiteur et le saint, l’homme qui avait souffert pour sa fidélité à Ferdinand, l’ami, le parent des Bourbons, le fils des princes de Bénévent !
« Vingt mille voix – et c’est énorme dans ces pays – crièrent toute la nuit autour du château du Pizzo pour réclamer la liberté de Monteleone. Le marquis de Francavilla fit annoncer au peuple qu’un courrier était parti pour Salerne, où Ferdinand faisait momentanément sa résidence, pour implorer la clémence royale. On attendit. Mais, en attendant, on ne resta point oisif. Les gentilshommes forgerons étaient là. Un coup de main fut organisé pour le cas où Monteleone devrait marcher à l’échafaud. Il y avait dix fois plus de conjurés autour du Pizzo que de soldats dans la garnison. Dût la ville sauter, il fallait que Monteleone fût libre.
« On attendit deux jours et deux nuits. Le matin du troisième jour, un courrier royal parut tout au bout de la route, galopant et agitant un drapeau blanc. Ce ne fut qu’un cri :
« – Grâce ! grâce !
« Le roi faisait grâce en effet.
« Les compagnons du fer, se ruèrent, ivres de joie, vers le château. Chacun était plus heureux que s’il eût sauvé sa femme ou son enfant. Ils avaient préparé un brancard tout orné de feuillages et de fleurs pour emporter leur père en triomphe au Martorello. Ce fut un cadavre qu’on déposa sur le brancard triomphal. Monteleone était mort dans son cachot. Quelques-uns disent que, la nuit précédente, un homme s’était introduit dans sa prison. Un homme portant un masque sur son visage.
« Ceux qui disaient cela ajoutaient que Monteleone avait été étranglé à l’aide d’une ceinture... Mais comment croire à ces fables qui vont et viennent dans le peuple ? Il y avait meurtre, voilà le vrai. La responsabilité du meurtre ne pouvait tomber que sur les gens du roi.
« Les représailles ne furent pas immédiates. Cette foule immense, muette et stupéfiée, se massa autour du brancard et accompagna le mort jusqu’au Martorello. Chemin faisant, les populations des campagnes se joignaient au cortège. Les funérailles se firent au couvent del Corpo-Santo, de l’ordre de Saint-Bruno, dont les vieilles tours dominent là-haut la montagne. Tout le pays était là, et tout le pays put remarquer l’absence de Maria des Amalfi, comtesse de Monteleone, veuve du maître. Maria avait disparu.
« En gravissant la montagne del Corpo-Santo, les six chevaliers de fer s’étaient mis en avant du brancard. On ne les vit point durant le service funèbre. Mais, dans cette immense église, dix fois trop petite pour la foule qui se pressait depuis l’autel jusqu’au rempart même du couvent, un mouvement se fit après l’Agnus Dei. Six hommes masqués vinrent s’agenouiller à la sainte table. Le prêtre, chose étrange et qui impressionna profondément les assistants, leur donna la communion sans qu’ils découvrissent leurs visages. En se levant de la sainte table, ils marchèrent vers le brancard où le corps de Monteleone était toujours dans son cercueil ouvert. Ils étendirent leurs mains sur le cadavre, comme s’ils eussent prononcé en eux-mêmes un silencieux serment. Au doigt médius de chacune de leurs mains, il y avait une bague de fer. Les six bagues étaient semblables.
« On leva le corps. Ceux qui purent entrer dans le caveau virent une fosse ouverte, et au-dessus une potence à poulies. Le cercueil ouvert fut attaché aux cordes pour être descendu en terre ; les six hommes masqués ne bougeaient pas. Mais, au moment où le cercueil balancé pendait au-dessus de la fosse béante, ils étendirent leurs mains. La corde qui avait commencé de glisser s’arrêta. Et, pendant que ces six mains aux bagues de fer restaient étendues dans l’attitude du serment, une voix, qui sortait on ne sait d’où, prononça ces paroles :
« – Nous donnons sept ans de notre vie à la vengeance de notre maître... La terre sainte ne recouvrira le corps de notre maître que quand son assassin aura payé la dette du sang ! Ceci est promis sous serment en présence de Jésus crucifié.
« Les six têtes masquées s’inclinèrent. La foule s’écoula terrifiée, tandis que les grandes orgues de l’église disaient le chant lugubre du Dies irae.
« Le lendemain, le palais du duc de l’Infantado et la maison de Francavilla étaient la proie des flammes. Huit jours après, on aurait vainement cherché, dans le Martorello désert, la trace du village florissant qui s’élevait autour des forges. Les forges furent détruites parce qu’elles étaient devenues l’héritage de Giacomo Doria. Giacomo Doria et son fils Lorédan étaient soupçonnés d’avoir mené tout cet infâme complot. Mais Manuele ne les accuse pas. Manuele affirme, au contraire, que Giacomo Doria, et surtout Ferdinand de Bourbon, mirent tout en oeuvre pour trouver le traître et venger l’assassinat. Il ajoute que, si jamais un Monteleone se présentait à la cour, il serait le premier du royaume. Manuele doit savoir...
« Maintenant, voici ce qu’on dit : Les compagnons du fer jurèrent la vendetta et gagnèrent la montagne. Les six chevaliers, parents ou amis de Monteleone, avaient pris la carabine : ils étaient bandits.
« – On dit encore que, chaque année, au jour même où nous sommes, le 15 d’octobre, les cloches del Corpo-Santo tintent le glas funèbre, et que la nef sombre s’emplit de mystérieux fidèles. C’est le service anniversaire de Mario Monteleone, qui n’est pas encore vengé...
Julien se tut. La voiture atteignait péniblement l’extrême sommet de la côte, et prenait un détour pour descendre au pont de la Brentola. M. David toussa, s’étira, bâilla, et quitta enfin sa posture nonchalante. Il regarda l’heure à sa montre.
– C’est une étrange histoire, cela, mon jeune seigneur, dit-il en fixant tout à coup sur Julien ses yeux, qui paraissaient plus perçants sous l’ombre de ses épais sourcils.
L’étonnement fit tressaillir Céleste.
– C’est une histoire que tout le pays sait, repartit Julien.
– Et ce Manuele, reprit M. David, était au Martorello quand eurent lieu ces événements extraordinaires ?
Julien fut un instant avant de répondre. Sa physionomie, tout à l’heure si douce, avait une expression d’ombrageuse fierté.
– Seigneur, dit-il enfin, ce Manuele doit nous attendre sur la route à quelques pas d’ici... Les détails que je n’ai pu fournir à ma jeune soeur, vous pourrez les lui demander.
M. David jeta vers le bas de la route un coup d’oeil rapide et inquiet. On eût dit, en vérité, qu’il craignait d’y apercevoir quelque effrayante vision. Mais la route était déserte ; il se remit et grommela :
– En somme, cela ne me regarde guère !
III
Sur la grand-route
Désormais, Julien et Céleste étaient muets. M. David reprit d’un air dégagé :
– Chaque district de ce bon pays a sa lugubre histoire... On ferait une ballade, en vérité, avec ces chevaliers du charbon et du fer !... Il y a aussi les Compagnons du Silence !... Tout cela sonne très bien et donne la chair de poule aux petits enfants. Un peu plus haut dans la montagne, mon jeune cavalier, je vous engage à conter à votre charmante soeur les faits et gestes du Porporato... Vous avez ouï parler de lui, j’en suis sûr ?
– Je sais, comme tout le monde, répondit Julien sèchement, que c’est le nom d’un bandit.
– Mais quel bandit ! se récria M. David d’un ton railleur, Fra-Diavolo ressuscité ne lui atteindrait pas à la cheville !... Ah ! ah ! mon jeune cavalier, ceci est un bon pays, un excellent pays pour ceux qui aiment les contes de vieilles femmes. Nos Calabres défrayent l’univers entier de brigands d’opéra-comique. Mais, depuis qu’on a inventé le brigand calabrais, il n’y en a pas encore eu d’aussi illustre que ce splendide coquin de Porporato. Nos bourgeoises sont folles de lui et nos marquises en rêvent.
Il haussa encore les épaules, comme c’était, à ce qu’il paraît, son geste favori, et se renfonça dans le coin du carrosse.
Dans le cabriolet, le nouveau marié, Battista Giubbetti, répondait de son mieux aux questions de son mystérieux compagnon, dont les manières lui inspiraient une certaine frayeur. Par hasard, l’entretien roulait aussi sur le brigandage.
– Alors, on s’entretient volontiers du Porporato sur ces routes ? disait Athol.
– On ne parle que de lui, Excellence, repartit le véturin.
– Et que dit-on du Porporato ?
– On dit qu’il est terrible et fort comme le tonnerre du ciel, beau comme un ange, plus brave et plus généreux qu’un lion !
– Bah ! murmura en souriant le jeune voyageur ; vous autres, Calabrais, vous dites cela de tous vos bandits !
– Depuis le temps de Rinaldini, qui n’était pas le fils d’un homme, reprit le véturin avec une gravité convaincue, il n’y a pas eu dans toute l’Italie un cavalier pareil au Porporato !
– Est-ce qu’il est venu parfois dans ce pays ? demanda Athol négligemment.
– Seigneur, je ne l’ai jamais vu, répondit Battista ; mais je ne puis dire qu’il n’y soit point venu. Vous savez mieux que moi ce qu’on donnerait à Naples à celui qui apporterait sa tête.
– Juste quarante mille ducats, répliqua le jeune voyageur.
Battista cligna de l’oeil.
– C’est écrit, dit-il, sur les pancartes, mais allez seulement au directoire de la police, et dites : « Combien me donnerait-on en sus de la prime si j’apportais la tête du Porporato ? »
– L’ami, interrompit le chevalier, vous êtes un gaillard instruit dans les affaires. Est-il jeune, ce Porporato ?
– Tout jeune.
– Je voudrais pourtant bien savoir où il se tient, ne fût-ce que pour l’éviter.
– Seigneur, tout le royaume de Naples est son domaine ; il a levé des contributions sur le plateau des Abruzzes, et jusque dans les États de notre saint-père. Mais son château doit être plus près d’ici, puisque la chanson dit...
– Ah ! fit Athol en riant, il y a une chanson !
Il y en a cent !... Mais celle dont je vous parle ne se chante que depuis le dernier printemps :
Quand la fille de l’intendant de Cozenza
Veut voir son bel ami de la montagne,
Elle met un voile blanc à sa fenêtre
Et le son du cor lui dit où est Porporato !
– Peste ! s’écria le voyageur ; mais cela ressemble comme deux gouttes d’eau aux histoires de Zampa !... Je parie que ce Porporato joue de la guitare !
Chaque pays a la bizarrerie de son orgueil. Le Calabrais défend ses brigands avec le même respect que met le fils de Marseille à adorer sa Cannebière.
– Seigneur, répondit le véturin d’un air piqué, je ne sais pas s’il joue de la guitare ; mais je voudrais voir un railleur en face de lui, à cent pas, quand il descend dans la plaine avec sa carabine rayée d’or... Je mets cent carlins (et je ne suis pas riche) que le railleur ôterait son chapeau !...
– Là, là, Battista mon garçon, fit le voyageur, ne te fâche pas... Tu as peut-être raison... Je ne te demande plus qu’une chose : ce Porporato est-il un des Six ?
– Si vous êtes maître, répliqua le véturin, comment pouvez-vous ignorer cela ?
– Je l’ignore ; je suis maître et je t’ordonne de me répondre !
Athol avait repris son regard impérieux.
– Eh bien, repartit Battista, on l’a cru là-bas, à la ville... Mais, au moment où l’on a promis les quarante mille ducats, on a envoyé le signalement... et le signalement dit que le brigand Porporato est âgé de vingt-deux ou vingt-trois ans. Le moins vieux de nos seigneurs a dix ans de plus que cela.