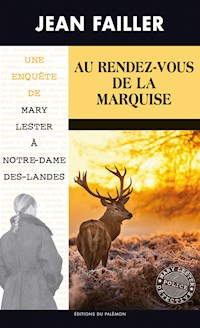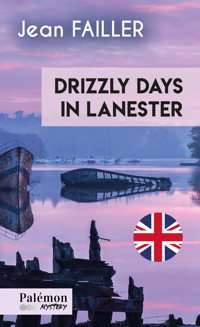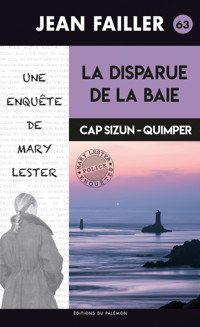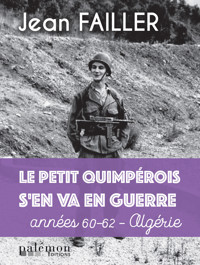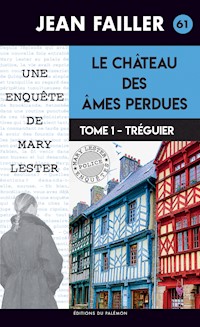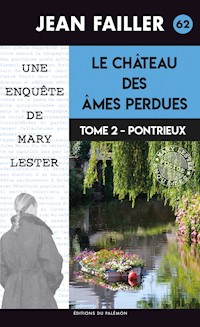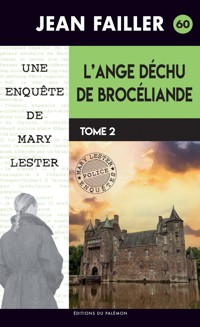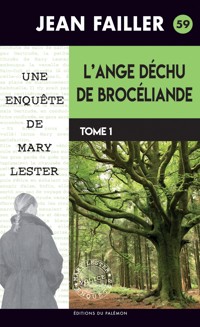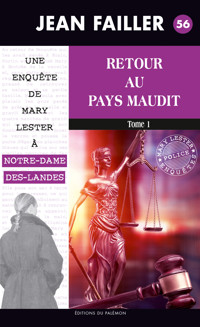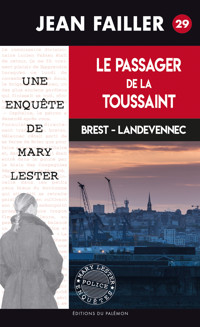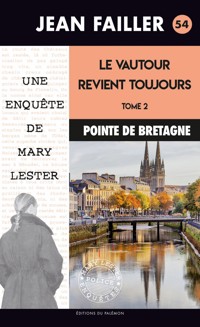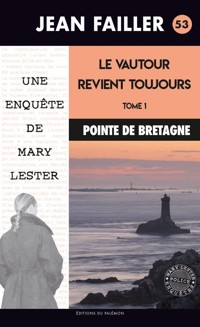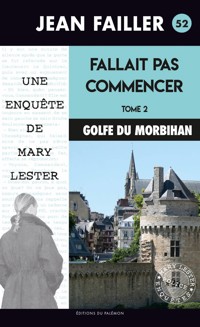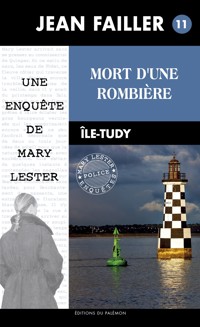
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Palémon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Les enquêtes de Mary Lester
- Sprache: Französisch
Un meurtre sordide trouble la tranquillité d'un petit bourg de Bretagne...
L'Île-Tudy, petit village de pêcheurs à l'embouchure de la rivière de Pont L'Abbé à la pointe sud de la Bretagne. Un lieu paisible s'il en est. Son port abrite désormais plus de bateaux de plaisance que de pinasses sardinières et les maisons de pêcheurs « pied dans l'eau » ont, pour la plupart, été rachetées par des estivants.
C'est dans ce pays de la douceur de vivre qu'une vieille femme, Annette Bonnetis, a été sauvagement assassinée. Les gendarmes ont tôt fait d'arrêter un coupable « idéal » que tout accuse.
Mais Mary Lester, en se penchant sur l'étonnante personnalité de la victime, va faire des découvertes bien surprenantes...
Plongez avec Mary Lester dans une enquête insolite au cœur d'un village de pêcheurs !
EXTRAIT
"Mary Lester arrivait sans se presser au commissariat de Quimper. En ce matin de mars, les eaux de l’Odet, ce fleuve côtier qui traverse la ville, étaient encore troubles des pluies de la veille, mais il y avait du printemps dans l’air. On sentait que les fleurs des marronniers étaient prêtes à faire éclater les gros bourgeons vernissés qui les comprimaient encore et qu’il ne s’en faudrait désormais que de deux ou trois journées de soleil pour que la nature se manifeste avec exubérance.
Elle s’attarda quelques instants à contempler les magnolias centenaires penchés sur l’eau qui donneraient sans tarder, pour l’enchantement des passants, une extraordinaire floraison blanche et rose."
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Ce fut un plaisir de retrouver l'écriture imagée et dynamique de Jean Failler. J'aime la fluidité de ses histoires et son amour non dissimulé de la Bretagne. Une lecture agréable." - Blog Lunazione
"Dans cette nouvelle enquête, l'on part sur l'Ile-Tudy, presqu'île de tradition et de pêcheurs qui a bien changée avec les années, où a été sauvagement assassinée une vieille dame excentrique." - LunaZione, Babelio
"Un très bon polar !" - Shelton, Critiques libres
"Habile, têtue, fine mouche, irrévérencieuse, animée d'un profond sens de la justice, d'un égal mépris des intrigues politiciennes, ce personnage attachant permet aussi une belle immersion, enquête après enquête, dans divers recoins de notre chère Bretagne." - Charbyde2, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Cet ancien mareyeur breton devenu auteur de romans policiers a connu un parcours atypique !
Passionné de littérature, c’est à 20 ans qu'il donne naissance à ses premiers écrits, alors qu’il occupe un poste de poissonnier à Quimper. En 30 ans d’exercice des métiers de la Mer, il va nous livrer pièces de théâtre, romans historiques, nouvelles, puis une collection de romans d’aventures pour la jeunesse, et une série de romans policiers, Mary Lester.
À travers Les Enquêtes de Mary Lester, aujourd'hui au nombre de cinquante-neuf et avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus, Jean Failler montre son attachement à la Bretagne, et nous donne l’occasion de découvrir non seulement les divers paysages et villes du pays, mais aussi ses réalités économiques. La plupart du temps basées sur des faits réels, ces fictions se confrontent au contexte social et culturel actuel. Pas de folklore ni de violence dans ces livres destinés à tous publics, loin des clichés touristiques, mais des enquêtes dans un vrai style policier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean FAILLER
Mort
d’une
rombière
éditions du Palémon
ZA de Troyalac’h
10 rue André Michelin
29170 St-Évarzec
Ce livre appartient à
xxxxxxexlibrisxxxxxx
Remerciements à :
Pierre Deligny - Nicole Gaumé
Danièle Humblot
Bibliographie :
« L’Île-Tudy » par Serge Duigou - Éditions Ressac
« Les marins de l’An II » par Serge Duigou - Éditions Ressac
Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
ISBN 978-2916248-06-4
La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, de l’éditeur ou de leurs ayants droit ou ayants cause, est illicite (alinéa 1er - article 40).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. 2011/© Éditions du Palémon.
Retrouvez les enquêtes
de Mary Lester sur internet :
http://www.marylester.com
Éditions du Palémon
ZA de Troyalac’h - N° 10
Rue André Michelin - 29170 St-Évarzec
Dépôt légal 4e trimestre 1998.
A mes amis de l’Île-Tudy.
Chapitre 1
Mary Lester arrivait sans se presser au commissariat de Quimper. En ce matin de mars, les eaux de l’Odet, ce fleuve côtier qui traverse la ville, étaient encore troubles des pluies de la veille, mais il y avait du printemps dans l’air. On sentait que les fleurs des marronniers étaient prêtes à faire éclater les gros bourgeons vernissés qui les comprimaient encore et qu’il ne s’en faudrait désormais que de deux ou trois journées de soleil pour que la nature se manifeste avec exubérance.
Elle s’attarda quelques instants à contempler les magnolias centenaires penchés sur l’eau qui donneraient sans tarder, pour l’enchantement des passants, une extraordinaire floraison blanche et rose.
Il n’y avait plus que la rue à traverser pour arriver au commissariat. Mary soupira : ce n’était pas un temps à aller s’enfermer dans un bureau! Elle haussa les épaules : le devoir, le travail s’opposant au désir, en cette belle saison, de s’en aller musarder et humer la nature au printemps. A cette heure, ils étaient quelques millions comme elle, sur le point d’entrer au bureau, à l’atelier, à l’usine, qui ressentaient une incoercible envie d’accrocher le boulot au clou… Mais voilà, il faut bien vivre, il faut bien gagner sa croûte. Toujours présente la malédiction biblique : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Elle imagina quelques millions de soupirs poussés à cette heure par quelques millions de poitrines et avança vers le passage clouté.
Le feu était au vert pour les piétons; elle traversa après un dernier regard aux magnolias. Sur le trottoir opposé, un homme la regardait venir vers lui. Un homme dans la cinquantaine avancée, vêtu d’un trench-coat mastic, coiffé d’un feutre beige, fumant une cigarette américaine.
Mary le reconnut, lui sourit :
– Salut, patron.
– Bonjour, jeune et jolie personne…
Elle sourit plus largement. Depuis son entrée dans la police, elle n’avait travaillé que sous une hiérarchie masculine, pas toujours bienveillante, qui la considérait trop souvent comme une intruse ou alors, qui se ridiculisait en compliments éculés dans le but de la draguer.
Le commissaire Fabien n’avait aucun de ces travers. Nonobstant cet uniforme de flic de cinéma des années trente qu’il se croyait obligé d’arborer, il avait des manières fort civiles et plus aucune prévention contre l’entrée des femmes dans la police.
Plus aucune depuis qu’il connaissait Mary Lester, depuis qu’elle avait débrouillé brillamment des affaires confuses où des hommes dits d’expérience s’étaient allégrement « emmêlés les pinceaux ».
– Je vous ai vu admirer les magnolias, dit Fabien. Ils vont bientôt fleurir.
Mary tira la lourde porte métallique armée de verre incassable et s’effaça pour laisser passer le commissaire.
– Eh oui! dit-elle, c’est le printemps!
Le commissaire s’arrêta dans le hall, rendit leur salut aux gardiens présents :
– Comme vous dites ça! fit-il. On dirait que ça vous chagrine.
– Oh non! bien au contraire. Ce qui me chagrine, c’est de devoir être enfermée avec un ciel pareil.
Et elle regardait, à travers les vitres poussiéreuses du poste, l’azur sans nuage.
– Enfin…
Elle s’engagea dans l’escalier qui menait à son bureau, tandis que Fabien consultait la main courante, ce registre où les « nuiteux » consignaient les incidents survenus pendant leur garde. Rien n’ayant retenu son attention, il emprunta à son tour l’escalier pour gagner son poste de commandement, au premier étage.
•
Fortin avait précédé Mary Lester dans le petit bureau qu’ils partageaient, à quelques portes de celui du patron. Il accomplissait son premier travail de la journée, c’est-à- dire qu’il lisait l’Équipe, le quotidien sportif nécessaire à son équilibre.
Mary ne se souvenait pas d’être entrée dans ce bureau sans voir Jean-Pierre Fortin derrière son journal étalé sur sa machine à écrire. Elle se demandait bien ce qu’on pouvait trouver de si passionnant aux dernières frasques de Cantona ou aux tendinites des rois de la raquette, mais enfin, il en faut pour tous les goûts.
Jean-Pierre Fortin, « le petit Fortin » comme disait le commissaire Fabien que le lieutenant dominait d’une tête et demie, était un bon camarade, un grand costaud sans malice qui se serait jeté au feu pour « sa » Mary. En tout bien tout honneur. Il vénérait de la même façon son épouse, une blonde un peu mièvre, qui lui avait donné trois bambins adorables; Jean-Pierre Fortin avait des goûts simples et peu d’ambition. Il considérait sa position de lieutenant de police comme tout à fait satisfaisante et il ne lèverait pas le petit doigt pour un avancement qui risquerait de l’envoyer maintenir l’ordre dans quelque banlieue lointaine et mal famée.
D’aucuns disaient que c’était un parfait imbécile, d’autres le voyaient comme un sage. Chacun regarde avec ses yeux et après tout, c’était l’affaire du citoyen Fortin. Il n’était pas de l’étoffe dont on fait les révolutionnaires, les syndicalistes, et encore moins les commissaires.
– Alors, Jipi (c’est ainsi qu’elle surnommait son équipier, en anglicisant ses initiales), il paraît que tu te la coules douce dans le quartier des halles?
– Tu parles, dit-il en repoussant son journal, ils commencent à me faire ch… ces connards!
– Oh! Jipi, dit-elle avec une sévérité feinte, surveille ton langage!
– Pfff! fit Fortin avec dépit en repliant son journal.
Le printemps avait fait fleurir sur les pavés du centre ville les fleurs colorées et vénéneuses des coiffures « punk »; en groupes, ces marginaux pratiquaient, à l’aide de chiens aussi mal embouchés qu’eux, une manche agressive qui faisait fuir le chaland et désespérait le commerce local. Fortin avait été chargé, avec deux îlotiers motorisés, de mettre un peu d’ordre là-dedans.
Il s’acquittait au mieux de cette tâche ingrate, mais avait la pénible impression, comme il disait, qu’« on lui avait donné pour mission de conserver de l’eau dans une passoire ». En effet, les voyous embastillés le soir étaient relâchés au matin et le pauvre Fortin se retrouvait, jour après jour, avec les mêmes problèmes posés par les mêmes voyous.
– Et tu comprends, disait-il à Mary, en plus ils se foutent de ma gueule! Ah, si je ne me retenais pas…
Et il agitait des mains comme des battoirs, qui, quand il les refermait, se transformaient en poings monstrueux.
Mais il se retenait, le brave Fortin. Comme tous les costauds, c’était un gars placide et, en sa présence, les « petits cons » abusaient de sa faiblesse.
Mary se laissa tomber sur sa chaise, ouvrit un tiroir, en sortit une liasse d’imprimés et soupira :
– Et moi, si je ne me retenais pas, je t’enverrais ces paperasses…
Fortin ne sut jamais où Mary aurait envoyé lesdites paperasses. La porte s’ouvrit, le commissaire Fabien entra.
– Ah! dit-il en voyant les formulaires sur le bureau de Mary, mes statistiques sur la petite délinquance!
Mary le regarda de biais et souffla entre ses lèvres d’une façon expressive.
– Toujours fâchée avec les formulaires de l’administration, à ce que je vois, dit le commissaire. Allez, prenez tout ça et venez avec moi.
Mary et Fortin se regardèrent : qu’est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Elle prit la liasse sous son bras et suivit le patron sans piper mot.
Dans le couloir, Fabien ouvrit une porte à la volée et s’exclama :
– Tiens, Bredan, du courrier pour toi!
Et à Mary, montrant le bureau encombré de Bredan :
– Posez ça là!
Bredan était le lieutenant le plus ancien de la maison. Il attendait paisiblement la retraite en s’occupant de la partie administrative du commissariat. Désormais, c’était l’affaire de quelques mois. La dernière fois qu’il avait dû aller sur le terrain, c’était lors de l’affaire Altobello, en l’absence du commissaire Fabien. Il en avait ramené quelques chevrotines dans les fesses et un ardent désir de ne plus jamais sortir dans ce monde hostile. Il grogna, on ne pouvait savoir si c’était de plaisir ou de déplaisir, Fabien ne s’attarda pas à le lui demander, il fonçait vers son bureau.
Sur le sous-main de buvard vert, des photos.
– Asseyez-vous, Lester.
Mary obéit docilement. Il lui tendit les photos.
– Regardez ça!
Elle lui prit la liasse des mains et, à la vue du premier cliché, sa bouche se pinça. C’étaient des photos en noir et blanc, format 18x24. On y voyait un corps étendu sur un plancher, un corps de femme, de vieille femme. Elle reposait face contre terre, la bouche ouverte, un œil ouvert. Un œil fixe, horrible, dont on ne voyait que le blanc. Le photographe avait pris plusieurs clichés, dont un gros plan du visage qui était strié d’ecchymoses. L’œil, désorbité, pendait sur une joue maculée de sang. Devant cette vision d’horreur, son nez se plissa et elle détourna son regard.
Enfin, elle reposa les photos sur le bureau et leva les yeux sur le commissaire qui jouait avec une cigarette.
– Ben dites donc… Pas la peine de demander si elle est morte.
– Pas la peine, en effet.
– C’est pas joli joli! dit-elle, encore sous le coup de l'horrible vision.
Fabien récupéra les photos.
– Comme vous dites.
– C’est qui?
– Une rombière!
– Pardon?
La cigarette se rompit entre les doigts du commissaire, du tabac tomba sur le sous-main. Il le balaya d’une paume impatiente.
– Une vieille femme de l’Île-Tudy.
– L’Île-Tudy, s’exclama Mary, mais c’est tout près d’ici!
– Une vingtaine de kilomètres, dit Fabien.
– N’est-ce pas la gendarmerie qui doit s’en occuper?
– Si, mais…
– Mais quoi?
– Le maire s’impatiente.
– Déjà! C’est arrivé quand?
– Hier.
– Eh bien!
– Il faut le comprendre, sa commune tire le gros de ses ressources du tourisme. Avec les vacances qui arrivent…
Elle fit la moue :
– Ne me dites pas qu’il pense que la mort de cette malheureuse femme aura une incidence néfaste sur la fréquentation touristique dans sa commune…
Fabien sourit en levant les épaules :
– Je crains que si.
– Si je me souviens bien, dit encore Mary, l’Île est une station familiale. La plupart des gens qui y résident en été viennent là depuis des années.
– Exact, dit Fabien. Encore qu’il y ait quelques hôtels, des campings…
– Fréquentés eux aussi par des habitués.
– Certes…
Il soupira :
– Quoi que nous en puissions dire, la mairie s’agite. Un crime, vous vous rendez compte? Dans un bled où on peut laisser son vélo dehors toute la nuit sans antivol, où la plupart des habitants ne ferment pas leur porte à clé?
– Bon, mais qu’est-ce que je fais, moi, là-dedans? Je ne vais tout de même pas passer par dessus les gendarmes!
– Il n’en est pas question, en effet. mais, comme c’est plutôt calme ici dans le moment, j’ai pensé que vous pourriez vous rendre sur les lieux pour comme qui dirait prendre le vent.
Il souffla et sourit :
– J’ai compris que vous n’aviez pas une grande envie de rester enfermée. Certes, l’Île-Tudy n’est pas La Baule, mais c’est aussi au bord de la mer.
Pour un peu elle lui aurait sauté au cou :
– Ah! merci, patron!
Assurément, l’ancien port sardinier n’était pas La Baule, mais à ses yeux c’était largement aussi bien.
Elle se leva, puis se rassit :
– Au fait, avec quoi l’a-t-on trucidée, la mémé?
– Une rafale de coups de tisonnier sur la tête.
– On a retrouvé l’arme?
– Oui, sur place.
– Des empreintes?
– Non.
– Le vol est-il le mobile du crime?
– C’est un peu tôt pour le dire, mais le sac de la victime a été retrouvé près d’elle. Y manquait-il quelque chose? Je ne le sais pas encore.
– Avez-vous prévenu les gendarmes de ma présence sur les lieux?
– Non, mais monsieur le procureur va le faire.
– Ah!… monsieur le procureur…
– Pourquoi dites-vous « Ah! monsieur le procureur » sur ce ton?
– Parce que, sauf votre respect, patron, les gendarmes prendront ça beaucoup mieux si ça vient de sa part que si ça vient de la vôtre.
– J’en suis également persuadé, soupira Fabien.
Chapitre 2
Il y avait plus d’un siècle que l’Île-Tudy n’avait plus d’île que le nom. Cette langue de sable posée à l’estuaire de la rivière de Pont-l’Abbé, capitale de la Bigoudénie, sur laquelle vivait depuis des temps immémoriaux une humble population de pêcheurs de sardines et de racleurs de grève, fut reliée au continent quand les usines de conserve s’installèrent sur les lieux de pêche. Puis les marais où pénétrait le flot à la haute mer s’ensablèrent, l’herbe apparut et on y fit paître les vaches. Plus tard, des maisonnettes de vacances poussèrent sur ce sol qui resta malgré tout au péril de la mer. Aux équinoxes, quand l’océan se déchaînait, le fragile cordon dunaire avait bien du mal à contenir les flots. Inéluctablement, quelque jour il céderait et la mer reprendrait ses droits.
Mary avait puisé ces renseignements dans une plaquette écrite par un historien local. Elle arrêta sa Twingo devant la gendarmerie de Pont-l’Abbé. Le gendarme qui l’accueillit avait été averti de sa venue. Il s’agissait de l’adjudant-chef Palud, un solide quadragénaire aux cheveux gris, aux yeux gris, au visage hâlé par une vie en plein air.
Il serra la main de Mary vigoureusement, lui présenta une chaise :
– Asseyez-vous… euh!… mademoiselle.
ll avait hésité à lui donner son grade; Il en était souvent ainsi, on ne donne pas volontiers du « lieutenant » à une frêle jeune fille. Encore s’il s’était agi d’une sorte de garçon manqué, mais il avait devant lui une demoiselle élégamment habillée, une sorte d’étudiante en vacances comme on en rencontre des milliers dans les villes universitaires.
Par ailleurs, il n’était pas sans connaître ses exploits antérieurs. Certains de ses collègues, à Landudec, à Châteauneuf-du-Faou, avaient croisé son chemin et s’en souvenaient.
L’adjudant-chef Palud était donc sur la défensive. Ce qui le rassurait, c’est que jamais le lieutenant Lester n’avait cherché à tirer la couverture à elle comme le font tant d’autres policiers quand leurs enquêtes chevauchent celles des gendarmes.
Néanmoins, il n’était pas à l’aise. Il triturait nerveusement un trombone, le pliant, le dépliant entre ses doigts puissants, si bien que le fil de fer finit par se briser. Il laissa tomber les deux morceaux dans sa corbeille à papier avec un soupir.
– Alors, demanda Mary, où en êtes-vous, monsieur?
Puisqu’il ne lui donnait pas son grade, il n’y avait pas de raison qu’elle lui donne le sien.
– La victime a été identifiée, dit l’adjudant-chef…
Encore heureux, pensa-t-elle, dans un bled qui ne compte pas mille habitants en hiver.
– Il s’agit d’Annette Bonnetis, née Valmont en 1917 à l’Île-Tudy, veuve de Pierre-Jean Bonnetis.
– A-t-elle des enfants?
Le gendarme secoua la tête.
– Non.
– De la famille?
– Non plus.
– Elle a été tuée dans sa maison, je crois.
– Oui. Dans sa cuisine, place des Rougets à l’Île-Tudy.
– Qui a découvert le corps?
– Le chauffeur de taxi.
– Le chauffeur de taxi?
– Ouais, il n’y en a qu’un à l’Île. La vieille dame ne conduisait pas et elle avait l’habitude de faire appel à ses services quand elle devait se déplacer.
– Et elle se déplaçait souvent?
– Aux dires du chauffeur de taxi, quasiment tous les jours.
– Tous les jours? s’étonna Mary. L’Île n’est pas si grande…
– Non, dit le gendarme en levant sur Mary un regard étonné. Sept cent soixante et un mètres sur cent soixante-treize. Minuscule n’est-ce pas? Mais je vous parle de l’époque où elle était véritablement une île, il y a plus d’un siècle de ça. Maintenant une belle route la relie « à la grande terre », comme on disait autrefois. En bref, l’Île n’est plus une île. Et si madame Bonnetis - qui avait tout de même quatre-vingts ans passés je vous le rappelle - voulait se déplacer, il n’est pas étonnant qu’elle ait eu recours à un chauffeur.
Son regard était ironique. Quelle importance que la vieille femme prît un taxi chaque jour? Ce n’était tout de même pas pour ça qu’on l’avait trucidée!
Encore un qui n’est pas curieux, se dit Mary. Enfin…
Le gendarme poursuivit :
– Surpris de n’avoir pas été appelé, Fred Guermeur - c’est le chauffeur de taxi - s’est présenté chez la vieille dame. Après qu’il eut longuement sonné, comme personne ne répondait, il a poussé la porte et a découvert le drame.
L’adjudant-chef ouvrit le dossier, en sortit des photographies en noir et blanc représentant une silhouette de femme allongée par terre.
– Voilà, dit-il.
Mary reprit les photos que Fabien lui avait montrées la veille, les examina de nouveau longuement. Et de nouveau ses lèvres se crispèrent douloureusement devant cette tête martyrisée, cette bouche encore ouverte, cet œil qui pendait, obscène, au bout du nerf optique. Le visage de la vieille femme avait été littéralement martelé à l’aide d’un objet contondant - un tisonnier, on le savait - et il était probable que l’assassin s’était acharné sur sa victime après qu’elle fut morte.
– Ainsi l’arme était restée sur place?
– Oui, dit le gendarme, un tisonnier, une tige de fer assez lourde pleine de sang et de cheveux.
Il grimaça à son tour à l’évocation de ce spectacle peu ragoûtant.
– Des empreintes?
– Pas sur le tisonnier. En revanche, dans l’appartement… Il semble que cette pauvre femme recevait tout le village dans ses murs et que ses visiteurs prenaient un malin plaisir à toucher à tout. Les gars de l’identité judiciaire ont recueilli une sacrée collection d’empreintes de toute sorte.
– Vous pensez donc que le tisonnier a été essuyé.
– Ou que l’agresseur portait des gants…
– Y a-t-il eu vol?
– Apparemment, non. Dans le buffet de la salle à manger il y avait un portefeuille contenant dix mille francs…
– Dix mille francs! s’exclama Mary.
– Et quelques autres billets dans une bourse posée sur la table de la cuisine. Non, le vol ne semble pas être le mobile du crime. D’ailleurs, rien n’était dérangé dans la maison.
Il regarda Mary :
– Ce sont ces dix mille francs qui vous intriguent?
– C’est une somme! Quelles étaient les ressources de cette femme?
– Son mari a été tué au tout début des hostilités, en 40 il me semble. Elle touchait une pension de veuve de guerre.
– Ça suffisait à la faire vivre?
Le gendarme sourit :
– Largement.
Et il ajouta :
– Comme bien des femmes de l’Île, elle allait ramasser des palourdes à la grève à marée basse, puis elle allait les vendre au marché de Quimper.
– Je vois, dit Mary, songeuse.
Et, comme le silence se prolongeait, le gendarme le rompit :
– Je sens que ces dix mille francs vous troublent.
– Un peu, oui. Ça ne vous paraît pas bizarre, à vous, qu’une personne aux revenus modestes ait un pareil magot en espèces chez elle?
– Non, dit le gendarme. Je connais plusieurs personnes âgées qui vivent de façon plus que frugale et qui détiennent pourtant chez elles des sommes considérables. Annette Bonnetis avait quatre mille six cents francs de pension. Je suis à peu près sûr qu’elle n’y touchait pas.
– Mais alors, comment vivait-elle?
Le gendarme sourit :
– Comme vivaient ses parents, comme on vivait ici au siècle dernier : pour les menues dépenses, l’argent des palourdes, des bigorneaux de la grève que l’on va vendre au mareyeur. Pour manger, un cousin, un voisin qui cultive son lopin et lui fournit ses légumes, un autre voisin qui l’approvisionne en poissons. Je suis sûr que de la viande, elle n’en mangeait pas une fois par mois. Une tranche de jambon de-ci, de-là peut-être… Dans le petit jardin, derrière sa maison, il y a quelques poules, des fruitiers en espalier, quelques planches de légumes. Les œufs de ses poules, les fruits du jardin. Du café, du pain et du beurre…
Il regarda Mary en souriant :
– Je sais bien que ça peut paraître incroyable pour une jeune femme comme vous, mais avec leur maigre pension, les dames de cette génération sont nombreuses à avoir des livrets de caisse d’épargne bien remplis. Sans compter les boîtes de biscuits pleines de billets qui dorment dans les armoires, sous les piles de drap.
Il sourit de nouveau :
– Quand elles décèdent, les héritiers ont parfois des surprises.
Il rangea les photos dans la chemise cartonnée, resserra la sangle de toile et la tendit à Mary :
– C’est un double du dossier que j’ai préparé à votre intention.
– Merci, dit-elle. Je crois que je vais aller voir les lieux. A-t-on posé les scellés?
– Pas encore. Nous avons simplement refermé la porte à clé et je laisse un des mes hommes sur place en permanence.
Mary se leva :
– Qu’en pensez-vous, monsieur l’adjudant-chef?
Le gendarme se leva à son tour :
– On a tout de suite pensé à un crime de rôdeur. Et, pour tout vous dire, la rumeur publique a déjà trouvé le coupable : il serait dans un camp de nomades qui stationnent depuis une semaine sur la dune en toute illégalité.
Il fit deux pas dans la pièce, pensif :
– Mais, à mon sens, ce n’est pas la bonne piste : rien n’a disparu. Les gens du voyage traînent derrière eux une réputation de voleurs de poules et il est d’usage, quand ils arrivent quelque part, de leur attribuer tous les chapardages commis dans le canton. Cependant, ce n’est pas leur style. Voyez-vous, mademoiselle Lester, si ces dix mille francs avaient mystérieusement disparu de l’armoire d’Annette Bonnetis, on aurait pu penser que c’était eux. Pénétrer dans une maison sans bruit comme un renard dans le poulailler et repartir avec le butin sans éveiller quiconque, ils en sont capables. Tuer aussi vilainement et partir les mains vides, je n’y crois pas.
– Alors, dit Mary, qui?
Le gendarme leva les yeux au ciel :
– C’est là tout le problème! Nous vérifions, nous interrogeons depuis deux jours, mais pour le moment nous n’avons rien trouvé.
Il ouvrit la porte :
– Et vous, mademoiselle Lester, comment allez-vous procéder?
Il semblait à la fois curieux et méfiant, inquiet et goguenard. Toute sa raison lui disait que cette jeune femme élégante allait se planter, et il était prêt à s’en réjouir secrètement, mais au fond de lui-même une petite voix lui criait : « méfiance! » Et il se méfiait.
•
Mary revint à Quimper par la voie express à une allure record. Le commissaire Fabien était encore à son bureau.
– Ah! Mary, dit-il quand elle entra, vous avez vu les gendarmes?
– J’en viens, patron.
– Et alors?
– Ils ne sont pas très avancés.
– Ah!…
– Pour le moment, ils vérifient… la routine.
– Ouais… Il n’y a probablement rien d’autre à faire.
Il leva les yeux sur Mary :
– Ça vous inspire?
Si elle avait été parfaitement sincère, elle lui aurait dit que tout l’inspirait à partir du moment où elle sortait du bureau et que l’on confiait les statistiques sur la petite délinquance à Bredan. Elle répondit simplement :
– Oui.
– Comment allez-vous procéder?
– D’abord, je vais m’installer sur les lieux.
– A l’Île-Tudy?
– Oui.
– Pourquoi? C’est à un quart d’heure de votre domicile!
– Oui. Mais je serai mieux sur place.
Elle le regarda en souriant :
– Si toutefois vous n’y voyez pas d’inconvénient.
Le commissaire haussa les épaules :
– Que vous habitiez là où ailleurs, que voulez-vous que ça me fasse? Cependant, vous devez bien vous douter qu’il est hors de question que l’administration vous défraye.
– Tant pis, dit Mary. Si je veux avancer, il faut que je sois sur les lieux.
Fabien connaissait trop bien Mary Lester pour tenter de lui faire changer d’avis.
– Comme vous voudrez. A quel hôtel descendrez-vous?
– Je ne sais pas encore, je vais téléphoner. Et puis je vais arriver là-bas comme une touriste. Si vous voulez me joindre, appelez-moi sur mon portable. A plus tard, patron.
Longtemps après que la porte se fut refermée sur elle, le commissaire Fabien demeura immobile, songeur, les yeux dans le vague, un demi-sourire aux lèvres, se remémorant le jour où elle était arrivée dans son commissariat comme stagiaire et, qu’à peine à pied d’œuvre, elle avait fait arrêter et condamner pour assassinat un des notables les plus en vue du département, un notable qui, jusque-là, ne paraissait impliqué en rien dans la mort de son rival.
Il en était passé par toutes les couleurs, lui, Fabien, et avec lui Bredan, son adjoint… Il n’y avait que Fortin qui avait suivi la petite jusqu’au bout, sans états d’âme.
Il soupira et se leva pesamment. Ce jour-là, assurément, le commissariat de Quimper avait touché un drôle de numéro.
Chapitre 3
Mary Lester trouva le gîte et le couvert à l’hôtel du Port, tout simplement. Cet hôtel était situé à l’extrême pointe de l’Île. Ses fenêtres donnaient sur une immense lagune que la marée asséchait et remplissait tour à tour. On lui attribua une petite chambre toute simple, toute propre au second étage de l’établissement.
Elle suspendit ses vêtements dans l’armoire, disposa ses affaires de toilette sur la tablette de verre accrochée au-dessus du lavabo et ouvrit grand la fenêtre. Une bouffée d’air marin pénétra dans la chambre, mêlée des senteurs fortes du varech chauffé au soleil. Elle inspira longuement, avec délice, cette odeur de mer, de sables remués et de fleurs, l’odeur de l’Île…
Sur sa gauche il y avait une petite digue de pierre qui s’avançait dans la mer, une place à usage de parking et, comme dans tous les ports, des bistrots, le Winch, « Chez Paulette, moules frites », « A la Pierre Noire, jeux de boules », des crêperies avec leurs terrasses, l’incontournable pizzeria.
Il y avait même un cinéma, « le Malamok », au premier étage du bistrot de la Pierre Noire.
Mary enfila un jean, un pull marin et une paire de tennis de toile bleue, prit son appareil de photo et s’en fut reconnaître les lieux.Une fourgonnette bleue de la gendarmerie stationnait devant la maison du drame. C’était un immeuble bourgeois à la façade austère, dont les fenêtres étaient occultées par des volets peints en bleu. Au milieu de sa façade, au premier étage, une porte-fenêtre pourvue d’un balcon regardait la mer et la lagune par-dessus les petites maisons de pêcheurs construites au bord de la grève. Cinq degrés de granit menaient à une porte d’entrée, bleue elle aussi, à doubles battants.
Cette maison était posée exactement au cœur de ce qui avait été autrefois l’Île, sur un élargissement de rue qui formait une sorte de petite place en trapèze où stationnaient quelques voitures. De ses fenêtres de façade on pouvait voir la rue principale; la façade arrière, orientée plein sud, donnait sur un jardin entièrement clos de pierres jointoyées, et par-delà ce mur haut de deux mètres, sur la haute mer. Des fenêtres du pignon est on découvrait la grande plage qui s’étendait jusqu’à l’embouchure de l’Odet; quant au pignon ouest, il regardait le port de Loctudy, de l’autre côté de la passe. Une situation idéale pour surveiller l’Île sous toutes ses coutures.
Mary eût parié que cette maison avait été bâtie par un des industriels qui, au début du siècle, avaient exploité des usines sur l’Île.
Maintenant, c’était la maison, mortuaire, de feu la « rombière ».
Elle gravit les cinq marches, frappa à la porte qui s’ouvrit instantanément. Un gendarme se tenait dans l’embrasure, visiblement surpris de voir Mary.
– Mademoiselle?
Mary jeta un coup d’œil derrière elle, la place était vide de toute présence humaine. Elle sortit sa carte de la poche arrière de son jean :
– Lieutenant Lester.
Les yeux du gendarme allaient de la carte à Mary et de Mary à la carte.
– Ah bon! dit-il enfin d’une voix lente.
– On ne vous a pas prévenu de ma venue?
– Si…
– Alors, qu’est-ce qui cloche?
– Rien, dit-il comme à regret.
Il se recula d’un pas et ouvrit la porte :
– Je ne vous voyais pas comme ça.
Elle lui sourit. C’était un jeune gendarme, sûrement pas la trentaine, avec des lunettes aux montures d’acier brillant. Mary eut un mouvement du front vers l’intérieur de la maison :
– On peut?
– Ben oui.
Il s’effaça pour la laisser entrer, referma la porte et alluma la lumière. Le hall ne recevait le jour que par une imposte vitrée au-dessus de la porte d’entrée. Au sol il y avait des dalles de pierre comme on en voit dans les églises. Le gendarme poussa tour à tour des portes de bois sombre qui s’ouvraient à gauche et à droite sur les pièces du rez-de-chaussée, deux pièces austères, sentant le renfermé. D’un côté une salle à manger lugubre, meublée en Henri II, avec une longue table au plateau ciré et des chaises aux dossiers droits qui devaient être d’un parfait inconfort. De l’autre côté, un bureau à l’ancienne mode, à cylindre, avec des classeurs de bois verni plaqués contre les murs lambrissés à mi-hauteur de bois d’un marron presque noir.
Là aussi le gendarme dut allumer l’électricité pour que Mary puisse découvrir cet ameublement, car les volets qui donnaient sur la place étaient fermés.
Derrière le bureau, une cheminée en marbre « pâté de campagne »; au-dessus de l’âtre, une glace au tain piqueté de taches d’humidité; et, de droite et de gauche, accrochées au mur, des photos sépia : un quinquagénaire aux cheveux blancs, à l’air pas commode, campé devant une antique bagnole qui avait dû faire sensation dans l’Île à l’époque. Il posait comme on savait le faire en ce temps-là, une main sur le volant, l’autre sur la portière entrouverte, la bottine droite reposant sur un marchepied où s’encastrait la roue de secours. Et un air de propriétaire, un air de dire « c’est à moi, ça! » Et une mâchoire à mordre quiconque aurait eu l’impudence d’en douter.
Mary hocha la tête, pensive.
Sur une desserte d’ébène, dans un sous-verre, une autre photo, de famille celle-là : le même homme et sa descendance, quatre enfants dont deux en bas âge vêtus de costumes marins. L’un tenait par le mât un petit bateau à voile, l’autre fixait le photographe, la main sur un cerceau plus grand que lui, sans perdre un pouce de sa taille. Il avait déjà la bouche dure de son père, une bouche d’adulte imbu de sa position sociale. Les deux autres étaient des adolescentes un peu mièvres qui se ressemblaient étrangement, et puis la mère, coiffée d’un invraisemblable chapeau orné d’un oiseau naturalisé, serrée dans une sorte de redingote close par un chapelet de petits boutons de jais remontant jusqu’au cou. Était-ce cet inconfortable vêtement qui lui donnait l’air malcommode? Car pour avoir l’air malcommode, elle avait l’air malcommode!
« Pas baisante », la vieille, aurait dit Fortin qui avait un langage simple et de son époque.
Et Mary aurait pu lui répondre :
– Pas baisant le vieux non plus!
Assurément pas des gens avec lesquels on avait envie de nouer des liens d’amitié. Des bourgeois d’un autre temps, heureusement révolu. Des bourgeois parfaitement adaptés à ce cadre dans lequel ils avaient vécu, dans ce cadre où pas un citoyen de 1997 n’eût pu passer une nuit sans faire de cauchemars.
D’ailleurs, il était visible que personne ne vivait dans ces deux pièces. Elles sentaient le renfermé. Pourtant elles étaient parfaitement entretenues. Le parquet de chêne sombre brillait et il n’y avait pas la moindre poussière sur les meubles cirés.
– Humph… fit le gendarme en se grattant la gorge.
Trouvait-il que Mary consacrait trop de temps à ces vieilles photos? Pourtant, comme elles étaient révélatrices!
Elle se tourna vers lui.
– Madame Bonnetis ne vivait pas ici, dit-il.
Et, comme s’il craignait de s’être mal exprimé :
– Je veux dire dans ces locaux…
Elle hocha la tête d’un air entendu : elle s’en serait doutée.
La grande maison comportait quatre pièces au rez-de-chaussée. Les pièces d’apparat, en façade comme il se doit, et, derrière la salle à manger, une cuisine qui, elle, ouvrait ses fenêtres sur le sud. Ici la lumière pénétrait à flot et ce n’était pas une cuisine vieillotte, comme on aurait pu s’y attendre, avec cuisinière à charbon et chauffe-eau à gaz au-dessus d’un évier jauni, mais une cuisine moderne, presque une cuisine de catalogue, avec tous les appareils électroménagers dernier cri et des éléments d’un jaune éclatant, d’autant plus éclatant que le soleil les illuminait, et que l’on venait des pièces sombres et froides de la façade nord.
Au sol, un linoléum imitant un carrelage à l’ancienne, marqué de traces à la craie.
– C’est là qu’était le corps, dit le gendarme.
Mary fit quelques pas dans la pièce.
– Vous êtes arrivé le premier sur les lieux?
– Oui, avec l’adjudant-chef Palud. Guermeur, le taxi, nous a téléphoné et nous sommes venus aussitôt.
– Il n’y avait pas de traces d’effraction?
– Non. La porte n’était pas fermée à clé. A ce que nous a dit Guermeur, madame Bonnetis ne mettait pas le verrou dans la journée.
– Ce Guermeur, il n’a touché à rien?
– A part la porte d’entrée, non.
– Et rien n’était dérangé?
– Non. C’était comme ça.
De la main il montrait la pièce parfaitement en ordre. Il ajouta :
– A part le corps, bien sûr…
– Qu’y a-t-il dans l’autre pièce?
– Un bureau. Madame Bonnetis avait sa chambre à l’étage.
Quand le gendarme avait parlé de bureau, Mary s’était attendue à voir le pendant du local qu’elle venait de visiter, avec un meuble à cylindre, à tiroirs secrets. Rien de tout ça : elle entra dans une pièce claire, dont les murs tendus de tissus grèges mettaient en valeur les belles toiles qui y étaient accrochées. Des scènes de la vie maritime, des thoniers rentrant au port de Concarneau avec leurs voiles ocre, une chaumière au bord d’une rivière bretonne, des bigoudènes brûlant du goémon sur la dune, près de la chapelle de la Joie à Penmarc’h. Trois toiles magnifiques signées Lionel Floch, Barnouin, Lucien Simon. Des œuvres de prix. Sur une large table de merisier ciré, un sous-main de buvard vert, un téléphone blanc, un Minitel, un bol en faïence de Quimper dans lequel étaient fichés crayons et stylos et, dans un cadre, une photo, celle d’un couple posant en tenue de noce : une jeune et jolie femme en coiffe de l’Île, tenant par le bras un costaud à la moustache avantageuse qui fixait l’objectif d’un œil fier.
Les parents d’Annette Bonnetis, probablement, tout à leur bonheur. Un bonheur qui allait être bien éphémère, hélas! Elle prit la photo, lut la date au dos : 16 avril 1917. François Valmont n’avait pas survécu un an à cette photo. Et la petite Annette n’avait jamais connu son papa.
Mary reposa la photo sépia sur la table, songeuse.
Derrière la table, sur un meuble adapté à ces multifonctions, un télécopieur, une photocopieuse, un ordinateur et son imprimante, une machine à déchiqueter les documents. Contre les murs, des classeurs métalliques blancs eux aussi, et un gros coffre-fort vert bronze. Une belle bibliothèque également en merisier, aux portes vitrées, abritant des livres soigneusement alignés. Ce n’était pas une lecture frivole, il s’agissait de la collection Dalloz traitant de matières ingrates. Elle lut quelques titres sur le dos des bouquins : « Droit des Sociétés », « Droit du travail », « Imposition des plus-values boursières » et n’alla pas plus avant. Ce n’est pas à feu la rombière qu’elle emprunterait son prochain livre de chevet.
La pièce était dans un ordre parfait, les meubles de bois blond brillaient, éclairés par la grande fenêtre qui s’ouvrait sur le jardin, et on sentait vaguement l’odeur de cire d’abeille dont ils avaient été consciencieusement frottés.
Mais d’abord, que faisait madame Bonnetis dans ce bureau ultra-moderne? Mary se tourna vers le gendarme qui attendait patiemment :
– Ça correspond à quoi tout ça?
– Tout ça quoi?
– Eh bien! ce bureau, cet ordinateur, ces bouquins de droit fiscal!
– Je ne sais pas, dit le gendarme.
– Qui est-ce qui travaillait là-dessus?
A nouveau le gendarme leva les yeux au ciel en signe d’ignorance.
– Ce n’est tout de même pas cette vieille femme, bougonna Mary. Elle avait quatre-vingts ans, n’est-ce pas?
– Passés.
– Plus de quatre-vingts ans, reprit-elle. Qu’est-ce qu’on connaît à l’informatique à quatre-vingts ans?
Elle regarda le gendarme qui ne répondait pas :
– Vous vous y connaissez, vous, en informatique? Au fait, quel est votre nom?
– Mourier, lieutenant, brigadier Mourier.
– Et alors, Mourier, vous vous y connaissez ou non?
Le gendarme paraissait gêné. Que signifiaient ces questions et qu’est-ce que ça pouvait lui faire, à cette souris, qu’il connût ou pas l’informatique. Il finit par répondre, lentement :
– Non, lieutenant.
Mary passa derrière le bureau, ouvrit le tiroir. Il contenait un coffret de cigares en bois exotique, une boîte d’allumettes grand modèle, un coupe-cigares.
– Des havanes, dit Mary. Qui pouvait bien fumer ces cigares?
A nouveau le brigadier eut une moue d’ignorance. Mary referma le tiroir.
– Bon, on verra ça plus tard.
Elle tira la porte du coffre qui était entrebâillée :
– Il y avait quelque chose là-dedans?
Le gendarme secoua la tête négativement :
– Rien. La clé était sur la porte qui était grande ouverte.
– Pas d’empreintes non plus?
– A part celles de madame Bonnetis, non.
– Bizarre, dit Mary.
Elle regarda le jeune gendarme :
– Vous ne trouvez pas?
Il haussa légèrement les épaules, embarrassé, comme si c’était la première fois qu’on lui demandait son avis.