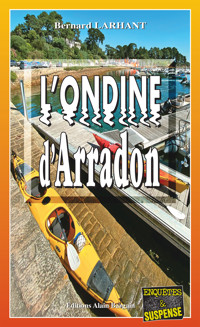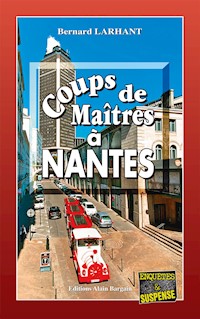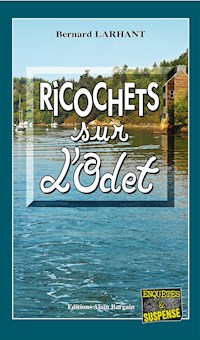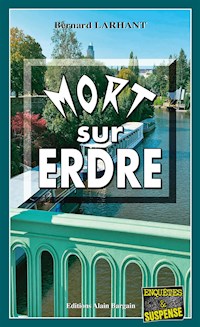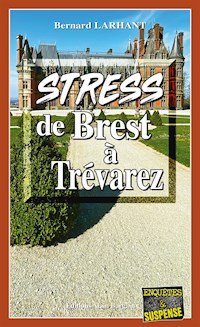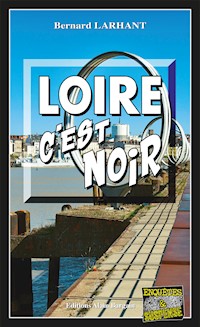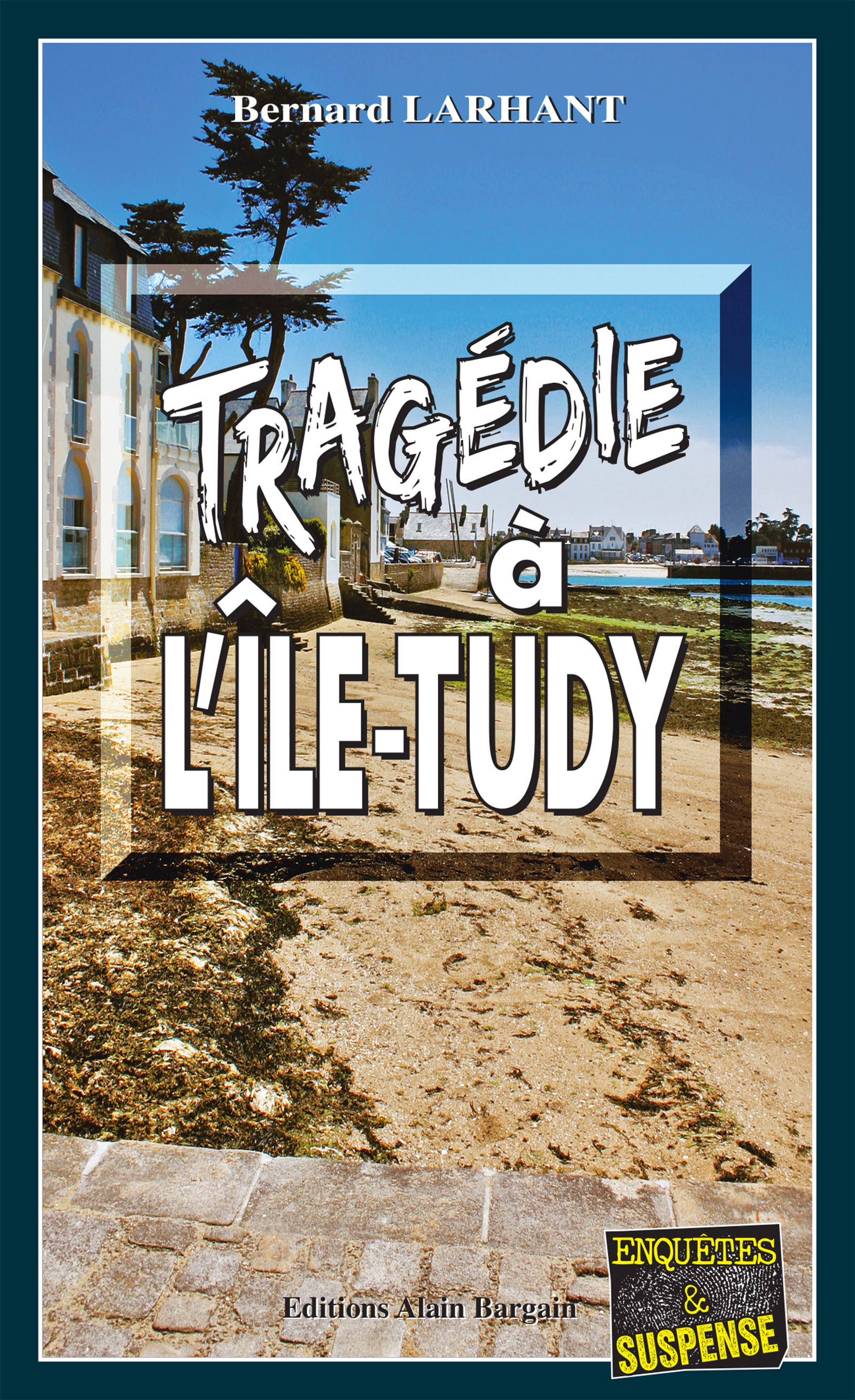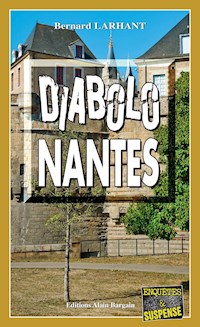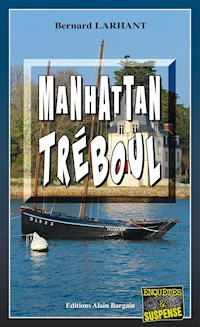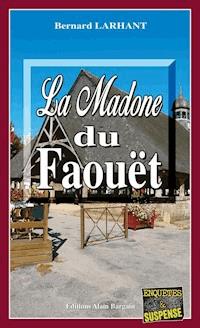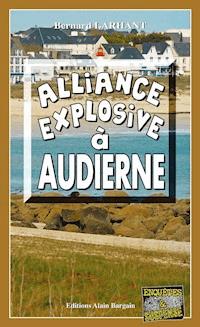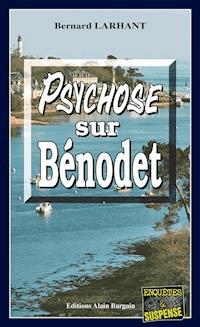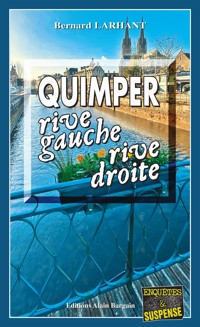
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Krimi
- Serie: Capitaine Paul Capitaine
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Alors qu’il revient du Liban, Paul est mis en éveil sur une possible erreur commise par Sarah et les magistrats. Un clochard est accusé du meurtre sordide de l’épouse d’un homme d’affaires quimpérois.
Pour alibi, ce clochard assure qu’il n’est pas le coupable, malgré les preuves, car il ne franchit jamais l’Odet pour fréquenter sa rive droite : ça lui porte malheur.
C’est maigre, mais suffisant à Paul pour tenter de réveiller Sarah en la plaçant devant les invraisemblances de son dossier. Dès cet instant, les pistes de nouveaux suspects se multiplient, plus tordues les unes que les autres.
Qui pouvait en vouloir à Ravindra, jeune indopakistanaise venue trouver l’amour en Bretagne, pour lui infliger dix coups de couteau dans le ventre ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Bernard Larhant est né à Quimper en 1955. Après un premier roman intimiste, il se lance dans l’écriture de polars avec les enquêtes bretonnes d’un policier au parcours atypique, Paul Capitaine, épaulé par sa fille Sarah.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
REMERCIEMENTS
À André Morin, pour ses remarques d’ancien enquêteur, même si ce livre reste un roman.
À Dominique Descamps, pour sa relecture amicale et attentive.
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
PRINCIPAUX PERSONNAGES
PAUL CAPITAINE : 59 ans, commandant de police, ancien agent des services secrets. Natif de Quimper, il connaît bien la région. Au sein de la PJ, il fait équipe avec Sarah, sa fille. Après des années passées auprès de la magistrate Dominique Vasseur, il vit à présent en solitaire.
SARAH NOWAK : 36 ans, d’origine polonaise, capitaine de police. Elle a découvert en Paul Capitaine le père qu’elle recherchait. Elle a perdu son compagnon Quentin, pompier professionnel, mort en service. Elle se retrouve donc seule pour élever Pauline, leur fille âgée de 3 ans.
ROSE-MARIE CORTOT : 35 ans, d’origine antillaise, enquêtrice de police. RMC pour tout le monde. Un génie de l’informatique. Meilleure amie de Sarah, compagne de Mario Capello, ex-policier devenu détective privé, mère de Théo, plus âgé que Pauline de quelques mois.
BLAISE JUILLARD : 34 ans, célibataire, lieutenant de police. Fils d’un ponte du Quai des Orfèvres, il ne possède pas l’étoffe de son père. Surnommé Zébulon en raison de sa nonchalance, son regard sur les enquêtes est pourtant précieux. Parrain de la petite Pauline.
LAURE BARBOTAN : 35 ans, célibataire, substitute de la procureure. Ambitieuse et besogneuse, libre et spontanée, elle a trouvé en Paul Capitaine un policier aguerri pour apprendre son métier de magistrate.
PROLOGUE
Vendredi 4 septembre, 18 heures, pépinière d’entreprises du pôle de Créac’h Gwen, Quimper
Dans son bureau de ce quartier moderne de Quimper où les entreprises les plus diverses jouxtaient un parc de loisirs de plus de sept hectares, sur la rive gauche de l’Odet, Ravindra Lemay jonglait entre ses téléphones, ses moniteurs d’ordinateurs et leurs claviers. Un œil toujours rivé sur les six horloges murales qui lui faisaient face, aux aiguilles fixées à l’heure des principales places financières de la planète. Elle exerçait une profession qui se développait : gérante de portefeuilles. Elle veillait déjà sur le patrimoine et les investissements d’une vingtaine de clients fortunés de la région. Elle suivait l’évolution du marché dans les principales bourses du monde pour le compte de ces personnes qui, sous mandat, lui avaient confié une partie de leur actif financier, charge à elle de le faire fructifier.
Cela faisait un peu plus de deux ans que Ravindra vivait en France, depuis que le regard de Stéphane Lemay, un séduisant patron de société quimpérois, s’était fixé sur elle pour ne plus la quitter. Cela se passait dans le salon d’un hôtel de Bombay, par une après-midi moite et suffocante, comme le pays en connaît aux périodes des moussons. Stéphane était venu en Inde trouver des partenaires économiques et des appuis financiers locaux pour implanter dans la région une usine de sous-traitance dans les équipements marins. Ravindra faisait partie du staff de la Bank of Bombay, seule femme dans le sillage de quatre hommes, et n’en menait pas large. Elle possédait deux avantages sur ses compagnons, aux yeux du Breton. D’une part, elle maîtrisait parfaitement la langue française ; de plus, elle était divinement belle. D’une douceur qui n’avait d’égale que son grand professionnalisme et aussi sa crainte, si perceptible, d’irriter ses collègues masculins en leur volant la vedette.
Il n’y avait pas d’orage sur la ville, ce fut pourtant le coup de foudre. Le Français engagea le programme industriel à Vadodara, une ville voisine… et très vite, Ravindra, pour en assurer la coordination. Durant six mois, à chaque voyage de l’industriel breton, tous deux apprirent à mieux se connaître. La jeune femme se sentait en confiance et faisait découvrir au visiteur les beautés de l’Inde, ses coutumes et son folklore, sa cuisine aux mille saveurs. Puis un jour, elle le mena vers sa famille, de condition modeste, qu’elle soutenait à bout de bras depuis quelques années. Cette présentation officielle représentait une étape importante dans son pays, quand on envisageait d’entamer une relation durable avec l’une des filles de la maison.
Stéphane parvint à convaincre l’Indo-Pakistanaise qu’ils avaient un avenir ensemble, et plus en France qu’ici. Le chantier de Vadodara achevé, l’usine inaugurée, Ravindra avait accompli sa mission et laissé les rênes à une équipe technique franco-indienne. Dans la foulée, après des adieux familiaux déchirants, elle prit avec Stéphane un vol sans escale pour la France et Roissy-Charles-de-Gaulle. Là, après une petite semaine à découvrir Paris, ses plus beaux bâtiments et musées, ils embarquèrent tous deux pour un trajet plus court en direction du petit aéroport de Quimper-Pluguffan.
Un second envol, à 30 ans à peine, pour une jeune femme aussi volontaire que romantique, avec un mariage de princesse sur les bords de l’Odet, dans l’Orangerie de Lanniron, digne des plus belles romances sorties des studios de Bollywood, et une découverte de la vie française, des beautés de la Bretagne, de ses spécialités gastronomiques, si souvent surprenantes. Avec des perspectives professionnelles indépendantes, même si Stéphane souhaitait la conserver à ses côtés, mais sans jamais insister, ni lui imposer sa vision de leur vie de couple.
Finalement assez rapidement, une fois installée à Quimper, Ravi – comme l’appelaient communément ses proches – s’accoutuma très vite à la vie locale et à son rythme moins affolant que celui de Bombay. Quel changement radical entre la folie quotidienne d’une mégapole de plus de vingt millions d’habitants et la douceur permanente de la capitale de la Cornouaille, avec ses quelque soixante-cinq mille âmes.
Ravi fut adoptée d’emblée par les amis de Stéphane, comme par ses relations professionnelles. Il fallait dire que sa gentillesse et son raffinement sidéraient les plus sceptiques, méfiants face à une Asiatique, par préjugés stupides ou souvenirs d’expériences négatives. À chaque fois, Ravi se faisait l’avocate de son pays pour promettre que les Indiens représentaient des interlocuteurs fiables, dotés de jeunes générations formées à l’occidentale pour s’adapter aux besoins de toutes les entreprises de la planète. Et lorsqu’elle tombait sur un Breton têtu, buté – ça existe, parfois –, l’intéressée ne s’en émouvait pas et distillait ses sourires lumineux et ses doux mots bienveillants pour donner le change.
Oui, Ravi aurait pu se contenter d’un rôle de maîtresse de maison et de conseillère financière de son époux, seulement elle voulait s’assumer, en femme moderne libérée du joug des traditions indiennes de son père et pakistanaises de sa mère, par amour-propre aussi. Une volonté affichée très jeune, sans pour autant couper les ponts familiaux. Elle avait vite compris que le savoir et la réussite sociale lui assureraient indépendance et autonomie. Déjà vis-à-vis de sa famille, mais aussi plus tard face à un époux auquel elle ne voulait pas être enchaînée, même si, à l’époque, elle n’imaginait pas un seul instant qu’il serait Occidental, Français de surcroît. À l’époque, le rêve était souvent un avenir américain pour les jeunes Indiens, ou encore autour de Londres, l’ambition de bien des étudiants du pays.
Elle avait accompli des études dans de prestigieuses écoles indiennes, qu’elle payait en posant pour des photographes sérieux ou en faisant de la figuration dans des films locaux. Elle avait intégré le milieu de la haute finance par la petite porte avant de gravir les échelons sans bruit. Elle se passionnait depuis presque toujours pour les marchés boursiers qui n’avaient plus le moindre secret pour elle. Sans doute par la faute du père d’une amie d’enfance : il exerçait ce métier avec tant de passion et de maestria qu’il l’avait fascinée. Enfin, par sa faute ou grâce à lui, allez savoir ce que lui réservait l’avenir.
Ravi fit d’abord profiter Stéphane de son expertise confirmée, avant d’élargir son talent à ses amis du premier cercle. Tous n’eurent qu’à se féliciter de lui avoir fait confiance. Par son savoir, son nez et sa hardiesse, elle avait singulièrement augmenté les bénéfices de leurs placements financiers. C’est logiquement qu’elle décida donc, un peu plus tard, d’ouvrir une officine, profitant pour ce faire des réseaux relationnels de son époux.
Elle fut accueillie à bras ouverts à la pépinière d’entreprises de Quimper et agrandit un peu plus son carnet d’adresses, tout en répondant favorablement aux sollicitations nouvelles des relations de son mari. Cela marcha si bien qu’elle embaucha très vite deux salariées, des jeunes femmes issues de l’École supérieure de commerce de Brest, nanties d’un mastère en gestion patrimoniale et financière. Comme Ravindra, ces deux jeunes femmes avaient des origines asiatiques, les parents de l’une venant de Chine, et ceux de l’autre, du Vietnam. Une forme de solidarité continentale, en quelque sorte.
Dans l’esprit de Ravi, avec les années qui passaient, elle espérait devenir bientôt maman, même si Stéphane n’était pas vraiment enthousiaste à cette idée, accaparé qu’il était par ses sociétés et ses clients dispersés à travers le monde, dans bien des pays qui possédaient une façade sur un océan. Son épouse espérait que l’idée ferait malgré tout rapidement son chemin avant qu’elle-même ne franchisse le cap de la quarantaine. À 33 ans, elle avait encore de la marge, mais le temps passait si vite…
* * *
Vendredi 4 septembre, 19 heures, Créac’h Gwen
Ravindra s’affairait toujours à son bureau, devant ses ordinateurs. Son mari trouvait qu’elle consacrait trop de temps à son activité et ne savait pas s’arrêter. C’est vrai que, fascinée par son métier si prenant, elle y passerait ses journées entières, puisque la planète boursière tournait jour et nuit. Surtout quand Stéphane se trouvait en déplacement professionnel en Afrique du Sud ou au Brésil, et qu’elle rentrait dans un intérieur vide, sinistre. Une ambition semblable les motivait tous deux, une volonté de réussir, un souci du travail bien fait, aussi se comprenaient-ils parfaitement, même si la Franco-Indienne souffrait bien plus de la situation.
Lorsque son portable retentit, Ravi songea qu’il s’agissait de Stéphane qui piaffait d’impatience, rentré pour sa part au bercail depuis une heure environ. Il venait certainement lui rappeler le dîner prévu à 21 heures en compagnie de Flavien Mirabeau, le meilleur ami de l’homme d’affaires, avocat au barreau de Quimper, et de Lisa, l’épouse de ce dernier, juriste dans un groupe banquier. Comme si son épouse avait un jour oublié un rendez-vous. En jeune femme organisée, elle inscrivait tout sur son ordinateur qui lui rappelait les horaires, sans aucune erreur. Et si ce n’était pas le PC, c’était le téléphone… À l’autre bout du fil, ce n’était pas son mari, comme imaginé, c’était Lisa :
— Je viens de prévenir Stéphane que je ne pourrai pas être des vôtres ce soir ! annonça son amie, d’une voix lasse. Le docteur sort de chez moi, je fais une bonne gastro, un mauvais virus dans l’air, sans doute. Je voulais te prévenir de mon absence, car si nos deux hommes embrayent sur leurs projets en Chine, la soirée risque de se révéler mortelle d’ennui pour toi !
— Tu as raison, je vais appeler Stéphane pour le prévenir que je les laisse en tête-à-tête, d’autant que cela me gênait d’abandonner mon travail, alors que Wall Street bouge bien en cette fin de semaine, et que je flaire de belles opportunités. Je vais m’intéresser à l’évolution de l’après-midi, même si je rentre avant la clôture, pour dormir un peu, quand même…
— Tu es vraiment passionnée par ton job, totalement investie, tu aurais dû te marier avec tes ordis, ironisa Lisa, à moitié sérieuse. Non, ne me dis pas que tu les aimes davantage que ton mari, tout de même !
— Ne sois pas idiote ! s’offusqua Ravindra, de sa voix douce à l’accent si suave, encore peu rompue à l’humour français, avant d’éclater de rire avec sa correspondante. Dis-toi seulement que, pendant que tu te soignes, confortablement allongée sur ton lit, je te fais gagner de l’argent. Tu vas bientôt pouvoir investir dans le spa et le jacuzzi, près de ta piscine ! C’est même sans doute ce qui s’est passé ; grâce à moi, tu t’es goinfrée de dividendes jusqu’à l’indigestion… Elle n’est pas belle, la vie, comme dirait le gamin de la pub ?
— Mais ne tire pas trop sur la corde, toi aussi, insista Lisa, en amie. Je sais qu’il te suffit de quatre ou cinq heures de sommeil pour te récupérer, mais la santé, c’est important. Comme le sport. Tu fais toujours ton jogging quotidien sur les bords de l’Odet ? Non, bien sûr, pourtant c’est important, l’exercice physique, pour le corps comme pour l’esprit. Tes neurones ont besoin de respirer, de s’oxygéner, vois-tu… Bon, je le sais, tu es une grande fille et je ne suis pas ta mère ! Je t’aurais eu à 13 ans, c’est un peu jeune, quand même. Je te laisse devant tes machines ! Bisous, ma belle !
Une fois le téléphone coupé, Ravi mit un certain temps avant de se remettre au travail. Elle pensait aux paroles de Lisa, qui n’étaient jamais totalement innocentes. D’ailleurs, elle avait beaucoup de mal à la cerner, à maîtriser les nuances de son humour si souvent cynique ou caustique, parfois désabusé, au point de se demander si ses paroles n’étaient pas des vérités qu’elle distillait de la sorte, comme un bonbon au piment enrobé de menthe.
Elle n’était pas encore totalement habituée à de tels échanges, mélange de vérités et de balivernes, parfois sincères, parfois convenus. Elle aurait encore gambergé un moment, si les alertes sur ses écrans ne l’avaient ramenée à sa réalité. Ça bougeait devant ses yeux, le monde de la finance ne s’arrêtait jamais. Elle se remit à la besogne, avec avidité et gourmandise. Mais non, elle ne préférait pas ses ordis à son mari, quand même…
* * *
Vendredi 4 septembre, 23 heures
Ravindra Lemay mit en veille ses ordinateurs, elle était satisfaite de sa journée et de ses résultats. Les personnes qui lui avaient accordé leur confiance allaient voir leur portefeuille se gonfler encore un peu plus. Telle était sa plus belle récompense, sa plus grande fierté. Elle enfila sa veste de costume et se regarda dans le reflet de la baie vitrée. Si son père la voyait en pantalon, vêtue à l’occidentale, il s’arracherait le turban, pensa-t-elle en souriant. Elle saisit son sac à main, son attaché-case, éteignit les lumières, ferma la porte de l’officine et se dirigea vers son véhicule, le dernier encore présent sur le parking collectif de la pépinière. La température était agréable, elle appréciait le climat breton, au grand soulagement de Stéphane. Les rafales de vent ne la gênaient pas, ni même les ondées régulières, en certaines saisons. À Bombay, en septembre, s’il faisait plus chaud qu’en Finistère, l’humidité moite rendait si souvent l’atmosphère étouffante. Ici, elle pouvait respirer à pleins poumons.
Elle posa veste, sac et attaché-case sur la banquette arrière de sa petite Corsa et s’installa au volant. Stéphane aurait voulu lui offrir une voiture plus adaptée à leur standing, mais elle ne voulait rien entendre ; selon elle, il fallait vraiment être Occidental pour baser son niveau de vie sur la taille d’un véhicule. Surtout pour une femme…
Mais ce n’était que l’une des coutumes qui, en France, la choquaient un peu et auxquelles elle finissait par s’accommoder, au fil des ans, bon gré, mal gré.
Dès qu’elle tourna la clé de contact, la chaude voix de Norah Jones, sa chanteuse favorite, d’origine indienne elle aussi, emplit l’habitacle, prélude à une soirée de détente. Ravindra ne pouvait s’empêcher de penser en souriant que les gens d’ici lui trouvaient un air de ressemblance avec la fille du maître du sitar, Ravi Shankar. Sans doute la matité de la peau du visage, les longs cheveux et les yeux noirs, car pour le reste… Norah Jones mesurait moins d’1,60 mètre, et Ravindra, une petite dizaine de centimètres de plus, tout de même. De plus, la « néo-Bretonne », comme l’appelait par taquinerie l’ami Flavien, était bien plus svelte, moins en formes, même à son propre goût. Ces considérations physiques permanentes, encore l’une des traditions occidentales qui agaçaient un tantinet l’Indienne, rarement dans la comparaison.
À cette heure de la soirée, la circulation était bien sûr fluide en direction de Locmaria, puis entre l’Odet et le Frugy. La Corsa se trouva rapidement sur l’autre rive du fleuve côtier, passa sur le côté du palais de justice pour rallier la place de la Tour-d’Auvergne qu’elle contourna, comme chaque jour, pour s’enfiler dans la rue Bourg-les-Bourgs, là où le couple possédait un appartement de grand standing, au dernier étage d’un immeuble neuf, de la terrasse duquel il était même possible d’admirer un bout de l’Odet.
Stéphane lui avait bien promis de prospecter pour l’acquisition d’une maison sur la route de Bénodet, pour plus de commodités, seulement il n’avait jamais le temps de se pencher sur cette question, trop préoccupé par l’expansion internationale de sa société. Et quand une opportunité s’offrait à eux, dénichée par son épouse, il se trouvait à l’autre bout de la planète. Quand il était de retour pour la visiter, la perle avait déjà été vendue.
Ravindra se fichait bien de ces considérations matérielles. Le bel appartement avec son équipement moderne, c’était déjà si merveilleux au regard du confort des habitats en Inde, même les plus huppés. D’un autre côté, dans l’esprit de Ravi, l’idée de la maison un peu à l’écart du centre de la ville, c’était en prévision de leur enfant, pour qu’il ait un jardin pour gambader et de l’air pur à respirer. Mais comme le sujet n’était pas à l’ordre du jour, et ce depuis quelques mois, elle avait cessé de consulter les annonces immobilières.
Voilà, elle arriva à destination, tourna sur sa droite et emprunta un petit raidillon étroit pour rallier la résidence. Elle saisit la télécommande qui lui permettait d’actionner le portail du garage souterrain de l’immeuble, attendit un moment avant de pénétrer en ce lieu qu’elle détestait plus que tout. Mal éclairé, bas de plafond, étroit, sinistre. Elle devait être un peu claustrophobe ou impressionnée par quelques séries télévisées, songeait-elle en esquissant un sourire crispé devant sa couardise.
Par chance, ce soir, sa place de stationnement était libre. Ce n’était pas toujours le cas et cela la faisait régulièrement pester. Jamais personne ne se permettrait d’occuper l’emplacement du véhicule de Stéphane, par contre, celui de “l’Indienne”… Tout cela aussi parce qu’elle rentrait souvent très tard et que les gens la pensaient absente. Un manque total de savoir-vivre typique de l’esprit français. D’un autre côté, quand leurs amis venaient les rencontrer, tous râlaient contre l’absence de place pour les visiteurs, un oubli énorme de la part des architectes.
Ravi saisit à la hâte son sac, son attaché-case et sa veste, qu’elle ne prit même pas soin d’enfiler, verrouilla son véhicule et courut vers l’ascenseur, situé à une cinquantaine de mètres. Une fois à l’intérieur de l’immeuble lui-même, à proximité de l’ascenseur, elle se sentit soulagée. Une sensation stupide, alors qu’elle se trouvait dans une résidence sécurisée, une peur infondée dont elle préféra à nouveau sourire. Sans doute quelques souvenirs du manque de sécurité des parkings de Bombay lui restaient en mémoire, songea-t-elle pour trouver une excuse à ses craintes stupides.
Elle appuya sur le bouton de l’ascenseur. Par malchance, la cabine ne se trouvait pas en bas à l’attendre, elle devait même descendre du dernier étage.
Elle s’en voulut de stresser à ce point, tenta de se ressaisir, en pure perte. Soudain, elle sentit une présence dans son dos, puis une main qui se posa sur son épaule. Elle se retourna en poussant un petit cri. Elle n’eut pas le temps de réagir qu’un premier coup de couteau la toucha au ventre, puis un deuxième, un troisième. Ravindra vacilla un moment, avant de s’effondrer sur le béton glacé. Elle sentit ses yeux se voiler, la vie la quitter peu à peu. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, elle savait juste qu’elle allait mourir. Elle tenta vaguement de récupérer son téléphone dans son sac, mais ses dernières forces l’abandonnaient.
Puis plus rien. Juste une ombre contemplant un long corps inanimé dans la pénombre d’un lieu sinistre. Jusqu’à ce qu’elle expire son dernier souffle. La belle histoire de la princesse de Bollywood s’achevait là, dans le sous-sol sinistre d’un immeuble quimpérois, et avec elle, tous les rêves d’une jeune femme sans histoires à qui tout souriait.
I
Lundi 21 septembre, 9 heures, commissariat de police, rue Théodore Le Hars, Quimper
Il est toujours difficile de se remettre au travail, même au ralenti, quand on rentre de l’étranger. Je venais de passer trois semaines au Liban, pour tenir une promesse faite à Condor (Conrad Dormeuil, mon mentor dans les services secrets, assassiné à son domicile avec sa compagne), jeter ses cendres et celles de Zena Labaki dans les eaux de Méditerranée, à partir du port de Byblos. Sarah aurait dû m’accompagner, mais elle n’avait pas voulu abandonner Pauline, déjà en manque de son père, et le périple aurait été trop risqué pour une enfant.
J’avais donc contacté Rebecca, ma “fausse sœur” rencontrée à Rennes et installée à présent à Naplouse, en Palestine, avec Mathieu, son compagnon*. Tous deux avaient ouvert une école accueillant les enfants de la ville, de toutes origines et de toutes confessions, une gageure. C’est avec grande joie qu’ils avaient appris mon projet et l’idée de retrouvailles au Liban.
Voilà comment il avait été convenu qu’ils passeraient me récupérer à l’aéroport Rafic Hariri de Beyrouth et que nous monterions ensemble jusqu’à Byblos, ville du nord du pays. Ce qui avait été fait dans leur imposant van dès mon retour sur le sol libanais. Avec d’abord la joie profonde de retrouver Rebecca, qui s’était installée auprès de moi à l’arrière du véhicule, tandis que Mathieu nous pilotait pour la petite heure de trajet en direction du nord, sur une superbe voie rapide qui longeait la Méditerranée.
Tout ici me rappelait des pages douces et d’autres plus amères, des instants chaleureux et des heures bien cruelles, des amitiés solides et des trahisons perfides. Autant de souvenirs ramenant une foule d’images à la surface de ma mémoire, instants forts qui faisaient partie de l’itinéraire de mon existence et me hanteraient jusqu’à mon dernier souffle.
Enfin, nous arrivâmes à Byblos où deux chambres d’hôtel nous attendaient sur le front de mer. Durant mon passage au Liban, j’avais eu l’occasion de visiter cette ville habitée depuis plus de sept mille ans. Les parents de Zena, la compagne de Condor, habitaient un village sur les collines. Son père informait discrètement les Français des mouvements suspects dans le secteur. Cela s’était hélas su un jour, les parents avaient été tués et Condor avait récupéré Zena, alors jeune adolescente, pour la ramener en France.
Écartelée entre passé prestigieux de capitale des Phéniciens et présent chaotique, la ville, à présent nommée Jbeil, tentait de se reconstruire dans le tourisme et l’artisanat, comme le prouvaient les nombreux restaurants et cafés, notamment dans le secteur du port. Désormais, entre la Méditerranée, dont la ville n’est plus l’un des accès favoris des marins, et le mont Liban, une chaîne culminant à plus de trois mille mètres, les gens d’ici profitaient de la vie paisible et du climat bien agréable.
Je serais bien monté dans les collines pour revoir le petit village et la maison de la famille Labaki, mais à quoi bon remuer des souvenirs à présent que les parents de Zena étaient, eux aussi, décédés. Je devais juste prendre contact avec un ami de Condor, un ancien militaire français qui avait épousé une Libanaise et tenait un petit restaurant sur le port. J’avais un nom et une adresse, et aussi des consignes pour aller verser les cendres des deux urnes dans la Méditerranée, au pied des ruines du fort de la Mer. Avant cela, à la terrasse d’un restaurant réputé, devant des beignets de calamars, nous évoquâmes ensemble notre relation commune, puis le pays au destin si compliqué.
Puisque nous avions prévu une journée de tourisme dans le Liban-Nord, la route se poursuivit jusqu’à Batroun et Tripoli, en suivant la corniche, puis nous revînmes passer quelques jours à Beyrouth, chez des amis français de Mathieu, libraires dans la capitale. Avec forcément à nouveau de nombreux souvenirs dans la tête, mais aussi d’âpres discussions géopolitiques en compagnie des différents interlocuteurs. Enfin, pour moi, après des adieux larmoyants, retour en France, deux ou trois jours à Paris, deux autres à Rennes, auprès de Carole et Guéric, son ex avec lequel elle avait remis le couvert. Tous deux avaient trouvé des postes dans les services du commissariat de la ville et leur fille Priscilla – que je ne reconnaissais presque plus – poursuivait ses études supérieures dans le domaine du droit.
Bref, une belle évasion prise sur mes congés et jours de rattrapage, puisque le toubib, en raison de mon état général, m’avait recommandé du travail de bureau et plus de cascades sur le terrain. Autant dire pour moi une mise en garde qui résonnait comme un pensum.
Ce lundi matin, je repris possession de mon bureau, tout en y constatant un peu partout les traces du passage de Sarah. En mon absence, elle devenait cheffe de groupe et cela lui plaisait. Je découvris mes dossiers empilés sur une desserte, des notes de service alignées comme des carreaux de mosaïque, des Post-it collés sur les côtés de mon ordinateur, de quoi m’occuper en intérieur pour quelques jours. Certes, la vie avait continué, ma fille avait assumé les affaires courantes, mais personne ne s’était soucié de classer mes dossiers en attente, même lorsqu’il s’agissait juste de les archiver, ou encore de les signer pour qu’ils suivent leur cours normal.
Une manière comme une autre de se sentir irremplaçable, à bien y réfléchir, pour un optimiste forcené. Au cours de ma matinée de rangement, je découvris aussi par hasard une enveloppe cachetée sur laquelle était inscrit au feutre : « À REMETTRE EN MAIN PROPRE À PAUL CAPITAINE. » Je demandai à Sarah si elle savait ce dont il s’agissait, elle me répondit que le patron du bar de l’Eau Blanche était venu déposer ce pli à l’accueil dans la semaine, mais qu’elle se trouvait alors au palais de justice, dans le bureau du substitut Joinel, aussi n’avait-elle pas rencontré le visiteur pour connaître le contenu du courrier. Je décachetai la missive qui était signée Youenn Lagadic. Je me souvenais vaguement de ce tenancier de bistrot, une figure de la ville, un baroudeur qui avait posé ses valises un jour à Quimper, un peu comme moi, en fait.
« Philippe Kermeur est accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Certes, il n’a pas d’alibi, son absence nous ayant tous surpris, ce soir-là, au Sans Soif. Cependant, il est incapable de tuer quelqu’un, même en état d’ébriété, surtout de dix coups de couteau. De plus, il ne reconnaît pas l’arme qui a servi au crime, il ne l’a jamais vue. Cela ressemble à une sombre machination.
Fausto Ballotti, dit Coppi, l’un de mes clients, prétend que vous êtes un policier honnête et un homme bien. Il a apprécié de vous voir un jour défendre l’honneur de deux de ses amis, morts dans un incendie qu’on les accusait d’avoir déclenché. Rien ne vous obligeait alors à mettre votre carrière en jeu pour prouver leur innocence*. Il a confiance en vous, voilà pourquoi je vous écris.
Vous serait-il possible de venir me rencontrer ? J’ai certains faits à vous confier, trop longs à expliquer par courrier. D’avance, merci pour Philou, il ne mérite pas de finir ses jours en prison, surtout pour un crime qu’il n’a pas commis. »
Voilà exactement le genre de situation que je détestais. Si je prenais contact avec Youenn Lagadic et découvrais un élément probant susceptible de me pousser à réclamer la réouverture de l’enquête, j’allais me mettre à dos Sarah, pour qui l’affaire était parfaitement limpide, un cas d’école (sic), Blaise, qui faisait équipe avec elle sur cette affaire, le substitut Joinel, chargé du dossier, et le juge Francœur, qui l’avait promptement récupéré pour instruction.
Sarah avait eu le temps de me glisser deux mots à propos d’un crime perpétré à l’encontre de Ravindra Lemay, une gérante de portefeuilles et épouse d’un important homme d’affaires quimpérois. L’acte d’un ivrogne qui ne se souvenait même plus de son geste, mais avait laissé pas mal de squames sur le lieu de son meurtre, puisqu’il souffrait de psoriasis. Le substitut Joinel avait suivi Sarah dans ses conclusions – mais il la suivrait jusqu’au bout du monde – et aussitôt confié le dossier pour instruction au juge Bruno Francœur qui n’avait pas tergiversé un instant. Réellement un cas d’école.
Aussi, remettre en cause une enquête aussi rondement menée allait me créer de gros ennuis, je le savais d’avance. Sans même parler de la famille de la victime, de ses proches, d’un certain microcosme quimpérois, tous prompts à s’agacer de me voir défendre un clochard. Cela encore, je pouvais l’encaisser. En revanche, la réaction de Sarah, si j’accordais un crédit à ce courrier et décidais de mener mon enquête… Je craignais de déclencher un tsunami sur la ville ! Elle se remettait peu à peu de la disparition de Quentin, trouvait de nouveaux repères et aussi une motivation supplémentaire depuis qu’elle était devenue capitaine. Par ma faute, elle risquait de dévisser à nouveau.
D’un côté, ma conscience me réclamait de me rendre à ce rendez-vous, avec la possibilité de découvrir un élément évident jouant en faveur de Kermeur, le coupable désigné. De l’autre, la sensibilité de Sarah, dans une période délicate de son existence, sans doute tombée dans un piège subtil, par emballement professionnel et fragilité morale. Elle se remettrait difficilement d’une telle boulette, si les faits se retournaient en faveur de l’accusé.
Il me fallait prendre une décision. J’appelai Sarah dans mon bureau et lui demandai de fermer la porte derrière elle, ce qui lui laissait présager une rude discussion. Elle perdit très vite sa physionomie guillerette en comprenant que mon invitation n’était pas le simple grief d’un bordel dans mes dossiers. Elle s’installa, les yeux fixés sur le courrier ouvert près de ma main droite.
— Tu as bien trouvé les empreintes de Kermeur sur l’arme du crime ? questionnai-je, timidement.
— Évidemment, je ne suis plus une débutante, je peux te ressortir une copie du rapport officiel, il est formel : ce sont bien les paluches de Kermeur, ce gars est bien le coupable ! Pourquoi, tu possèdes une version différente ? Je sais, la lettre provient du patron du bar, il soutient que personne n’a jamais vu Kermeur avec un couteau, j’ai entendu parler de ça en ville ! Que ne ferait pas un taulier de troquet pour sauver la tête de son plus fidèle client… Seulement, dans cette affaire, avec ses empreintes, en l’absence d’alibi et dans son état…
— Tu as bien trouvé d’autres empreintes du suspect sur la scène du crime ou encore les habits de la victime ?
— Non, mais cela était inutile, car le sol était jonché de squames, tu sais, ces minuscules bouts de peau, parce que notre type fait du psoriasis, et ces indices proviennent bien de son corps… Partant de là, comme il ne se souvient de rien, il lui est difficile de ne pas endosser le crime, même s’il se trouvait dans un état éthylique très avancé.
— Ramener l’arme du crime chez lui, l’enterrer dans la nuit au milieu de son jardin, ce n’est pas bien malin de sa part, même complètement bourré ! nuançai-je, mal à l’aise.
— Tu sais, dans son état, rond comme une queue de pelle, le niveau de réflexion fait du rase-mottes…
— Et pourtant, à ce que dit le dossier, il courait en quittant le lieu du crime ? Rond comme une queue de pelle, il peut prendre ses jambes à son cou ? Tout cela pour aller s’affaler, depuis la rue Bourg-les-Bourgs, sur un banc du jardin de l’Évêché ? Avant de recouvrer un peu de ses esprits et aller, le lendemain matin, enterrer chez lui un couteau qui n’était pas le sien ? Et puis, ton témoin miraculeux, à 23 heures, l’a-t-il réellement vu courir avec un sac et un attaché-case à la main ?
— Tu me fais quoi, là, Papa ? hurla Sarah en se levant de sa chaise. Tu es en train d’insinuer que j’ai bâclé mon travail ? Voilà l’image que tu as de ta fille ? Je comprends, quand je mène à bien une enquête auprès de toi, tu trouves cela normal ! Par contre, quand je me débrouille toute seule, comme une grande, alors le vieux flic bien installé prend ombrage, la pilule a du mal à passer ! Franchement, tu me déçois, sur ce coup… J’en ai marre de toi, marre de tes conseils, de tes leçons de morale, de tes…
— Cesse de monter sur tes grands chevaux, calme-toi, ma fille ! Tu as certainement raison, je dois juste vérifier quelques détails, à présent que le doute s’est insinué dans mon esprit. Tu n’as rien à te reprocher, cesse de me fusiller du regard comme si j’étais ton ennemi. S’il s’agit d’un piège, il a été parfaitement orchestré et mis en place avec beaucoup de sang-froid. Trop bien, même, à mon goût, trop parfait, trop évident… J’aimerais lire une copie du PV du rapport du légiste, et aussi celui de la scientifique, pour me faire une opinion plus précise. À aucun moment, le plus infime doute sur la culpabilité de cet homme n’a traversé ton esprit ?
— Cette pauvre fille s’est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, point barre ! insista Sarah, moins agressive. Elle rentrait chez elle en voiture, a ouvert le portail automatique du parking souterrain de l’immeuble, a omis de vérifier qu’il était bien fermé avant de continuer pour se garer un peu plus loin ! Ce poivrot, cherchant du fric pour se payer son litron, s’est faufilé pour l’attendre près de l’ascenseur et lui a porté une dizaine de coups de couteau au ventre. Au départ, ce n’était qu’un suspect potentiel, mais avec la découverte des affaires de la victime dans son squat, du couteau dans le jardin avec ses empreintes, et enfin de son ADN à partir des squames, le plus petit doute s’est envolé. Pour moi, comme pour le substitut Joinel…
— Pardonne-moi, ma fille, je ne veux pas te blesser, pas davantage te contredire ou te casser, comme tu le prétends, mais ta version ne colle pas ! Ton dossier est trop léger, un avocat un peu chevronné aurait vite pointé du doigt les zones d’ombre, les incohérences, les doutes évidents ! Pour tout te dire, je suis surpris que le juge Francœur l’ait avalisé aussi facilement, même avec l’arme du crime, les empreintes et l’ADN…
— Et le témoignage de Constance Baup, tu en fais quoi ? Elle a 35 ans, elle est secrétaire dans une agence immobilière, sa parole ne peut pas être mise en cause. Elle est venue témoigner spontanément en apprenant le drame. Elle a formellement reconnu Kermeur quand elle l’a croisé dans la rue, au point d’en dresser un portrait-robot, elle n’a tout de même pas la berlue…
— D’accord, Sarah, d’accord, n’en parlons plus ! soupirai-je, pourtant pas totalement convaincu. Avec un témoin digne de foi, ça change la donne, je te l’accorde ! Mais quand même, ce Kermeur, quel imbécile. À moins qu’il ait voulu se faire choper… Bon, je vais faire la bise à Isabelle et Jean-Luc, en face !
Une fois la rue traversée, avant même la bouille du patron, je reconnus, punaisée derrière le bar, la vue adressée depuis Beyrouth avec le rocher Al Raouché et un coucher de soleil sur la Méditerranée. Je savais que mes amis y seraient sensibles. D’ailleurs, Isabelle sortit de sa cuisine pour me remercier de la pensée amicale, m’embrasser comme du bon pain. Jean-Luc arriva de la réserve avec un fût de bière. Naturellement, le premier sujet de discussion fut le meurtre de Ravindra Lemay, la plus importante affaire en mon absence. Comme beaucoup, Isabelle trouvait qu’il s’agissait d’un drame atroce : une fille aussi belle et tellement intelligente n’avait pas le droit de mourir de la sorte.
— Comme si cela était autorisé pour les mecs idiots et moches comme moi ! lui répliqua aussitôt son époux en faisant couler un premier bock de mousse. Quel incroyable concours de circonstances, tout de même… Que fichait donc Philou Kermeur au fin fond de la rue Bourg-les-Bourgs à une heure si tardive ? C’est l’opposé de ses quartiers habituels, l’Eau-Blanche et l’Hippodrome. Il fallait qu’il soit fin bourré pour adresser dix coups de couteau à cette femme…
— Il n’existait pas couple plus glamour sur Quimper ! se lamenta Isabelle, les yeux humides. Un vrai conte de fées, une histoire de princesse qui rencontre le prince charmant. C’est trop atroce…
— Tu les connaissais bien ?
— Comme tout le monde, je me suis intéressée à leur histoire, elle n’est pas ordinaire, expliqua mon amie de jeunesse. Les journalistes locaux ont écrit pas mal d’articles à propos de l’installation professionnelle de Ravindra dans les locaux de la pépinière d’entreprises de Créac’h Gwen. Ce qui m’a marqué, vois-tu, c’est comme son mari était fier d’elle, sans doute plus encore que de sa propre réussite, ce qui n’est pas peu dire, car c’est un homme d’affaires qui a le vent en poupe. Pour le reste, si tu veux tout savoir, ils n’ont jamais fréquenté la salle du Colibri !
— Puisque tu me sembles intarissable sur leur vie, Isa, tu peux me brosser leur histoire, pour me mettre dans l’ambiance ? questionnai-je, appuyé au comptoir.
— Stéphane Lemay, enfant du pays, fils d’un notaire de la région, spécialiste des équipements marins haut de gamme. Un créneau porteur, une société en pleine expansion, des filiales à l’étranger, des clients dans une cinquantaine de pays, une success story, comme on dit de nos jours. Il rencontre Ravindra à Bombay au cours d’un voyage professionnel : c’est le coup de foudre. Il parvient à la convaincre de venir s’installer en France ; elle connaissait un peu Paris, elle va découvrir Quimper.
— Quasiment la même ville, en un peu mieux, ironisai-je avant de commander un petit café à Jean-Luc.
— En plus, tu ne crois pas si bien dire, Cap, elle s’y plaît… enfin, s’y plaisait, et le criait sur tous les toits. Elle était belle, le charme typé des Indiennes, très intelligente, douée d’une sorte de sixième sens pour flairer les bons coups sur les marchés boursiers, à ce qui se raconte. Elle faisait profiter son mari et ses proches de son bon feeling, une fois installée à son compte. À ce que prétend la rumeur, pas un seul n’a eu à le regretter, bien au contraire ! Elle bossait avec deux stagiaires, des filles d’origines asiatiques, comme elle, qu’elle avait choisies elle-même et qu’elle formait au métier.
— Mais les belles histoires d’amour finissent mal, en général ! soupirai-je en sirotant mon petit noir.
— Oui, la magie s’est brisée un soir, dans un sombre parking souterrain, dans la violence, pesta Isabelle, proche des larmes. Parce qu’un soûlard n’a pas trouvé d’autres moyens que celui de tuer la poule aux œufs d’or pour se payer son litron…
— Du moins, c’est la version de la police et de la justice, intervins-je, perplexe. Une version qui semble convenir à tout le monde.
— Sarah nous en a dit quelques mots, un jour où elle est venue déjeuner avec le substitut du procureur qui semble en pincer pour elle. Ils n’avaient pas le moindre doute à ce sujet.