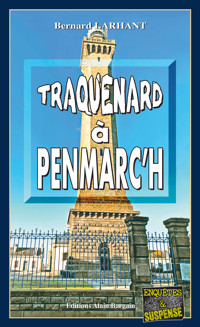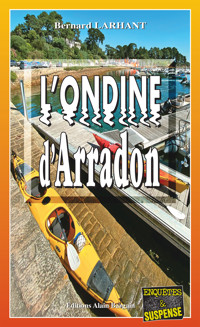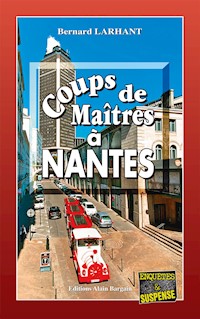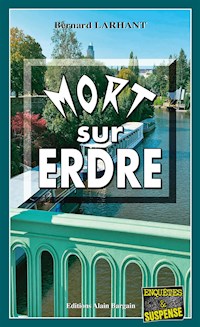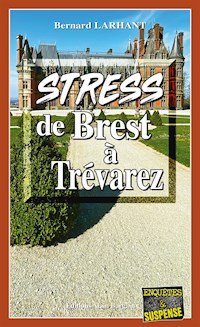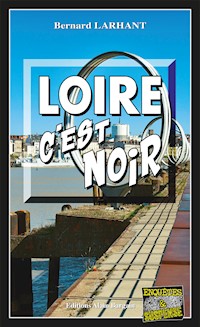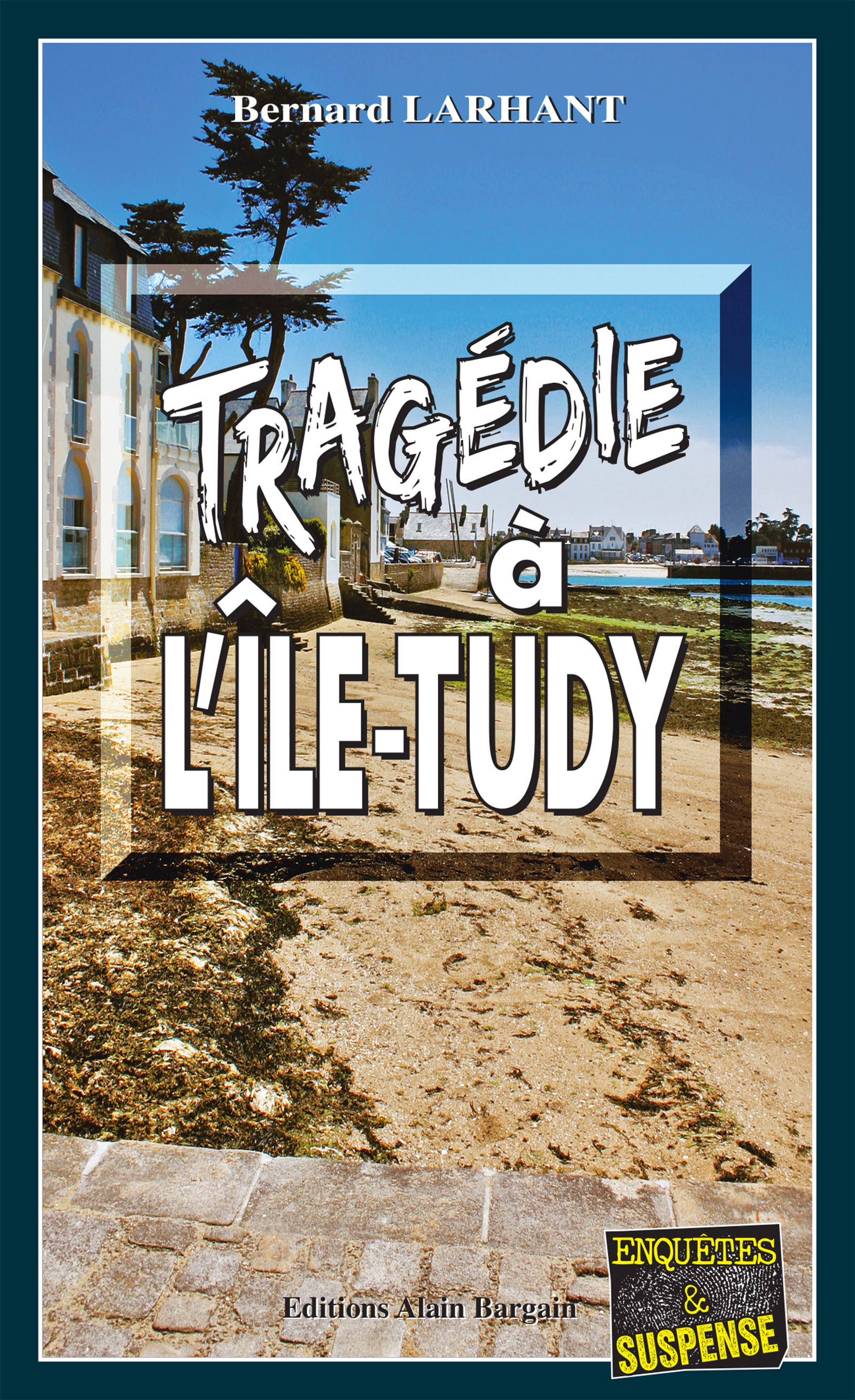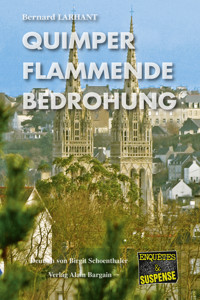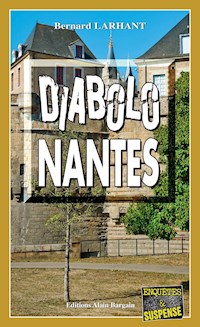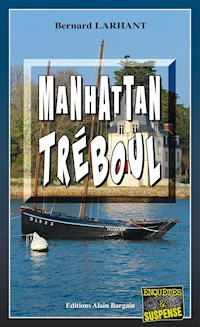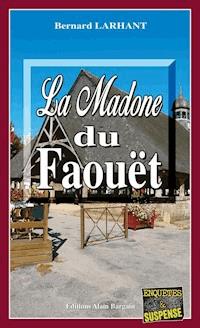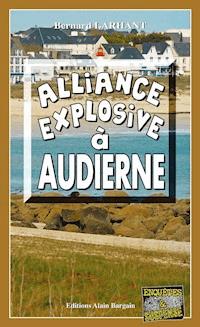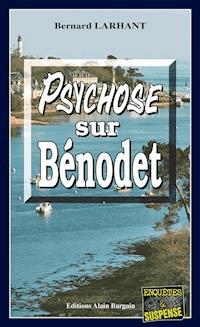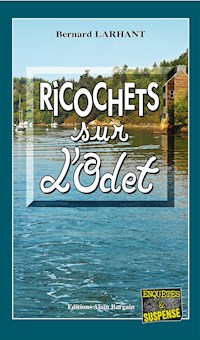
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Capitaine Paul Capitaine
- Sprache: Französisch
Ces deux corps meurtris ont-ils un lien ? Sarah et Paul se lancent dans la résolution de cette énigme...
En promenade sur les bords de l’Odet, vers le moulin de Rossulien à Plomelin, Sarah et Paul découvrent le cadavre d’un homme d’une soixantaine d’années. Peu avant, la jeune femme d’affaires Goulwena Le Brusc est décédée lors d’une plongée aux Glénan. La gendarmerie conclut à un accident. Mais le détective Mario Capello est mandaté par des proches pour approfondir les circonstances de la mort.
Le dossier est relancé par Sarah, devenue capitaine après une période difficile à la suite du décès de son compagnon. Contre vents et marées, elle défend une thèse bien singulière. Pour soutenir sa fille, malgré son scepticisme, Paul va lui prêter main-forte.
Plongez sans attendre dans le 21e tome des enquêtes du Capitaine Paul Capitaine !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Bernard Larhant est né à Quimper en 1955. Il exerce une profession particulière : créateur de jeux de lettres. Après un premier roman en Aquitaine, il poursuit par l’écriture de polars avec les enquêtes d’un policier breton au parcours atypique, le capitaine Paul Capitaine et de sa partenaire Sarah Nowak. Il crée aussi le personnage de Nadège Pascal, avocate nantaise aux aventures palpitantes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
REMERCIEMENTS
À André Morin, pour ses conseils d’enquêteur et ses réflexions, même si ce livre reste un roman.
À Dominique Descamps, pour sa relecture amicale et attentive.
PRINCIPAUX PERSONNAGES
Paul CAPITAINE : 59 ans, commandant de police, ancien agent des services secrets français. Natif de Quimper, il connaît bien la région. Au sein de la PJ de Quimper, il fait équipe avec Sarah, sa fille. Après des années auprès de la magistrate Dominique Vasseur, en mission aux États-Unis, il vit à présent en solitaire.
Sarah NOWAK : 35 ans, d’origine polonaise, capitaine de police. Elle a découvert en Paul Capitaine le père qu’elle recherchait. Elle vient de perdre son compagnon Quentin, pompier professionnel, au cours d’un incendie. Elle se retrouve donc seule pour élever Pauline, leur fille âgée d’un peu plus de 2 ans.
Rose-Marie CORTOT : 34 ans, d’origine antillaise, enquêtrice de police. RMC pour tout le monde. Soleil de l’équipe par sa bonne humeur, le plus du groupe par son génie de l’informatique. Meilleure amie de Sarah, compagne de Mario, ancien policier et détective privé, maman de Théo, plus âgé que Pauline de quelques mois.
Blaise JUILLARD : 33 ans, célibataire, lieutenant de police. Le père a été un ponte du quai des Orfèvres ; le fils ne possède pas son étoffe. Sous ses airs nonchalants qui lui ont valu le surnom de Zébulon, il n’est pas dénué de vivacité d’analyse. Amoureux transi de Sarah et parrain de la petite Pauline.
Mehdi LANGEAIS : 41 ans, divorcé, lieutenant de police, tout juste débarqué à Quimper. Ancien garde du corps de personnalités, il a passé avec succès son examen d’OPJ. Il est discret sur son passé mais a trouvé l’amour auprès de Julie Varaigne, secrétaire de Mario Capello dans son cabinet de détective.
Laure BARBOTAN : 35 ans, célibataire, substitute de la procureure. Ambitieuse et besogneuse, libre et spontanée, elle a trouvé en Paul Capitaine un policier aguerri auprès de qui apprendre son métier de magistrate.
PROLOGUE
Dimanche 21 mars, 15 heures, moulin de Rossulien, Plomelin
Pour un début de printemps, ce n’était pas encore les beaux jours, bien loin de là. Tout juste avions-nous la chance d’éviter les averses de la matinée. Jacques Villenave – le policier retraité qui m’avait accompagné lors de l’affaire de « la noyée de l’Odet* » – et son épouse Josette nous avaient invités, Sarah et moi, à partager leur déjeuner dominical. Ils savaient que nous traversions une période douloureuse, surtout ma fille qui avait perdu son compagnon six mois plus tôt et ne parvenait pas à l’accepter, ce qui se comprenait aisément. Une blessure encore très vive dont je me demandais si elle se cicatriserait un jour. Jamais vraiment, certainement mais, peu à peu, avec le temps, espérai-je de tout cœur, la douleur s’atténuerait. Elle avait bien changé, Sarah ; elle avait perdu son sourire, sa joie de vivre, sa bonne humeur et cette étincelle de malice au fond des yeux, qui la rendait tellement irrésistible. Le ciel lui était tombé sur la tête et elle en voulait à la terre entière, mais plus encore à elle qu’à tous les autres, même si son entourage lui répétait qu’elle n’y était pour rien.
Elle se remémorait les beaux souvenirs vécus auprès de son compagnon, forcément à jamais amers, les cérémonies officielles et surtout l’hommage des collègues de Quentin à la caserne, eux aussi très marqués par le drame. Un moment empreint d’émotion, de dignité et de solennité, en présence du préfet, d’élus de la ville, du département et de la région, avant que ne lui soit remise à titre posthume la médaille d’or, pour acte de courage et de dévouement. Avant le discours fort du colonel, directeur du SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) du Finistère, bien meurtri lui aussi par le drame, des paroles poignantes qui firent craquer Sarah, dévastée par la douleur.
Triste fin de septembre, morose automne, interminable hiver. Ma fille n’était plus que l’ombre d’elle-même, dépourvue du plus petit ressort. Pourtant, les collègues pompiers de Quentin l’entouraient du mieux qu’ils le pouvaient, marqués par la disparition tant brutale que cruelle et stupide de leur compagnon, de leur ami, de leur pote. Avant de comprendre que leurs visites ne faisaient souvent que raviver la peine de la jeune veuve et rouvrir un peu plus des plaies encore béantes.
Blaise ne quittait presque pas Sarah, discrètement présent. Il prenait des tempêtes régulières en pleine face de la part de sa partenaire de travail sans jamais broncher, fidèle et stoïque, attentif et tendre, si fort dans la compassion. Comme un vieux loup de mer rompu aux vagues scélérates du grand large et aux coups de tabac incessants. Même Rose-Marie ne parvenait pas à apaiser sa meilleure amie qui, peu à peu, se refermait sur elle-même, protégeant sa fille Pauline, le plus beau souvenir qu’il lui restait de Quentin, sa plus importante raison de vivre.
Au fond de son âme, Sarah s’en voulait de ne pas avoir su garder près d’elle celui sans lequel elle serait morte noyée dans les eaux de l’Odet. Quentin lui avait sauvé la vie, elle se sentait redevable. Mais là, à une parole près au téléphone, si elle avait insisté pour que son compagnon aille chercher Pauline chez sa grand-mère, il serait encore en vie. Au lieu de cela, elle s’était proposée de le faire elle-même, au retour de notre mission au château de Trévarez, tant elle était heureuse de le retrouver et lui préparait même une surprise.
Toutes ces impressions constituaient un magma en bouillonnement permanent dans le cerveau de ma fille, un mélange de douleur lancinante, de haine ravalée, de tristesse abyssale et de détresse impalpable. Depuis six mois, un film passait en boucle dans son crâne, jour comme nuit, sans qu’il soit possible d’appuyer sur la touche pause ou, mieux encore, de changer de programme. Une force en fusion que nul ne pouvait apaiser, sinon les appels à l’affection de Pauline, pour quelques minutes.
Quant à moi, je tentais de trouver ma place auprès de Sarah, plus proche que d’ordinaire sans pour autant l’étouffer, mais pour éviter aussi ses coups de tonnerre permanents, que je supportais moins bien que Blaise, incomparable d’abnégation. La soutenir après ce drame représentait désormais ma priorité, même si je me sentais tellement démuni à trouver des paroles de consolation, les bonnes actions pour la soutenir, et surtout des explications rationnelles à un fait divers si atroce qui n’en possédait justement pas. La fatalité. Quel mot cruel, la fatalité. Révélant une forme d’impuissance qui ne pouvait convenir à une personne dans le chagrin, encore moins l’apaiser.
J’avais éliminé de ma vie tous les à-côtés, importants ou moindres, pour me concentrer sur l’essentiel : entourer ma fille, lui prodiguer le soutien qu’elle était en droit d’attendre de son paternel, lui donner ce que je ne possédais pas, en fait. Les mots me semblaient si dérisoires, les tentatives d’explication si légères, les gestes de tendresse si maladroits. J’avais découvert un jour une fille d’un peu plus de 20 ans, pétillante et volubile, et j’avais fini par concevoir que Sarah serait toujours ainsi. Là, je découvrais une maman de 35 ans, taciturne et révoltée, dont je me demandais si elle redeviendrait un jour un peu celle d’avant. Juste un peu.
Consuelo Da Costa, la nouvelle procureure, avait compris que j’avais besoin de temps et de liberté pour m’occuper de Sarah et ne me sollicitait plus pour des soirées intimes, comme les semaines précédentes. Même la substitute Laure Barbotan n’osait pas me déranger pour m’inviter à un dîner en tête à tête, se contentant de m’assurer que, si j’avais besoin de parler, elle était là, disponible, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, en amie. Dominique aussi, terriblement meurtrie par le drame qui touchait celle qui était devenue un peu sa fille de substitution, m’avait proposé de la contacter, si je me sentais en détresse et démuni. Mais comment mettre des mots sur la situation que nous vivions ? Je passais mes journées à attendre les appels de Sarah, pour un service, pour de l’affection, pour juste entendre cette colère intérieure qui ne la quittait plus, avec l’espoir que la vie reprendrait en elle quand reviendraient les beaux jours, comme la sève montait dans les tiges des plantes et les troncs des arbres pour manifester le triomphe de la vie.
Pourtant, tout aurait dû être merveilleux dans nos existences. Après avoir hérité d’une partie de la fortune de Conrad Dormeuil – mon mentor dans les services secrets, abattu chez lui avec sa compagne libanaise sans que l’enquête ait pu définir l’identité des criminels –, Sarah n’avait plus le moindre souci pécuniaire et comme Quentin était un gestionnaire dans l’âme, ils ne manquaient pas de projets raisonnables. En plus, à la suite de notre dernière affaire résolue à Trévarez, elle avait obtenu un avancement de grade et se trouvait désormais capitaine de police, ce qui, en une autre période, l’aurait illuminée de fierté. Mais en ces heures sinistres, tout cela lui semblait bien dérisoire.
Oui, Sarah était désormais capitaine comme moi, ou plutôt comme moi avant. Car, depuis le même moment, je n’étais plus le capitaine Paul Capitaine, mais le commandant Paul Capitaine, il fallait s’y habituer. Le changement m’éviterait quelques sarcasmes et blagues douteuses, mais il n’arrivait pas au bon moment. Une promotion à l’approche de la retraite que j’aurais davantage savourée sans le drame de la mort de Quentin et sans un incident de parcours personnel, sur le plan physique, qui m’avait valu un congé de longue durée de la part du médecin agréé par la préfecture. Au départ, il ne s’agissait que d’un souci dans l’articulation de l’épaule, mais cela s’était achevé par un passage chez le cardiologue et un arrêt de travail immédiat, après des examens complémentaires. Et six mois de repos avant de nouveaux contrôles pour juger de mes aptitudes à reprendre du service. Selon le toubib, moi aussi, j’avais encaissé le choc, autant face à la disparition brutale de mon gendre que devant la détresse légitime de ma fille, avec laquelle j’entretenais une relation fusionnelle. Donc, fatalement, le drame qui la touchait de plein fouet me frappait aussi violemment et mon corps avait réagi à sa manière, par son point faible.
Le groupe se trouvait donc avec un chef sur le flanc, son adjointe présente, mais si souvent ailleurs, Blaise encore un peu moins motivé qu’auparavant, RMC plus préoccupée par le moral de son amie que par ses missions informatiques, et Mehdi Langeais totalement opérationnel, pour sa part. Un nouvel élément avait été annoncé de longue date par notre nouveau commissaire, Guilhem de Wancourt, qui après un an à Quimper et surtout la réussite exceptionnelle de notre mission de Trévarez, commençait à prendre peu à peu ses marques. Et aussi à faire enfin confiance à ses équipes, même s’il était toujours bien frileux à prendre des décisions sur des dossiers chauds. Mais au moins n’avait-il jamais eu à souffrir de nos initiatives sur le terrain, chaque opération se couronnant le plus souvent d’un franc succès qu’il ne boudait pas.
Donc, ce dimanche-là, durant le déjeuner à Plomelin, avec son âme de maman et de mamie, Josette Villenave avait tout fait pour détendre Sarah et amuser Pauline, qui voyait bien que tout ne fonctionnait plus comme avant à la maison, même s’il lui était difficile d’appréhender l’absence d’un père. Ou encore de formuler, à un peu plus de 2 ans, sa peine intérieure. Une autre personne que Josette aurait prononcé les mêmes paroles dégoulinantes de gentillesse et de bienveillance, ma fille lui aurait volé dans les plumes sans le moindre état d’âme. Mais pas cette mamie qui venait sans doute compenser par sa bonté naturelle un manque intérieur chez une jeune femme qui n’avait jamais connu ses grands-mères.
Ce jour-là, entre le poulet-frites et le plateau de fromages, je vis même ma fille esquisser un léger sourire lorsque Jacques Villenave évoqua le métier à son époque, à Quimper, par quelques anecdotes aussi truculentes que sympathiques, que Josette ponctuait de ses commentaires personnels, tout aussi cocasses, rectifiant des points de détail insignifiants du récit de son mari. Encore un peu plus quand la version livrée par l’ancien flic divergeait de l’authentique et qu’elle se faisait un devoir de rétablir la vérité originelle. Nous n’étions pas dans l’opérette marseillaise, mais dans l’évocation du quotidien d’un couple de Bretons, lui policier et elle nounou pour des familles du quartier. Une autre époque, un autre monde, d’autres pratiques, d’autres valeurs…
Après la tarte aux pommes maison et le café, à la faveur d’un petit rayon de soleil, Jacques nous avait proposé une balade sur les bords de l’Odet, pour nous détendre et nous dégourdir les jambes. Josette s’était proposée de rester jouer avec Pauline, qui se sentait en confiance avec cette mamie un peu différente de Mylène, la mère du pauvre Quentin. Plus âgée, certes, plus ronde, plus joviale, dotée d’une voix tonitruante et chaleureuse, elle devait rassurer la môme, en recherche permanente de pôles sécurisants, surtout en cette période.
Les Villenave habitaient une maison assez ancienne située dans la commune de Plomelin, non loin de la route des châteaux et du chemin qui menait au château de Kerambleiz et à la cale de Rossulien. Une position idéale pour pratiquer la pêche et la cueillette des champignons, selon Jacques, à la retraite active. Quand même un peu loin du bourg et des commerces, selon Josette, même si elle ne quitterait son nid pour rien au monde. Ici, ils vivaient au calme, en pleine nature, même si certains automobilistes et cyclomotoristes appuyaient un peu trop sur le champignon à leur goût, ne mesurant pas le danger, pourtant souvent mortel, sur cet axe sinueux entre Quimper et Combrit.
Sarah avait troqué ses chaussures de ville pour des baskets et nous descendions tous trois vers le moulin de Rossulien, refait depuis peu et pas encore ouvert au public, ce qui ne saurait tarder. Au passage, le retraité évoqua l’histoire du château de Kerambleiz – dont on n’apercevait que la maison de garde juste derrière le portail – bâti au début du XXe siècle par Étienne Roussin, l’un des membres d’une célèbre famille locale et ingénieur des Arts et Manufactures. Une superbe bâtisse, entourée d’un parc d’une vingtaine d’hectares, dotée d’une vue exceptionnelle sur le cours de « la plus jolie rivière de France » selon Zola, mais qui n’en demeurait pas moins un fleuve côtier pour les géographes. Le propriétaire de ce superbe château – l’un des plus beaux sur les rives du cours – fut maire de Plomelin et même député, avant de migrer avec les siens vers le château de Kerdour, plus proche de Quimper.
Tout en poursuivant la descente vers l’Odet, accompagnés par le chant joyeux d’un ruisseau nourri par les récentes pluies, nous nous trouvions lentement en harmonie avec la nature luxuriante et paisible. Jacques nous parla de la cale de Rossulien, construite en 1883 pour permettre le déchargement de matériaux de construction ou d’engrais pour les terres. À côté de la cale était implanté déjà depuis plus d’un siècle un moulin à eau qui fonctionnait avec les marées. Il était toujours en ruine alors qu’un peu plus haut, la demeure du meunier avait, elle, été restaurée récemment et dotée d’une roue à aubes semblable à celle qui avait été installée juste après la dernière guerre pour fournir de l’électricité.
Accaparés par les anecdotes savoureuses de Jacques sur les fêtes d’antan, nous nous approchâmes d’un superbe bâtiment gris ressortant du camaïeu de verts qui l’entourait. Un bruit d’eau sautant d’une pierre du lit à une autre, plus intense qu’un peu plus haut, nous égayait les oreilles, venant se mêler au chant des oiseaux ici en paix. Personne autour, par la faute de ce temps maussade qui avait freiné randonneurs et badauds du dimanche. Et puis, les tablées familiales étaient encore occupées, certainement à l’heure du dessert, du café ou du digestif.
— Suivez-moi par le haut, suggéra le retraité en nous dirigeant vers une petite passerelle lancée par-dessus le filet d’eau assez puissant. Je vais vous montrer le canal qui mène une partie de l’eau jusqu’à la roue à aubes. Cette dérivation se nomme un bief !
— Et quand l’eau est rose on appelle cela un rose bief ? questionnai-je, amusé de ma trouvaille.
— Si l’eau est rose, tu appelles la gendarmerie de Pont-l’Abbé car c’est mauvais signe, répliqua le retraité, prompt à la réplique. Par chance, le lieu est tranquille, même si on a connu des accidents plus bas, avec des mômes imprudents qui ont plongé de la cale et se sont fracassé le crâne sur les rochers.
— Et c’est quoi, cette masse, un peu plus bas ? intervint Sarah, silencieuse jusqu’alors. On dirait un corps humain qui a roulé dans les broussailles pour s’arrêter près du ruisseau, à côté de la roue.
— Mince, c’est vrai, on dirait un cadavre, bredouilla Jacques en se penchant à la balustrade, sourcils froncés.
— Un endroit tranquille, disais-tu ? soupirai-je en regardant mon ancien collègue. Bon, toi, tu es à la retraite et moi je suis en arrêt forcé, tu vas devoir t’y coller, ma fille. Tu appelles le procureur de permanence ?
— Oui, pas de problème, c’est Fabien, ce week-end !
— Fabien ? Le substitut Fabien Joinel ? insistai-je, surpris de voir Sarah l’appeler par son prénom. Vous êtes si intimes, tous les deux ?
— Attends, quand tu parles de Laure Barbotan, tu l’appelles bien Laure, je ne me trompe pas ? répliqua ma fille, qui avait soudain retrouvé de la niaque. Et je n’en fais pas tout un fromage ! Avec Fabien, on est de la même génération et si tu veux tout savoir ; il m’appelle souvent pour prendre de mes nouvelles, lui ! Ce n’est pas le cas de tous les magistrats du parquet, figure-toi, et notamment de la procureure Consuelo Da Costa, qui semble me suspecter d’avoir fait exprès de perdre mon compagnon pour l’écarter de toi et te ramener à moi. Et puis, Fabien a perdu sa fiancée dans un accident de circulation, ça nous rapproche, figure-toi…
— Je ne veux pas vous interrompre, intervint Jacques pour nous couper dans nos bisbilles, mais il n’est peut-être pas mort, ce gars, même s’il ne bouge plus. Et puis, plus tôt nous aurons sécurisé le périmètre, plus nous éviterons des pollutions des lieux par des badauds… Enfin, je dis ça, je ne suis pas dans la course, moi…
Sarah prit contact avec le substitut Fabien Joinel, en poste à Quimper depuis six ans, une affectation qu’il semblait donc apprécier. Autant que ma fille, même si celle-ci lui avait déjà précisé depuis longtemps qu’elle était quasiment mariée, ce que le magistrat avait accepté sans sourciller. Là, il promit d’arriver au plus vite et chargea ma fille de conduire l’enquête puisqu’elle se trouvait déjà sur place. Même si la logique aurait voulu qu’elle soit menée par les gendarmes bigoudens. Dans la foulée, Sarah appela le commissariat et obtint très vite Mehdi Langeais, qui se trouvait de permanence. Lui aussi s’engagea à arriver rapidement avec une équipe.
Pendant ce temps, en veillant à ne pas trop laisser d’empreintes, je vérifiai ce qui ne faisait quasiment aucun doute : l’individu était mort depuis déjà quelques heures. On pouvait voir une partie de son corps et juger qu’il s’agissait d’un individu masculin de type caucasien âgé de 60 à 75 ans. Assez grand mais très svelte, doté d’une barbe blanche récemment taillée et d’une abondante chevelure poivre et sel. Il portait une tenue de ville avec une veste classique et non un équipement pour se balader en campagne, ce qui signifiait qu’il ne se trouvait pas là pour la pêche ou encore la randonnée sportive.
Une plaie sur la tempe laissait imaginer qu’il avait été assommé à l’aide d’une barre de fer ou un gourdin par une personne qui lui avait tendu un piège car l’individu me semblait suffisamment fort pour se défendre. Sans doute avait-il été estourbi par surprise, soit parce qu’il connaissait son agresseur et ne s’en méfiait pas, soit parce qu’il parlait avec une personne quand une seconde était passée à l’acte. Mais tout cela restait du domaine des supputations.
Première fouille des habits : pas de papiers sur lui, sa montre lui avait été aussi enlevée, de quoi accréditer la thèse d’un traquenard. Pas un objet dans les poches de la veste, pas davantage dans celles de son pantalon, ce qui me semblait étonnant. Cela ressemblait à une volonté de ralentir l’identification de la victime ou encore d’effacer le lien possible avec son agresseur. Le légiste aurait certainement des précisions à nous fournir quant à la possibilité que cet homme ait été tenu aux poignets par des complices, pendant que l’assassin le frappait. Je relevai la tête vers Jacques Villenave.
— Vous avez déjà vu cet homme dans les parages ? questionnai-je, convaincu d’une réponse positive.
— Jamais, ce gars n’est pas d’ici, ce n’est pas un habitué de cette rive de l’Odet, sinon je l’aurais déjà croisé. Et une gueule aussi typique que celle-là, impossible de l’oublier. Ce type a dû être un colosse, il mesure bien 1,80 mètre, non ?
— Oui, je pencherais pour un vieux loup de mer, appuyai-je en fixant ce visage buriné par les soleils des quatre coins du monde. Soit un ancien de la marine marchande, soit un baroudeur revenu au pays…
— Pour mourir là où il était né, comme les éléphants, me coupa Sarah, de retour près de moi. C’est bon, je garde l’enquête, tant pis pour les gendarmes ! Papa, tu ne fais pas d’efforts excessifs, je te rappelle que tu n’es pas censé te trouver sur une scène de crime, tu n’es pas en service.
— Excuse-moi, mais si je n’ai plus le droit de me balader au bon air alors que le cardiologue m’a ordonné une longue marche quotidienne, je ne sais pas ce que je vais faire de…
— J’ai perdu Quentin, je n’ai pas envie de te perdre, le dossier est clos, sanctionna Sarah sur un ton formel. Je ne veux même pas que le substitut ou le reste de l’équipe te voient sur les lieux du meurtre. Vous remontez tous les deux à la maison, je vais attendre les renforts. Ah, en revanche, tu prends soin de Pauline.
— Et je fais du stop pour rentrer à Quimper avec elle, moi ?
— Je vais te reconduire rue Vis, Paul, on va juste prendre le siège de la môme dans la voiture de Sarah et ce sera bon.
— Si vous pouviez l’emmener chez ses grands-parents, ce serait génial, précisa ma fille, avec autorité.
— Qui ça, Paul ? s’étonna le retraité.
— Non, Pauline, bien sûr, répliqua Sarah, très énervée, mais que je sentais excitée de diriger une enquête d’importance, la première depuis la mort de Quentin, une responsabilité qui pouvait l’aider à tourner une première page.
Comme si la mort de cet inconnu, le rythme de l’enquête et l’adrénaline du terrain pouvaient agir en catalyseur de ses énergies pour lui permettre de redémarrer, malgré tout. Elle nous donnait des ordres, me commandait de guider Jacques jusque chez les parents Le Gall, de ne pas oublier de prendre les affaires de la môme dans la voiture, me proférait moult recommandations, mais cela ne me gênait pas, je la sentais commencer à revivre, cela me faisait plaisir. Même s’il ne s’agissait que d’un feu de paille, il avait le mérite de me laisser espérer que Sarah pourrait redevenir, un jour proche, la Sarah que j’avais connue.
Un peu plus tard, en remontant vers la maison des Villenave, Jacques soupira que, décidément, on ne pouvait pas se rencontrer sans trouver un cadavre devant nos pas, soit dans l’Odet, soit pas bien loin du cours. Encore une affaire tordue, insista-t-il, comme si elle le concernait toujours. Je lui avouai que, même si je pensais à la douleur de la famille de cet homme, car il devait en posséder une quelque part, la réaction de Sarah m’avait rassuré. Égoïstement, je pensais à elle, qui tentait de se reconstruire lentement et, dans sa cruauté, ce drame inopiné avait cet aspect positif de réveiller ma fille de sa torpeur bien légitime pour la recentrer sur l’enquête à suivre. La réponse de Jacques ne fut pas celle que j’attendais.
— Tu sais, Paul, on se connaît un peu, maintenant. Je peux te confier un drame que nous avons vécu voilà un peu plus de trente ans. Josette et moi avions un fils, Julien, qui avait 13 ans. Un jour qu’il revenait de chez un copain à vélo, il a été renversé par un chauffard qui roulait bien trop vite sur nos routes sinueuses et il est mort sur le coup. Tu ne peux pas savoir le choc que ça fait quand les gendarmes et le maire de la commune viennent vous apprendre la mort de votre enfant !
— Mince, je l’ignorais, je crois qu’il n’y a rien de pire qu’un tel drame, bredouillai-je, embarrassé.
— Toute notre vie en a été bouleversée, enchaîna le retraité, encore marqué par ce choc moral. Moi, j’avais le travail pour me défouler, un peu comme Sarah à présent, et je me suis jeté dans les enquêtes à corps perdu. De son côté, Josette bossait comme secrétaire dans une entreprise de Pluguffan ; elle n’a pas trouvé le courage de reprendre son poste et un ressort s’est cassé en elle à jamais. Elle a gardé des enfants, un temps, mais ce n’était pas les siens, les nôtres… Pardonne-moi de te dire cela, mais ta fille ne sera plus jamais tout à fait celle qu’elle était. La mort, surtout accidentelle, marque les âmes à jamais. Mais si elle peut trouver l’énergie de survivre grâce au métier, ce sera déjà cela…
Ce soir-là, une fois Pauline confiée à ses grands-parents paternels, qui n’attendaient que cela car la môme était aussi un peu le prolongement de leur fils, je me retrouvai tout seul dans l’appartement de la rue Vis, sans enthousiasme particulier, comme si j’avais chopé le spleen qui avait, pour partie, quitté Sarah. Je l’appelai pour avoir des nouvelles de notre dossier, mais son portable se trouvait sur messagerie. Je regardai les quelques photos que j’avais prises de notre cadavre et je tentai d’imaginer l’existence passée de ce bourlingueur venu s’échouer en fin de vie pas loin de la cale de Rossulien, comme l’un de ces fiers navires trahis jadis par les méandres du fleuve côtier. Un marin ou un militaire, peut-être, un homme de caractère qui devait être très beau, très impressionnant, dans ses jeunes années.
Que faisait-il à Plomelin ? Ce n’était pas un habitué des lieux, sinon Jacques l’aurait fatalement reconnu, lui qui est au fait de tous les potins de la commune car, comme on dit : flic un jour, flic toujours. Sans doute même pas un Quimpérois, peut-être même pas un Breton. Un mystère que les analyses génétiques du médecin légiste dissiperaient très vite, à coup sûr. Du moins, pouvait-on l’espérer. Car, de nos jours, il est de plus en plus difficile de conserver l’anonymat, surtout pour un cadavre. Un ADN appartenait à une personne et toute personne possédait une identité, les méthodes avaient bien évolué depuis l’époque active de Jacques…
Je tentai une dernière fois d’appeler Sarah, en vain. Deux solutions. Elle était allée se coucher très tôt, une fois les premières constatations achevées, pour être en forme sur le pont le lendemain matin. Ou bien le procureur Joinel – un magistrat d’une quarantaine d’années, très respectable et courtois au demeurant – l’avait invitée à dîner pour boucler cette première journée d’enquête. Cela se faisait aussi et je ne devais pas y voir du mal. Je savais juste que, lorsque j’évoquais face à elle qu’il lui serait un jour possible de tourner la page, Sarah me répondait avec véhémence que Quentin était l’homme de sa vie et qu’il n’y en aurait pas d’autre. Blaise, c’était avant tout le parrain de Pauline et sinon un collègue de boulot, un bon pote et accessoirement un punching-ball. Fabien Joinel, je ne savais pas dans quelle case le placer. Beau gosse issu d’une famille d’avocats toulousains, je lui avais toujours trouvé un côté trop BCBG mais, à bien y réfléchir, son tempérament flegmatique, si proche de celui de Quentin, pouvait apaiser la nature volcanique de Sarah. Et puis Fabien Joinel était aussi le magistrat du parquet qui avait suivi l’affaire de l’incendie qui avait causé la mort de Quentin, avant de la remettre pour instruction à un juge, car le feu démarré dans l’immeuble était de nature criminelle. Et je savais que ce dossier-là, Sarah ne le lâcherait jamais, lui non plus.
* Voir La Madone du Faouët, même collection.
I
Lundi 22 mars, 10 heures, bureau du détective Mario Capello, rue des Réguaires, Quimper
De bon matin, Mario Capello m’appela car il se trouvait devant une affaire qui l’embarrassait profondément et il souhaitait avoir mon avis avant d’accepter de s’occuper du dossier. Il ne m’en dit pas davantage et, une fois prêt, je modifiai mon emploi du temps pour me rendre disponible, retenant mon déjeuner de midi au Colibri, en compagnie de Sarah et peut-être Blaise, pour faire un point sur l’autre affaire en cours, celle de l’inconnu de Rossulien. Mais pour l’heure, je me retrouvai au bout de la rue des Réguaires, que j’avais arpentée dans les deux sens dans mon enfance, pour aller depuis le domicile familial situé au-dessus de la gare de Quimper jusqu’à l’école Jules-Ferry, ou en revenir le soir, un peu plus instruit.
Dès qu’elle me vit, Julie Varaigne, la secrétaire de Mario, s’enquit de mon état de santé, ce qui me ramenait chaque fois aux folles nuits que nous avions passées ensemble, avant qu’elle ne s’amourache de mon collègue Mehdi, avec lequel elle formait un très beau couple. Je lui rétorquai qu’elle avait dû fatiguer mon cœur, naguère, pour qu’il batte à présent la breloque. Elle m’adressa un petit coup de poing complice dans les côtes, accompagné d’un regard qui se voulait féroce. Mario arriva et me demanda de le suivre dans son bureau, ce que je fis.
S’il n’avait pas changé physiquement, il avait beaucoup mûri depuis l’époque où il était jeune lieutenant dans l’équipe. À présent à son compte à la tête d’une agence de détective, Mario s’était constitué peu à peu une solide clientèle. Il filait le parfait amour avec Rose-Marie, qui l’épaulait si souvent dans les recherches informatiques. Tous deux étaient les parents d’un petit Théo qui faisait leur bonheur. Cela ne l’empêchait pas d’être toujours disponible quand nous avions besoin de lui. Sérieux, professionnel et discret, il s’occupait de dossiers de plus en plus consistants et n’attendait que mon départ en retraite pour me recruter à ses côtés. Je le savais par des rumeurs de bistrots, mais il pouvait toujours attendre… Pourtant, là, je ne le sentais pas très à l’aise dans ses baskets et le fait qu’elles soient neuves n’avait rien à y voir.
— Tu as entendu parler de la mort de Goulwena Le Brusc ? me lança-t-il tout de go.
— Oui, bien sûr, la jeune patronne de la société Les Dentellières, marque phare dans la production de crêpes dentelle quimpéroises, assurai-je en puisant dans ma mémoire. Un accident de plongée au large des Glénan, c’est affreux ! Elle avait 41 ans, me semble-t-il avoir lu, c’est jeune pour mourir de manière aussi tragique. Mais c’est la gendarmerie de Fouesnant qui suit le dossier, si je ne m’abuse ! Et d’ailleurs, il me semble que la thèse de l’accident va être accréditée, pas vrai ?
— C’est exact, mais j’ai reçu la visite de deux personnes qui sont convaincues du meurtre de Goulwena, maquillé en accident de plongée. Ils n’ont pas beaucoup de preuves et les gendarmes n’ont pas modifié leurs conclusions à la suite de leur témoignage. Et à présent le juge ne semble pas donner crédit à leur thèse… Ils aimeraient que je les aide à trouver des indices probants pour étayer leur dossier. Qu’en penses-tu ? Je ne veux pas me mettre les gendarmes de Fouesnant à dos, et pas plus l’entourage direct de la victime, ce sont des notables, à Quimper.
— Et qui est venu te voir, au juste, si ce n’est pas indiscret ?
— D’un côté Renaud Derrien, le directeur de la production des Dentellières qui, soit dit en passant, me semblait très amoureux de sa patronne défunte. Selon lui, Goulwena subissait de grosses pressions pour vendre la société au groupe américain Cake Foods. Notamment de la part du commanditaire de ce trust, Steve Wilson, un Franco-Américain d’une cinquantaine d’années, plutôt vorace. J’ai pris mes renseignements sur lui, voilà son pedigree, tout semble clean. Derrien pense ce businessman capable de faire éliminer une personne qui ne cède pas à sa volonté, quand il doit boucler une affaire.
— Un peu maigre pour s’attaquer à un tel requin, je trouve !
— Oui, moi aussi ! Autre détail, Jeannick Le Brusc, la tante de Goulwena, directrice des services financier et comptable des Dentellières, est, de son côté, favorable à cette vente qu’elle aurait d’ailleurs organisée dans le dos de sa nièce. Toujours selon Derrien, bien sûr ! Il faut dire qu’entre elles, ce n’était pas le grand amour. Il m’a suffi de me balader dans les bars autour de l’usine pour en avoir la certitude par les ragots qui courent. Comme on dit parfois, ces deux-là ne passaient pas leurs vacances ensemble. Le père Le Brusc avait choisi Rozenn, la maman de Goulwena, pour lui succéder et, entre les deux frangines, à ce qui se raconte, ça a toujours été à couteaux tirés.
— Et que devient cette fameuse Rozenn, la mère de la victime ? questionnai-je, sourcils froncés, pressentant déjà la réponse.
— Décédée voilà trois ans à son domicile, piétinée par son cheval dans un box des écuries ! répliqua Mario, fataliste. L’enquête de la brigade de la gendarmerie de Quimper a conclu à un accident mais, selon Renaud Derrien, Goulwena était convaincue que sa mère maîtrisait trop bien les chevaux pour se faire piétiner de la sorte. À la mort de la mère, la fille a quitté son poste de trader dans une grande banque parisienne pour prendre la suite. Comme Rozenn le souhaitait depuis quelques années, d’ailleurs. Elle avait 63 ans à sa mort, elle voulait passer le relais à la génération suivante, mais Goulwena se faisait prier pour accepter. Par ailleurs, sa sœur Jeannick, plus âgée que Rozenn de deux ans, était, elle aussi, prête à assumer les plus hautes responsabilités. Radio comptoir prétend même que ce poste est le rêve de sa vie, son ambition ultime.
Je regardai les documents que Mario me passait à mesure qu’il fournissait des explications sur le dossier. Une photo de Goulwena Le Brusc d’abord. La victime. La quarantaine, abord sympathique, charmant même, mais une femme à coup sûr dotée d’un fort tempérament.
Une experte de la plongée, comme sa mère l’était de l’équitation, troublante coïncidence que ces deux morts intervenues durant leurs loisirs. Mais les coïncidences n’ont pas force de preuve et un accident est si vite arrivé, dans des écuries comme au milieu de l’océan, même chez les plus brillants experts de la discipline.
Le pedigree de Steve Wilson, ensuite, le requin américain, pour qui la société Les Dentellières ne serait qu’une entreprise française de plus sur un carnet de chasse déjà bien rempli. Avec trop souvent, finalement, un transfert de savoir et de technologie du pays de base vers les États-Unis et la mainmise sur un savoir local avec pour objectif de le faire fructifier dans le monde. Pas forcément méchant ni malhonnête, le Yankee, mais impitoyable en affaires. Du genre prédateur vorace, même si l’habit ne faisait pas forcément le moine.
Enfin Jeannick Le Brusc, la tante quasi septuagénaire et toujours belle femme, elle aussi dotée d’un fort caractère et d’une détermination bien visible sur les photos réunies dans la chemise. De là à faire éliminer sa jeune sœur puis sa nièce, pour satisfaire un rêve de jeunesse et faire main basse sur le pactole tiré de la vente de la société familiale ? Ce postulat me semblait un peu énorme et représentait juste une hypothèse de travail, parmi d’autres sans doute. Mais le dossier contenait tout de même assez d’indices troublants pour se poser des questions légitimes.
— Tu en penses quoi, Paul ?
— C’est un peu léger pour te lancer dans une enquête, même si tout n’est pas très clair ! T’en prendre à l’Américain, tu oublies. Ce gars-là doit posséder une armée d’avocats et de juristes, experts dans les reprises de sociétés françaises. Sans te vexer, tu ne boxes pas dans sa catégorie. Pour ce qui est de la tante ambitieuse, je ne la vois pas entamer une vendetta familiale aussi sanglante pour mener son rêve à bien. Surtout si, selon les gendarmes de Fouesnant, la noyade accidentelle est avérée, comme trois ans plus tôt leurs collègues de Quimper ont eux aussi conclu à un accident pour la mort de la mère de Goulwena.
— C’est ce que je pensais jusqu’à ce que je rencontre hier la meilleure amie de Goulwena, qui n’était pas disponible plus tôt. Elle est kiné à Bénodet et a des horaires infernaux. Rosie et Sarah la connaissent d’ailleurs puisqu’elles fréquentent les clubs de voile et de plongée de Bénodet et des Glénan.
— Rosie t’a parlé de cette kiné ?
— Oui, Armelle Joannic, une jeune femme du même âge que sa copine décédée, dotée elle aussi d’un fort tempérament. Peu expansive mais efficace dans le groupe et passionnée de sports nautiques. Armelle se trouvait avec son amie au moment du drame et tout se passait normalement, à une profondeur habituelle. Quand elles ont décidé de remonter à la surface, elle seule a émergé de l’océan ; l’absence de Goulwena ne l’a pas affolée aussitôt, cela arrive parfois. Mais les minutes passant, elle s’est inquiétée. C’est en replongeant avec le directeur de l’école de plongée, un peu plus tard, qu’elle a compris que Goulwena avait eu un problème. Selon elle, le directeur a assuré aux gendarmes que la victime était une plongeuse trop chevronnée pour avoir commis une erreur de débutante. Il ne comprend pas ce qui a pu se passer et ne peut apporter d’explication.
— Les gendarmes de Fouesnant connaissent la plongée, modérai-je par instinct. S’ils ont conclu à un simple accident, ils ont bien leurs raisons. Je ne suis pas féru de plongée, mais on sait établir le distinguo entre un crime et une erreur fatale de la sportive.
— C’est exactement ce que j’ai répliqué à Armelle Joannic, figure-toi, reprend Mario, obstiné. Et elle m’a répondu que ce fut aussi le raisonnement des enquêteurs de Quimper, selon son amie Goulwena, à la mort de sa mère. Comment un cheval peut ainsi piétiner sa cavalière, sans raison apparente ? D’un autre côté, le rapport du médecin légiste ne semble relever aucune anomalie, comme un malaise, par exemple, ou encore un coup reçu qui aurait pu assommer la victime, voire une piqûre administrée pour l’endormir. La seule hypothèse, selon eux, aurait été que Goulwena se coince un pied sous un rocher, mais cela est très rare. Pour Armelle, il aurait fallu que deux gars l’attendent pour la retenir au fond, le temps nécessaire pour qu’elle s’asphyxie, avant de laisser le corps remonter. Mais elle n’a pas croisé d’autres plongeurs sur place…
— Donc, tu penses qu’on peut éventuellement se trouver devant deux meurtres maquillés en accidents, à trois années d’intervalle, avec pour mobile principal le pactole que représente la vente d’une société familiale bretonne ? questionnai-je, perplexe.
— Moi, je ne pense rien, Paul, je n’ai même pas la plus petite intuition fondée sur la question ! Je cherche juste à connaître ton ressenti, si tu es plus inspiré que moi. Dois-je me jeter dans la fosse aux lions ou botter en touche ?
— Si je raisonne simplement en flic, je fais confiance aux gendarmes, sur un tel dossier, avançai-je timidement. Pour l’une comme pour l’autre des deux affaires car, sur ces principes, toutes les décisions peuvent être remises en cause. Si je suis détective avec une boutique à faire tourner, récupérer un tel dossier doit faire entrer un peu de blé dans le silo et…
— Je t’arrête tout de suite, Paul, je ne suis pas à la recherche de clients nouveaux pour boucler mes fins de mois et, même si c’était le cas, ce n’est pas ma manière de pratiquer, rétorqua le Franco-Italien, piqué au vif.
— Je sais, Mario, je sais ! Je me fais juste l’avocat du diable. L’Américain, tu oublies ! En revanche, ces deux morts accidentelles en trois ans, ça me chiffonne un peu, moi aussi, pour tout t’avouer ! Soit on se trouve face à une loi des séries assez implacable, soit on se trouve face à un tueur particulièrement cynique et impitoyable.
— Moi, ce que je sais, c’est que je vais me trouver face à une tante visiblement retorse. Enfin ça, à la limite, j’en fais mon affaire. Mais sans doute aussi très vite confronté à un homme d’affaires franco-américain possiblement adepte des méthodes efficaces, si tous deux sont liés depuis quelques années par un plan assez machiavélique d’extermination des adversaires. Car, dans l’hypothèse d’un double meurtre, à trois ans d’intervalle, comment éliminer l’idée d’actes perpétrés par des complices sans scrupule, l’Américain employant des hommes de main expérimentés pour se débarrasser de la mère, puis de la fille, sans laisser la moindre trace de leur forfait ?
— Oui, c’est certain, dans ce cas, tu deviendrais une gêne dans leur plan, à ton tour…
— Et, accessoirement, je vais me retrouver avec les gendarmes de Fouesnant et de Quimper, qui vont me fusiller sur place de remettre ainsi en cause leur enquête, et je les comprends. Imagine que finalement la maman a bien agacé son cheval dans son box et que la fille a succombé à l’ivresse des profondeurs. Une tempête dans un verre d’eau.
— Que veux-tu que je te réponde ! soupirai-je, démuni. Fie-toi à ton instinct de fin limier, et si tu as le moindre doute sur les circonstances de la mort de Goulwena Le Brusc, tente d’en découvrir davantage, quitte à piétiner un peu les plates-bandes des pandores. Après tout, tu n’es plus flic, tu es détective, tu n’es plus soumis aux mêmes conventions de respect envers les pandores. Néanmoins, si tu te décides à suivre cette piste, va les voir à Fouesnant, auparavant, pour leur expliquer que tu ne remets pas en cause le sérieux de leur enquête. Précise que tu réponds juste à l’appel d’un client à qui, selon toute vraisemblance, tu annonceras très rapidement que ses doutes étaient infondés. Un type te paie pour faire la lumière sur ce drame, tu sais comme moi que cela arrive lors d’une affaire et les gendarmes devront l’accepter, comme nous le faisons au commissariat, chaque fois qu’une partie entame une contre-enquête. Si tu penses que tes informateurs sont fiables et sincères, je crois en mon âme et conscience qu’il y a matière à approfondir les causes de la mort.
— Donc, à ma place, tu te lancerais ? insista Mario, visiblement réjoui.