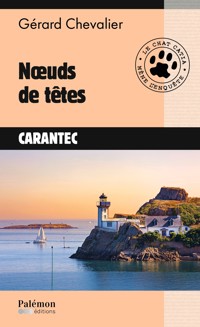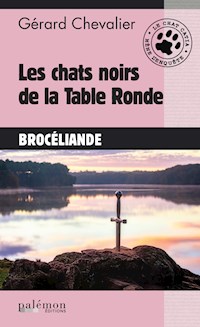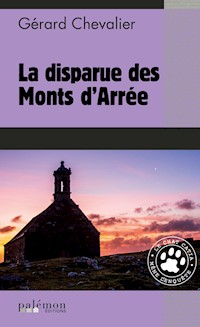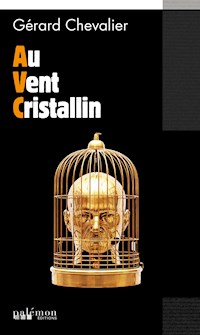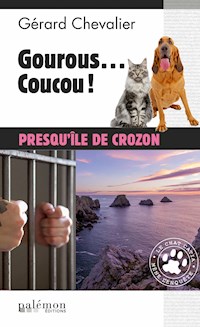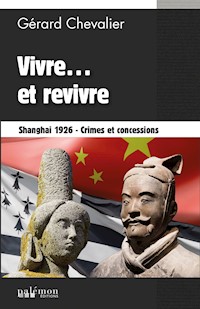Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Hugo Lemarzhus, jeune neurologue, mène une vie idéale avec sa femme Myriam et leurs enfants, partageant leur temps entre la Bretagne et les Hauts-de-Seine. Un jour, en allant chercher son fils à son cours de piano, à Ville-d’Avray, son lieu de résidence, il est soudain pris d’une impulsion irrésistible : il s’assoit devant l’instrument et joue à la perfection un concerto de Rachmaninov… alors qu’il n’a jamais pratiqué et ne connaît pas la musique.
Très vite, d’autres phénomènes étranges se produisent : Hugo a une vision prémonitoire insensée, parle couramment l’allemand ou l’italien sans avoir étudié ces langues, et exécute professionnellement des œuvres musicales indépendamment de sa volonté. Il se découvre alors un lien mystérieux avec François Erhardt, un célèbre pianiste assassiné des décennies plus tôt…
Sous l’impulsion de son épouse, Hugo, réfractaire à toute manifestation « paranormale », se lance avec réticence dans une enquête qui le mène de Paris à Strasbourg, au cœur des cercles feutrés de la grande musique classique. Mais derrière les notes se cachent jalousies, secrets inavoués et rancunes mortelles. Remuer les ombres d’un meurtre oublié n’est pas sans danger : l’assassin a peut-être encore des comptes à régler…
Dans "Accords mortels", Gérard Chevalier mêle avec brio suspense policier, passion musicale et mystère psychologique, un roman où l’intrigue se déploie comme une partition, jusqu’à l’accord final.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Tour à tour artiste peintre, décorateur, maquettiste, acteur, metteur en scène, scénariste, Gérard Chevalier devient auteur de romans policiers en 2008. Après son premier ouvrage "Ici finit la terre" (Grand Prix du Livre Produit en Bretagne, Prix du Roman Policier Insulaire à Ouessant, 2e prix du Goéland Masqué) suivent d’autres romans dont la série humoristique "Le chat Catia mène l’enquête" qui rencontre également un véritable succès. Gérard vit aujourd’hui à Carantec.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
CE LIVRE EST UN ROMAN.Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
Retrouvez ces ouvrages sur www.palemon.fr
Le site de l’auteur : www.gerard-chevalier.com
Tout est déterminé par des forces sur lesquelles nous n’exerçons aucun contrôle. Ceci vaut pour l’insecte autant que pour l’étoile. Les êtres humains, les légumes, la poussière cosmique – nous dansons tous au son d’une musique mystérieuse, jouée à distance par un flûtiste invisible.
Albert Einstein
1
Elle est belle, malgré son visage à l’expression triste. Ses yeux vert clair regardent l’inéluctable. Sa résignation m’atteint alors que je devrais garder la distance indispensable à mon équilibre, donc à mon efficacité. Je suis un jeune neurologue. Je viens de m’installer. Si je commence à m’apitoyer sur mes patients, la dépression nerveuse me détruira à brève échéance. L’effort pour analyser la situation clinique de Mademoiselle Bertin est difficile. Probablement parce que je ne peux pas lui apporter une guérison durable. À vingt-huit ans, elle est atteinte d’une dystrophie myotonique de Steinert, maladie incurable d’origine héréditaire dans son cas. Cela se traduit par des raideurs musculaires, avec faiblesse et fatigue en corollaire. Je ne peux que la soulager en lui prescrivant de la kinésithérapie régulière, et en la recommandant à une diététicienne de ma commune, Chaville dans les Hauts-de-Seine, où mon cabinet est situé. Un contrôle chez un confrère cardiologue s’impose, car elle risque des troubles sévères. Mon ordonnance et les lettres de recommandation terminées, je m’efforce de la rassurer. Elle s’accroche à mes paroles avec l’intensité de l’espoir et quitte mon cabinet en me souriant, ce qui me fait mal. Il est nécessaire de passer tout de suite à autre chose pour évacuer mon sentiment de compassion. Je n’ai plus de rendez-vous aujourd’hui.
Étant en exercice depuis quatre mois, je ne suis pas encore surchargé de travail, mais je ne me plains pas : ma clientèle est en constante augmentation. Il est dix-sept heures trente, et la grande joie d’aller chercher mon petit garçon à la fin de son cours de piano à dix-huit heures, au conservatoire de Ville-d’Avray, m’est offerte. Je range quelques papiers, inspecte du regard ce modeste local, bien organisé et décoré sobrement, que mes parents et beaux-parents m’ont aidé à acquérir. Il est au rez-de-chaussée d’un petit immeuble neuf, construit en bordure de la forêt de Fausses Reposes. C’est agréable de travailler dans ces conditions.
Mon père, architecte en Bretagne, à Guerlesquin, et mon beau-père, directeur d’une grosse agence d’assurances, ont tenu à avancer les fonds, afin que je puisse commencer à exercer, sans perdre de temps, dans la médecine dite libérale. Je mesure pleinement la chance, non seulement que ma famille ait été en capacité financière pour investir dans mon local, mais aussi sa générosité exempte de tout intérêt mercantile. La conscience de ma chance dans tous les domaines est présente à mon esprit. Mon parcours universitaire s’est effectué normalement (j’ai beaucoup travaillé, il est vrai). J’ai rencontré Myriam, mon épouse, il y a dix-sept ans, sans que nous nous lassions un seul instant de notre présence mutuelle, bâtie sur un amour puissant et une confiance absolue. Nos deux enfants, Arthur et Charlotte, donnent envie d’en avoir aux amis qui n’en ont pas. Arthur a six ans, Charlotte quatre. Mon aîné a manifesté vers trois ans un goût presque anormal pour la musique que nous avons encouragé avec enthousiasme. Au château de Ville-d’Avray, construit par Marc Antoine Thierry, premier valet de Louis XVI, racheté par la ville en 1969, un conservatoire de musique a été créé, et nous avons inscrit notre petit garçon lors de ses quatre ans. La professeure de piano est émerveillée de constater l’engouement d’Arthur, et les progrès réalisés en deux ans. Peut-être son élève deviendra-t-il un grand concertiste. Pourquoi pas ?
Ma femme est une artiste peintre déjà renommée dans sa profession, et l’art tient une grande place dans notre vie. Cela me semble naturel que son fils soit doué, même si cela se traduit dans un autre domaine. Dans notre maison, qui appartient à ses parents, une annexe est aménagée en atelier équipé de grandes baies vitrées et d’un puits de lumière qui perce le toit. Je reste souvent auprès de Myriam, la regardant élaborer sa toile de son style particulier, totalement absorbée, jusqu’à oublier que je suis là. C’est fascinant.
Je ferme mes volets électriques, jette un dernier coup d’œil avant de verrouiller la porte. Il n’y a pas trop de circulation ce vendredi soir. Après avoir averti mon épouse que je prends Arthur à la sortie de son cours, je me gare devant le bâtiment, rue de Marnes, avec cinq minutes d’avance. Doucement, je rentre dans la salle où mon petit bonhomme est en train de jouer et m’assieds silencieusement. Madame Larrieux, sa professeure, m’adresse un signe de tête discret pour ne pas distraire son élève, concentré, qui exécute La Lettre à Élise de Beethoven, dont les premières notes sont massacrées par bon nombre de mises en attente téléphonique. Je ne suis qu’un amateur en musique, mais il me semble percevoir chez mon fils une certaine maîtrise dans son jeu. C’est très émouvant de voir ce petit être déjà complètement investi, oubliant, comme sa mère le fait, ce qui est autour de lui. Il termine le bras levé sur la dernière note, comme les professionnels en concert. Cela m’amuse beaucoup.
— C’est bien, commente sa professeure, mais tu devrais plus marquer…
Elle lui explique ce qu’elle a soigneusement observé.
— Voilà. Ton papa est là !
Il se retourne, descend de son tabouret et se précipite dans mes bras. C’est un instant chargé d’une force d’affection indescriptible. Je suis transporté comme à chaque fois que cela se produit. Je ne m’en lasserai jamais.
— Arthur a progressé, c’est bien, dit Madame Larrieux en me serrant la main. Je vais lui donner un exercice à faire pour la prochaine leçon.
Tandis qu’elle s’éloigne pour chercher la partition, Arthur me dit à voix basse :
— Tu veux bien m’acheter un Playmobil au Bazar Bleu ?
— D’accord.
— Ouais !!!
Le Bazar Bleu sans D, tel qu’il est inscrit sur le magasin, est une institution datant de plusieurs décennies. On y trouve une quantité d’objets et de fournitures incroyables, dont des jouets et des jeux. Des générations d’enfants viennent s’y approvisionner.
— Voilà, tu verras, c’est relativement facile, mais très important pour t’habituer au croisement des mains.
— Merci, madame.
— Votre femme prépare bien son exposition ?
— Oui, elle travaille beaucoup.
— J’aime sa peinture. Nous sommes convenus que je lui achèterai une toile.
Alors que nous allons prendre congé d’elle, Madame Larrieux m’interpelle.
— Je voulais déjà vous le demander il y a longtemps. Vous jouez du piano, monsieur Lemarzhus ?
Alors que j’ouvre la bouche pour lui répondre, le temps se fige. Je m’approche de l’instrument, l’effleure d’un doigt, me penche brusquement pour régler le tabouret et m’assieds. Une seconde de vide absorbe toute réalité, et je vois mes mains qui s’agitent à une vitesse incompréhensible, alors que mes oreilles perçoivent le Concerto n° 3 de Rachmaninov. Je ne vois plus que le clavier, je ne sais plus où je suis. La musique submerge tout. Elle m’a emporté, intégré dans un déferlement dont la puissance me procure une sensation intense, prodigieuse. Le temps n’existe plus. Quand mes mains s’arrêtent en suspens, je reste hébété, luttant pour revenir où je me trouvais avant… Je n’ai jamais touché un piano depuis que je suis né.
Les applaudissements de Madame Larrieux et d’Arthur me sortent de ma torpeur. Je me lève un peu hagard pour constater la gêne de la professeure.
— Je suis confuse, dit-elle, je ne savais pas que vous étiez un professionnel de haut niveau. Vous donnez des concerts en même temps que vous consultations de neurologie ?
— Oh, non… Je… je ne fais que de la médecine.
— Ah, bon ! Pardonnez-moi, mais vous devriez abandonner vos activités médicales. Quand on a un tel talent, c’est du gâchis !
Nous regagnons la voiture, et je redoute les questions de mon petit garçon. Je suis… sonné, comme un boxeur après son K.O.
— Pourquoi tu m’as pas dit que tu jouais du piano ?
— Parce que… ce n’est pas important.
— Si ! Tu pourrais m’aider. Tu joues bien, en plus.
— L’important est que tu travailles avec Madame Larrieux. Je n’ai pas le temps de te faire progresser.
Alors que je vais introduire la clef dans le contact de ma voiture, je réalise que ma femme ne doit pas être avertie du phénomène venant de se produire.
— J’ai oublié de dire quelque chose à ta professeure. Viens avec moi, tu resteras dans la cour.
La jeune femme est déjà occupée avec un autre élève. Elle vient vers moi, surprise de mon retour.
— Que se passe-t-il ?
— Je voulais vous demander d’être discrète quant à mes aptitudes au piano. N’en parlez pas à ma femme, s’il vous plaît.
Elle me dévisage avec un petit sourire sarcastique.
— Je ne me mêle pas de la vie des autres, mais je me demandais comment vous pouviez concilier la musique et la médecine. Vous devez passer au moins six heures par jour sur le clavier pour interpréter comme vous le faites.
À la vue de ma réaction embarrassée, elle éclate de rire.
— Pardonnez-moi, cela ne me regarde pas. Rassurez-vous, je n’en parlerai à personne.
— Je vous en sais gré. À bientôt, madame.
Elle me lance au moment où je franchis le seuil de la porte :
— Je comprends mieux pourquoi Arthur est doué !
Je récupère mon petit garçon en grande conversation avec un chat sur le muret du jardin. Il saute d’un pied sur l’autre, tout joyeux à la perspective de la visite au Bazar Bleu.
— Tu avais oublié de lui dire quoi, à ma prof ?
Bonne question à laquelle je m’attendais.
— De ne pas dire que je sais jouer du piano.
— Ah ! Mais pourquoi ?
— C’est un secret entre toi et moi !
— Maman ne le sait pas ?
— Non. C’est… je veux lui faire une surprise plus tard.
— Ouais ! Ça lui fera drôlement plaisir.
Je glisse sur une pente dangereuse. Comment expliquer ce qui vient de se passer ? J’ai besoin de me calmer, d’apaiser le tumulte de mes pensées.
— Que veux-tu comme Playmobil ?
— Le vaisseau spatial de Star Wars !
— Tu penses qu’il existe ?
— Oui ! Je l’ai vu !
Je m’accroche à sa joie enfantine pour m’extraire de mon tourment. Je ne crois pas au surnaturel, aux manifestations paranormales. Les récits des légendes bretonnes et leurs personnages mythologiques ont bercé mon enfance, mais sont restés dans mon imaginaire, sans engendrer aucune croyance ou superstition. Mon père est né à Saint-Brieuc, mais, après ses études d’architecture aux Beaux-Arts de Paris, il s’est établi à Quimper, puis à Guerlesquin, où il vit actuellement avec ma mère qui, elle, est vendéenne. Mes parents ont horreur de la ville. Ils m’ont inculqué leur pragmatisme et le goût du merveilleux (notre nom Lemarzhus signifie « le merveilleux » en langue bretonne) accompagnés du respect pour les religions et les opinions des autres. Mais pas question de faire tourner les tables ou de deviner l’avenir, ce qui accentue mon désarroi en rapport avec ce qui vient de se passer.
— Tiens, le voilà ! Tu vois, Papa, j’avais raison !
Il est tellement heureux que je m’abstiens de lui faire observer la marque Lego au lieu de Playmobil. Mes enfants me régénèrent. Si je leur ai donné la vie, eux me donnent la justification de la mienne, en éradiquant l’égoïsme, en construisant ma famille, racine de notre passage sur terre.
Le fouillis de la boutique est réjouissant. J’y viens depuis que j’ai loué un studio ici pour faire mes études à la faculté de médecine à Paris. J’aurais pu aller à Rennes, mais c’était l’époque où j’étais en rébellion avec mes parents, conséquence d’une adolescence très tardive. Je ressentais le besoin de m’éloigner impérativement. Comme je ne trouvais aucun logement décent à Paris, ou alors à un prix prohibitif, en explorant les annonces de banlieue, celle indiquant un grand studio à Ville-d’Avray avec vue sur la forêt, à moitié prix, emporta mon adhésion et celle de mes parents. Heureusement, je possédais une moto 125 cm3, car le transport était long et compliqué. Le propriétaire du studio avait une fille ravissante dont je suis tombé amoureux au premier regard. Quatre ans après, elle devenait ma femme. Ses parents m’ont adopté, au point de me considérer comme le fils qu’ils n’ont pas eu.
Myriam a deux sœurs, et mes beaux-parents n’ont pas voulu tenter un enfant supplémentaire pour avoir un garçon. Je me sens aussi proche d’eux que de mes propres géniteurs. Georges Tellier, mon beau-père, a conquis sa situation grâce à son caractère opiniâtre. C’est un homme courageux, intelligent et humain, ce qui lui a causé des problèmes avec son métier d’assureur pour lequel sa générosité n’était pas toujours en phase. Il est plus abordable que mon père, râleur, à l’humeur changeante, mais tout aussi généreux.
Ma belle-mère est antiquaire. Son mari lui a acheté une boutique où sa passion pour les beaux objets perdure. Elle se trouve rue de Saint-Cloud, pas loin de leur maison qui est la nôtre maintenant. L’agence de mon beau-père est à Boulogne-Billancourt, à quatre kilomètres de Ville-d’Avray. Comme il faut franchir le pont de Sèvres, cela nécessite parfois près d’une heure pour les parcourir, tant la circulation est dense.
C’est constamment une fête de rentrer chez moi, d’embrasser Myriam, de lui exprimer mon amour. La réciproque est infailliblement au rendez-vous. Pour la première fois, je dois lui cacher quelque chose, ce dont elle s’aperçoit immédiatement, mais se méprend sur la cause de l’anomalie.
— Oh, toi, tu as eu une dure journée, même si elle a fini tôt.
— C’est vrai. J’ai eu deux cas difficiles.
Manière hypocrite de répondre, mais pas loin de la réalité.
— Mon pauvre chéri. Tu vas oublier tout ça pendant le week-end.
Un choc à la hauteur de mes genoux me fait vaciller, alors que deux petits bras enserrent mes jambes. Charlotte vient de se précipiter sur moi. Je pousse un faux cri de colère, l’attrape, la soulève, et s’ensuit une séance de baisers et de chatouillis, ponctués de ses éclats de rire, provoquant une onde de bonheur.
— Regarde, Maman ! Papa m’a acheté un vaisseau spatial !
— Oh, quelle belle maquette ! Tu as bien joué du piano pour le mériter ?
— Oui ! Madame Larrieux était contente. Et…
J’interviens pour lui éviter d’éveiller l’attention de Myriam.
— Il a fait des progrès notoires. On peut être fiers de notre fils.
Nouvelle séance de tendresse qui me fait du bien. Je relègue ma perturbation dans un placard mémoriel à ouvrir dans le futur.
— Ta mère a appelé il y a deux heures. Elle voudrait qu’on soit tous réunis pour Noël, avec mes parents et mes sœurs. Tu en es d’accord ?
— Évidemment. Et ta famille aussi ?
— Pas encore, je voulais te consulter d’abord.
— Étant donné mon métier, cela tombe sous le sens !
J’accroche mon manteau et me dirige vers l’atelier.
— Alors, comment évolue ton œuvre ?
— Pas bien. Je ne suis pas satisfaite.
Charlotte suit son frère dans leur chambre, et je me plante devant la grande toile en cours d’élaboration. Ma femme possède un style caractéristique de sa riche personnalité. Ce qu’elle peint, quel qu’en soit le sujet, me plaît. Mon père m’a initié à l’art pictural, et je connais les œuvres des grands peintres. Les toiles de Myriam, que ce soient des paysages ou des natures mortes, m’apparaissent entre les manières de Soutine quant à la représentation, et de Chagall pour l’inspiration, poétiques et surréalistes. Un des deux étangs, dit de Corot, est le sujet de son tableau en cours. Le grand peintre en a donné de belles versions, mais Myriam, tout en ressentant l’atmosphère prenante de ce lieu, est dans une tout autre expression. Son originalité est flagrante, ce qui me ravit. J’estime qu’elle a beaucoup de talent. Je ne suis pas le seul puisque les galeries l’invitent de plus en plus.
— Qu’est-ce qui ne te convient pas ?
Elle hésite avant de me répondre.
— Je n’arrive pas à créer une palette de couleurs qui sorte de l’ordinaire. C’est trop… trop fade, trop conventionnel.
Je ne suis pas d’accord, mais me garde bien de le lui dire, sachant que je n’apporterais rien de constructif.
— Peut-être devrais-tu t’accorder un répit d’un jour ou deux. Tu aurais un œil plus neuf.
Elle soupire, absorbée dans son monde où les paroles sont remplacées par des couleurs, où l’alchimie de la lumière et des formes ne s’exprime pas verbalement, à part ceux qui critiquent, qui « voient » ce que les peintres n’ont même pas imaginé.
— Oui, tu as raison. On va passer un week-end tranquille, à se promener, à jouer avec les enfants.
Je lui susurre mon accord à l’oreille avec quelques suggestions supplémentaires, ce qui me vaut un baiser incendiaire.
Je téléphone à ma mère avant le dîner. Elle vient juste de terminer une analyse. Elle est graphologue, et passionnée par l’exercice de sa profession, pour laquelle elle n’a cessé de se perfectionner. Elle a le statut d’expert auprès des tribunaux. Dernièrement, le tribunal de grande instance de Brest a pu démêler une sombre histoire d’escroquerie grâce à son savoir-faire.
À soixante ans, Madame Estelle Lemarzhus répand son trop-plein d’énergie entre son activité et son foyer, ce qui rend mon père grognon assez souvent. Monsieur l’architecte est un contemplatif qui a besoin de plages de calme pour inventer des objets qu’il fabrique ou pour écrire, sans vouloir révéler la teneur de ce qu’il confie à ses cahiers. C’est parfois brutal.
« Tu ne vois pas que je suis occupé ? J’aimerais bien que tu respectes mon travail !
— Ton travail ! Quel culot ! »
C’est à son tour de bougonner. Il en est ainsi depuis qu’ils vivent ensemble, c’est-à-dire depuis trente-six ans.
— Hugo, mon chéri !
— Bonsoir, Maman. Tout va bien ?
— Mais oui. Je constate que Myriam a bien fait la commission. Alors ? Tu es d’accord ?
Nous entamons une conversation au cours de laquelle je retrouve mon enfance, redoutant les recommandations de bien me couvrir s’il fait froid et de faire attention aux voitures en traversant la rue. Je suis fils unique, et mes jeunes années ont été marquées par une santé fragile. Cela a provoqué une surveillance vigilante à mon égard et un amour inconditionnel de mes parents.
— Au revoir, mon chéri, et ne te surmène pas trop ! Tu dors bien au moins ?
Myriam a suivi mon conseil, et n’a pas touché un pinceau ou un couteau de tout le week-end.
Le début octobre est très doux, et nous nous sommes promenés dans ce magnifique parc de Saint-Cloud, dont je connais les moindres recoins. Nous avons déjeuné à notre guinguette favorite, dernier repas dans ce lieu exquis avant sa fermeture pour l’hiver.
Lundi matin, je dépose les enfants, l’une à la maternelle, l’autre en C.P. Bon nombre de parents et moi nous saluons, à l’un et à l’autre des deux établissements. Arthur est tout heureux de retrouver son meilleur ami, Guillaume Vallois, fils d’un commandant de police du commissariat de Sèvres. L’homme âgé d’une quarantaine d’années a plus le physique d’un artiste que d’un membre des forces de l’ordre. Il vient souvent nous déposer son fils, et je fais de même depuis un an et demi. Nos conversations se limitent à des banalités, sauf sur la peinture, car il s’intéresse aux œuvres de ma femme. J’ai aperçu son épouse deux ou trois fois. Elle me semble un peu réservée, pour ne pas dire distante. La vie privée avec un policier ne doit pas être aisée. Il faut une grande force de caractère pour ne pas laisser déborder les malversations, la violence des délinquants sur son comportement lorsque la journée de travail est finie. Un peu ce que je ressens aussi. Les Vallois me sont sympathiques. J’établirais bien une relation plus approfondie avec eux.
J’arrive à mon bureau à huit heures trente-sept. Mon premier rendez-vous est à neuf heures quinze. À peine suis-je assis devant mon bureau que ressurgit dans mon esprit ma prestation insensée au conservatoire de musique. Je ne vois aucune explication. Il ne faut pas que ce… ce quoi ? Mystère, phénomène ? … Peu importe. Ce n’était pas désagréable, loin de là, et je ne dois pas me laisser envahir par une obsession ou un sentiment négatif. J’ai trop besoin de ma stabilité pour mes patients et ma famille. Puisque ma raison ne veut pas l’admettre, eh bien qu’elle l’oublie… autant qu’elle le peut.
La semaine s’écoule à une vitesse accélérée. Accaparé par de nouveaux patients, il a fallu mobiliser toutes mes connaissances pour les soigner le mieux possible. J’ai réussi pour la plupart, mais il y a des cas pour lesquels je dois effectuer des recherches. Il y a énormément d’évolutions dans ma spécialité, et une mise à jour des progrès s’avère incessante. En décembre se tiendra à Vienne, dans le très moderne hôtel Mélia, un congrès des médecins neurologues du monde entier, dont le thème est la maladie de Parkinson. Ma participation est réservée, et j’en profiterai pour emmener Myriam. Nous avons toujours envisagé de visiter cette ville, ses exceptionnels monuments baroques, et son histoire illustrée par tant d’événements au cours des siècles.
Le week-end est déjà de retour. Il est nécessaire que j’aille changer la batterie de mon téléphone portable. Levé de bonne heure, comme à mon habitude, je laisse les miens encore tout ensommeillés et pars à Versailles. J’aime cette ville chargée d’histoire, à taille humaine, dont nous visitons régulièrement le fabuleux château et son magnifique parc.
Je me gare route de la Reine et, comme la boutique de téléphonie n’est pas encore ouverte, je flâne dans les rues.
Il y a peu de monde à cette heure matinale, et marcher dans cette ambiance tranquille me fait du bien. Je reviens de mon périple en passant par la rue Gallieni. Alors que je jette un coup d’œil distrait sur les boutiques, un violon, exposé en vitrine avec d’autres instruments, capte mon regard. Je me fige d’un bloc. La lumière autour de moi s’assombrit, la rue disparaît, et le violon s’approche de moi, bouge… Il est dans les mains d’une femme qui en joue, en maniant l’archet avec virtuosité. Ses cheveux flamboyants volent dans tous les sens. L’énergie de sa passion irradie, et j’entends un passage d’un concerto familier…
— Excusez-moi, monsieur, je voudrais voir le prix de cet instrument.
J’émerge de ma vision, ou de mon rêve saugrenu, pour m’excuser auprès du jeune homme à mes côtés.
— Bien sûr, pardonnez-moi.
— Pas de soucis. Je comprends que vous soyez captivé. C’est un violon exceptionnel.
Je m’écarte pour lui céder la place. Combien de temps suis-je resté devant la vitrine ? Ce n’est pas mon habitude d’avoir une telle rêverie. D’ailleurs, ce n’était pas une rêverie. J’étais transposé dans un environnement réel… avec de la grande musique classique… Bouleversé, je me dirige vers la rue de la Paroisse, ma boutique doit être ouverte maintenant. Que m’arrive-t-il ? Suis-je atteint de schizophrénie ? Non, il y aurait d’autres symptômes. C’est beaucoup plus troublant, car je me suis senti exactement dans la même… atmosphère qu’au conservatoire, lorsque j’ai interprété du Rachmaninov.
Je n’arrive pas à me reconnecter dans mon banal quotidien. J’assiste au changement de ma batterie comme si je voyais la manipulation sur un écran. L’air de la rue en rejoignant ma voiture m’apaise un peu. Est-ce le début d’une… J’allais penser le mot « pathologie ». Non, ce n’est pas ça. Ne pas s’affoler, rester maître de soi, s’ancrer à ce qui existe près et autour de moi ! Voilà, c’est la condition à tenir. J’adopte l’antienne populaire : on verra bien.
À Ville-d’Avray, je m’arrête à la boulangerie pour prendre des croissants. Il y a des amateurs à la maison, qui sont dans la cuisine, tout juste installés devant leur petit-déjeuner. Je suis accueilli tel un sauveteur en haute montagne. Mais c’est moi qui suis sauvé de mes émotions. Myriam me prévient d’un déjeuner avec ses parents et, pendant qu’elle fera les courses pour préparer le repas, je m’occuperai de nos enfants. C’est un programme qui me convient très bien.
La séance du bain expédiée, avec les bateaux qui jettent de l’eau et les bêtes qui nagent, nous allons dans le parc du côté de Marnes pour voir si quelques champignons ne traînent pas. Mon père m’a initié à la mycologie et, une fois les sept catégories mortelles bien identifiées, je me targue d’une bonne connaissance des espèces. C’est un jeu captivant pour Arthur de les chercher. Sa petite sœur ne le suit pas forcément. Elle est plutôt attirée par les beaux cailloux ou les fleurs.
Quand nous rentrons, les grands-parents sont déjà là. Ma belle-mère a dû passer à la maison hier, ce qui ne l’empêche pas de se précipiter sur ses petits-enfants comme si elle ne les avait pas vus depuis six mois. Mon beau-père m’observe.
— Tout va bien, Hugo ? Tu as l’air préoccupé.
— Non, non, il n’y a rien de spécial.
— Tes patients ne grignotent pas trop ton existence ?
— J’essaie de les maintenir à distance.
Nous rejoignons la cuisine où l’on nous jette à la porte aussitôt.
— Mettez le couvert, et servez-nous à boire !
Nous exécutons les ordres en faisant participer les petits, impatients de croquer les délices de l’apéritif.
— Donc, tout va bien ? reprend mon beau-père.
— Mais oui. Il y a nettement plus de gens qui viennent consulter. C’est très bon signe.
Je passe évidemment sous silence mes… avatars que je ne sais toujours pas qualifier. Peut-être n’y en aura-t-il pas d’autres.
Le déjeuner incarne l’image d’une famille privilégiée, consciente quand même de son harmonie.
Quand Georges et Jacqueline nous quittent dans l’après-midi, Myriam va dans son atelier et je décide de lire, tandis que les enfants jouent dans le jardin. C’est un terrain en pente assez grand aux multiples recoins aménagés de buissons, où les parties de cache-cache se déroulent à satiété. Il est prévu que nous irons au cinéma à Garches ce soir, un film d’animation jeunesse étant au programme.
Je repose mon livre sans assimiler la moindre phrase du Goncourt 2020. La vision de ce matin est revenue s’imposer dans L’Anomalie, titre du livre de Le Tellier, presque homonyme de mon beau-père. Furieux contre moi-même, je viens m’asseoir silencieusement à côté de mon artiste préférée.
— Tu ne lis pas ?
— Non, j’aime mieux te regarder peindre.
— D’accord, mais tu ne dis rien.
— Ça tombe bien, je n’ai pas envie de parler.
J’observe la transformation des couleurs pendant une heure, avec le désir de m’immiscer dans son cheminement particulier. J’abandonne, n’arrivant pas à deviner les nuances qu’elle dépose par petites touches. Je vais dans notre salon et mets un CD dans le lecteur de la chaîne. J’évite de choisir un morceau avec du violon, et Tannhäuser de Wagner m’apparaît approprié à mon humeur. Pourtant, malgré la vigueur des sonorités, je m’endors, ayant sans doute besoin de détendre mon système nerveux, comble d’ironie pour un neurologue. Myriam me réveille en rentrant de son atelier. J’ai dormi près de deux heures !
— Oh, tu as dormi tout ce temps-là ?
— Non, pas tout à fait. J’ai écouté de la musique aussi.
Elle est surprise, mais s’abstient de commenter mon comportement qu’elle attribue à une fatigue passagère.
— Si on allait manger un couscous de bonne heure ? proposé-je.
— Quelle bonne idée !
La soirée au restaurant l’Étoile de Tiznit d’abord, et au cinéma ensuite, achève cette journée de bonheur tranquille.
2
Le rythme des semaines reprend sans que rien ne vienne perturber mon travail ou mon temps libre. Mes tracas hallucinatoires s’effacent petit à petit jusqu’à leur évacuation totale.
Myriam et moi sommes en partance à l’aéroport de Roissy pour Vienne. Les enfants sont à la garde des grands-parents qui vont passer tous leurs caprices, à la suite du chantage dû à notre abandon ! Il est vrai que nous nous sentons délicieusement en faute à l’idée d’être uniquement tous les deux pendant huit jours. Cela ne nous est pas arrivé depuis deux ans.
L’architecture et l’aménagement de l’hôtel Mélia sont époustouflants. Notre chambre, spacieuse, offre une vue étendue sur le Danube et ses environs. Le congrès est prévu pour demain, ce qui nous octroie une première grande soirée de vacances. Après avoir déposé nos deux valises à l’hôtel, je négocie difficilement, en anglais, les services d’un taxi pour effectuer une première visite de cette ville aux charmes multiples. Il nous emmène voir les principaux monuments ou quartiers fréquentés par les touristes, comme il se doit. Et comme les touristes, nous nous émerveillons devant le grand palais de Hofburg, la cathédrale baroque Saint-Charles, le Rathaus, l’hôtel de ville, et nous achevons la tournée au Griechenbeisl, le plus vieux restaurant de la ville datant de 1447. Nous rentrons à l’hôtel quelque peu éméchés par la bouteille de Steinertal qui a irrigué notre bon dîner. Comme nous sommes euphoriques, amoureux, le début de la nuit est à la hauteur de ce voyage d’exception.
La grande salle de l’hôtel, consacrée aux séminaires ou aux congrès, est équipée à chaque place des participants d’un système d’écoute, avec casque et bouton amplificateur de son, afin d’entendre les exposés traduits dans les principales langues, tels l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le français, l’arabe et le suédois. Lorsque le professeur Radcliff ouvre la séance en présentant les intervenants, j’aperçois quelques sommités de ma spécialité dont j’ai lu des articles dans des revues médicales. Le premier neurologue anglais qui prend la parole est un peu ennuyeux, car il n’est pas doué pour discourir et n’apporte aucun élément nouveau sur la maladie de Parkinson, sujet de notre réunion. Qui a eu la mauvaise idée de l’inviter ? Heureusement lui succède Chiara Zurzolo, une brillante chercheuse italienne responsable de l’unité « Trafic membranaire et pathogenèse » à l’Institut Pasteur. Elle nous rapporte l’avancée de ses derniers travaux sur les lysosomes et les inhibiteurs d’enzymes responsables de la dégradation de la dopamine. Même traduite, on ressent une dialectique rodée, une clarté d’esprit éblouissante. Son engagement pour la maladie d’Alzheimer est bien connu. Je suis très admiratif de cette personne.
L’orateur suivant n’est pas non plus inintéressant, sans être du même niveau. Je prends des notes régulièrement, comme tous mes confrères. C’est au tour d’un médecin allemand d’accaparer l’auditoire. À notre grande surprise, il reprend les termes exposés par Chiara Zurzolo sur les lysosomes, leur contenu en enzymes hydrolytiques, sans ajouter quoi que ce soit. De plus, il se permet de critiquer les travaux d’un professeur espagnol dont nous apprécions à peu près tous les recherches sur le sujet. Nous échangeons des regards éberlués, alors qu’il devient carrément injurieux. Je ne suis pas fils de Breton pour accepter une pareille offense. Comme personne ne réagit, je laisse aller ma colère. Je me lève et, d’une voix la plus forte possible, je l’interromps et lui exprime mon indignation. Mes propos enflammés concernent d’abord sa grossièreté hors de propos, et ensuite son manque de connaissance nouvelle sur le sujet de notre réunion. J’en profite également pour lui suggérer d’approfondir son métier. Je me rassieds dans un silence absolu. Avec une seconde de décalage due à la surprise, un tonnerre d’applaudissements éclate. Le malotru sur son estrade devient rouge de honte et prend la décision de quitter la salle sous les huées de toute l’assemblée. Mon voisin de droite se penche et m’adresse ce qui doit être des félicitations, mais en allemand. Alors que je vais lui manifester mon incompréhension, je reste pétrifié, la bouche ouverte. Je réalise soudainement que j’ai agressé le médecin indélicat dans sa langue, c’est-à-dire… en allemand ! Je n’ai aucune notion de cette langue. Je ne l’ai jamais étudiée, même sommairement. Le choc est vertigineux. Devant mon attitude anormale, mon confrère doit s’enquérir de mon trouble, tel que je perçois son ton interrogatif. Alors que je vais lui répondre en anglais par une mauvaise justification, le professeur Radcliff, qui me remercie au micro, sauve la situation. On enchaîne avec un autre spécialiste, mais je n’écoute plus. J’occulte le temps depuis mes bizarreries précédentes pour aboutir à ce bilan insensé :
1) J’ai joué professionnellement du piano ;
2) J’ai eu une vision d’un instant qui me paraît vécue ;
3) Je viens de pratiquer aisément une langue que je n’ai jamais étudiée.
Que va-t-il se produire dans mon futur ? Y a-t-il déjà eu ce genre de phénomène précédemment sans que les médias le relatent ?
Je n’ai pas suivi le reste de la matinée, et je pars déjeuner ailleurs que dans l’espace prévu pour les membres du congrès. Il n’est pas question de subir les réflexions, même enthousiastes, suscitées par mon intervention. À ce stade, dois-je parler de ce qui m’arrive avec Myriam ? Nous sommes très unis, nous apportant réciproquement du réconfort lors de nos états d’âme en peine. Il ne faudrait pas que notre couple souffre stupidement d’une altération de mon caractère due à ces événements… paranormaux, je dois bien admettre le terme. Et puis, si je suis surpris, ce n’est pas non plus un drame épouvantable. Satisfait provisoirement par mon analyse, je me cache dans un des restaurants de l’hôtel et expédie mon repas. C’est décidé, je raconterai tout à ma femme, ce qui me rassérène.
Je reprends ma place au congrès, légèrement en retard pour ne pas affronter mes collègues tout de suite, et replonge dans les conférences des neurologues nettement plus passionnantes que ce matin. Je parviens à une bonne concentration constructive jusqu’à la fin de la journée. Cette fois, je ne peux échapper aux compliments pour avoir remis à sa place le confrère indélicat. Comme mon voisin revient à la charge en me questionnant en allemand, je lui explique en anglais que je préfère ne pas utiliser sa langue, si ça ne le dérange pas, bien sûr.
— Ah, bon, me répond-il dans la mienne, c’est dommage, vous la parlez parfaitement ! Je vous félicite. C’est rare pour un Français.
— Mais vous connaissez le français aussi !
— Non, pas très bien, hélas.
Il joue les modestes, mais son phrasé lent traduit un solide bagage. Je ne m’attarde pas avec ce sympathique médecin, redoutant sa curiosité. Cela ne va pas être facile de le côtoyer pendant les trois jours de congrès…
— Alors ? Ta journée était intéressante ?
Myriam m’embrasse tendrement, rétablissant instantanément la valeur profonde du mot « ensemble ».
— Et toi ? Tu as visité Vienne ?
— Oui. Je suis d’abord allée au musée du Belvédère. Il y a des œuvres de toutes les époques, et bien sûr des toiles de Klint. Le parc est très beau. Ensuite, j’ai déambulé dans la vieille ville. Comme je passais devant, j’ai retenu deux places après-demain pour un concert à la Salle dorée du Musikverein. On n’allait pas rater Mozart en venant à Vienne !
— Tu as bien fait, je suis ravi…
L’envie de garder mes mésaventures m’effleure pour ne pas gâcher sa joie. Le pressentiment qu’elles vont continuer me fait renoncer.
— Ma chérie, je dois te confier quelque chose d’important.
Elle se raidit, aussitôt alertée.
— Rassure-toi, c’est très surprenant, mais il n’y a rien de grave.
— Ah, bon ! Tu as fait une grande découverte ?
— Si on veut…
Je lui raconte l’invraisemblable, depuis le concerto de Rachmaninov. Ses yeux s’agrandissent de stupeur tout au long de mon récit qu’elle écoute attentivement. Lorsque j’ai fini, nous partageons un long silence.
— Je comprends mieux pourquoi tu étais mal à l’aise en revenant du conservatoire. Mais Arthur ne t’a pas trahi… Madame Larrieux non plus d’ailleurs. Elle a pensé que tu avais une double vie !
Le solide bon sens de ma femme ainsi que la confiance absolue qu’elle me témoigne suffisent à effacer toutes mes craintes. Elle me croit, c’est l’essentiel. Maintenant, elle réfléchit.
— Comment est-ce possible, des choses pareilles ? Et pourquoi maintenant ? Il n’y a jamais rien eu de semblable avant notre rencontre ?
— Non, jamais. Pas la plus petite bizarrerie.
— Je comprends que tu as été déstabilisé, surtout en étant neurologue. Je ne sais pas comment je réagirais s’il m’arrivait une chose comme ça. Mon pauvre chéri ! C’est incroyable, mais ce n’est pas menaçant.
En espérant que cela ne le devienne pas, pensé-je en un éclair. Myriam me prend dans ses bras, et tout prend la couleur du normal à nouveau.
Les deux jours restants sont enrichissants. Ragaillardi par l’amour de ma femme, je me consacre pleinement aux données apportées par les recherches des uns et des autres. La fin du congrès est émouvante, car nous avons tous conscience que des milliers de gens à travers le monde attendent avec espoir les progrès qui vont leur redonner la santé. J’écourte ma participation au cocktail de clôture afin de ne pas être en retard au concert.
La Salle dorée, comme son nom l’indique, est surchargée de cette matière clinquante. Un énorme orgue domine la scène où les membres de l’orchestre Mozart de Vienne sont en costumes d’époque, déjà assis devant leurs pupitres. Nous avons fourni un effort vestimentaire afin d’honorer ce lieu prestigieux. Ma femme est resplendissante, et je suis fier d’être à son côté. Elle a noué ses longs cheveux bruns en un chignon élégant qui met en valeur son cou gracieux. Son maquillage savant, elle n’est pas artiste peintre pour rien, rehausse sa beauté. Ses yeux vert foncé, soulignés de noir, son nez droit et fin au-dessus d’une bouche aux lèvres pleines bien dessinées attirent le regard irrésistiblement, sa silhouette aux formes harmonieuses aussi.
Elle a retenu deux places au milieu du quatrième rang. Je devine, sur le programme rédigé en allemand, que nous allons écouter la Sonate n° 40 de Wolfgang Amadeus, que je n’ai jamais entendue. Le nom du chef d’orchestre m’est inconnu. En revanche, en feuilletant les quelques pages du programme, je suis littéralement poignardé par un autre nom : Klaus Wissenberg, qui n’est pas présent ce soir.
Je reste immobile à le relire, sans pouvoir en donner la moindre raison. Myriam s’en aperçoit, alors que des applaudissements nourris saluent la venue du chef d’orchestre.