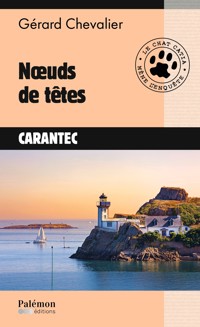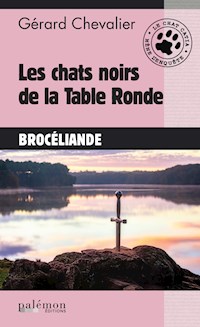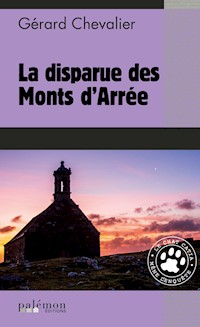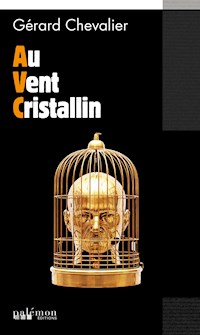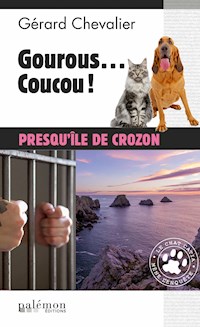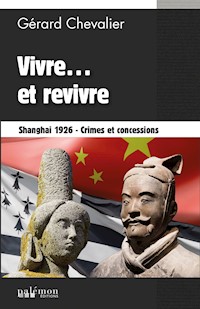Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Palémon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Fin de la guerre sur l’île de Batz.
Alors que l’Occupant se retire, les résistants du dernier jour font leur loi. La tension s’exacerbe entre les îliens, et la communauté est bientôt ébranlée par deux meurtres irrésolus…
Bien des années passent et tout paraît oublié, mais le drame ressurgit quand des assassinats recommencent à se produire, avec une implacable régularité.
Les enquêtes piétinent, la personnalité du meurtrier semble hors-norme. Minée par la peur et le soupçon, la petite société insulaire révèle ses parts d’ombre : qui trouvera la clé pour percer son plus noir secret ?
Avec ce premier roman, lauréat de nombreux prix littéraires, Gérard Chevalier nous montre tout son talent à la fois pour ficeler un scénario implacable, dépeindre des personnages complexes, et restituer l’ambiance si particulière d’une île coupée du monde. Mystère, suspense, action, vengeance, Histoire… Tous les ingrédients d’une passionnante fresque sont ici réunis.
À PROPOS DE L'AUTEUR
À la suite d’une longue carrière au cinéma et à la télévision commencée à 30 ans, Gérard Chevalier s’est lancé dans la littérature avec une affinité pour le genre policier et à suspense.
Après avoir tenu à la télévision des rôles populaires dans des séries Le 16 à Kerbriant, Les Gens de Mogador, Arsène Lupin, Vidocq, La Cloche Tibétaine et dans des téléfilms, il écrit et monte ses spectacles au café-théâtre puis de vraies pièces, comme Coup de pompe, dont il partage la distribution avec Annie Savarin et Bernard Carat.
Aujourd'hui, auteur de romans policiers et de thrillers, il s'est installé en Bretagne, sa terre d'inspiration inépuisable, terre qu'il affectionne tout particulièrement et à laquelle il rend un vibrant hommage à travers ses écrits.
Son premier ouvrage, "Ici finit la terre paru" en 2009, a été largement salué par la critique et a remporté de nombreux prix littéraires : le grand prix du roman Produit en Bretagne, le prix du livre insulaire à Ouessant et le 2e prix du Goéland Masqué. "L'ombre de la brume", paru en 2010, "la magie des nuages" en 2011, "Vague scélérate" en 2013, "Miaou, bordel!", "Ron-ron, ça tourne!", Plumes... Et emplumés" et "Carnage... en coloriage!" rencontrent également un véritable succès mettant une nouvelle fois la Bretagne à l'honneur.
Retrouvez Gérard Chevalier sur son site http://gerard-chevalier.com/
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Le site de l’auteur : www.gerard-chevalier.com
CE LIVRE EST UN ROMAN.Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
L’ennemi de la vérité,ce n’est pas le mensonge, c’est la certitude.
Friedrich NIETZSCHE
La nuit opaque se disloquait épisodiquement par les éclairs des tirs partant des bateaux anglais et canadiens à destination des côtes ou des bateaux allemands.
La fureur de l’océan s’ajoutait à celles des hommes. Le vent de la tempête empaquetait le son des canons pour le délivrer à son gré dans des directions anarchiques. Il fallait toute l’opiniâtreté de la haine pour lutter dans ces conditions.
La navette rapide de la Kriegsmarine à peine sortie des chantiers de Lürssen résonnait dramatiquement sous les gifles monstrueuses que des vagues hors d’échelle humaine assénaient sur sa coque. S’ensuivaient parfois des raclements rauques lorsque l’acier frottait les pierres du petit embarcadère. Deux marins aux cirés ruisselants sur lesquels se reflétait brièvement la lumière des explosions se cramponnaient près des amarres à chaque extrémité du bateau.
Ils scrutaient désespérément les ténèbres, guettant le lieutenant Heinrich Bergoltz qui aurait dû être de retour depuis au moins une heure. De temps en temps, le capitaine ouvrait la porte de sa cabine. Il hurlait des paroles parfaitement inaudibles pour les deux hommes de dos à dix mètres de lui. Ce qui n’avait aucune importance car ceux-ci savaient exactement ce qu’ils devaient faire : larguer les amarres dès que le lieutenant serait à bord.
Un geyser énorme se souleva à quelques encablures et retomba sur l’embarcation avec fracas, suivi une seconde plus tard par une détonation assourdie.
Les marins comprirent qu’ils avaient été repérés et pris pour cible, bien qu’aucun feu de bord ne fût allumé. Cette fois le capitaine se rua hors de sa cabine. En progressant péniblement il arriva près du marin de proue et lui vociféra dans l’oreille l’ordre de larguer. Sans répondre, l’homme tendit subitement le bras, désignant une silhouette qui venait d’apparaître. Le capitaine, s’agrippant d’une main au bastingage, se saisit des jumelles qu’il portait suspendues à son cou. À une centaine de mètres, il distingua le lieutenant Bergoltz le corps penché en avant, traînant derrière lui une caisse ou un coffre dont le poids à l’évidence ralentissait sa progression. Le capitaine immédiatement demanda à son matelot d’aller l’aider et regagna aussi vite qu’il put son poste de commandement.
À peine avait-il refermé sa porte que la navette se cabra brutalement vers la poupe. Le capitaine tomba à la renverse et comprit avant de s’assommer contre la paroi métallique qu’un obus venait de les manquer de quelques mètres. Dans la salle des machines, l’affolement gagna les hommes ainsi que les sept mille cinq cents chevaux des trois moteurs Daimler-Benz, lorsque par un effet de balancier la proue s’enfonça à son tour, libérant l’hélice qui équilibrait la force du courant. L’embarcation se stabilisa avec difficulté. La prestigieuse mécanique, fierté du chef mécano, reprit son rythme. L’homme se précipita pour vérifier le niveau de l’huile des carters, aidé par ses deux acolytes. Après avoir refait les niveaux précisément, il appela le capitaine. Mais personne ne lui répondit. Il décida alors d’aller voir lui-même ce qui se passait. Lorsqu’il déboucha de l’écoutille, il aperçut le lieutenant Bergoltz maintenant à faible distance de la passerelle. Le matelot qui l’accompagnait lâcha la poignée de la lourde caisse, puis il se mit à courir afin de détacher l’élingue le plus vite possible. Au moment où le chef mécano découvrait le capitaine inanimé, les parois se fragmentèrent par le feu des soutes qui s’éventraient, touchées exactement dans le compartiment des munitions.
Les corps des marins se mêlèrent intimement avec les débris de leur navire.
Sur le quai le lieutenant Bergoltz était couché devant sa caisse, la poitrine défoncée.
Un éclat de la coque lui avait sectionné la trachée, les poumons et l’artère pulmonaire. Il était tombé en avant, le bras qui ne tirait pas la caisse étendu droit devant dans un ultime réflexe de protection.
Incapable de remuer, il voyait posé dans sa main au ras du sol le croiseur anglais responsable de leur destruction, masqué de temps en temps par les crêtes des déferlantes.
Il lui restait une seconde à vivre. L’accélération inouïe des visions de sa mémoire se superposa au bateau de guerre.
Ce furent d’abord ses parents lui faisant découvrir ses cadeaux de Noël au pied du sapin. Il avait six ans et l’amour qui régnait à cet instant dans sa famille s’était naturellement inscrit en lui à jamais. Ensuite Maria vint lui donner un baiser le jour de ses quatorze ans. Ils partirent se promener avec Halphen son chien, son ami de toujours, traversant un printemps parfumé de nature, exhalant la beauté. Uthe surgit à son tour prenant son bras à la sortie de l’église, le dévisageant avec une intensité infinie. Puis le cercueil qui l’enveloppait, après un décès subit et inexplicable, s’enfonça dans les profondeurs du caveau familial. Sa dernière image représenta la tendre Camille, son inattendu et nouvel amour dans cette île française où il devait revenir la chercher après la fin des hostilités.
Une lumière qui n’avait plus rien de terrestre envahit son cerveau et le délivra de la stupidité des combats.
*
Les tirs d’obus devenaient plus sporadiques. Mais la rumeur des flots courroucés compensait l’accalmie guerrière. Le cadavre du lieutenant était le seul élément paisible de toute cette furie. Près de son visage, où l’on pouvait déceler un léger sourire, le bout luisant de pluie d’une botte en caoutchouc se posa, soulevant une légère éclaboussure. L’homme affublé d’un grand ciré contempla l’officier allemand quelques secondes. Son attention se reporta alors sur la caisse. Un des coins du couvercle avait été bizarrement fracassé, laissant une ouverture où la main pouvait se glisser. Il en profita.
Lorsqu’il la retira et ouvrit les doigts, trois pièces d’or apparurent, accaparant toute la lumière dans ce décor sinistre de gris, de noir et de vert profond.
L’homme réitéra le geste avec son autre main, plus rapidement cette fois. Le résultat fut identique. Mettant les pièces dans une poche de son pantalon, il entreprit de soulever la caisse. Le poids en était considérable. L’Allemand devait être d’une force hors du commun pour l’avoir traînée jusqu’ici. Concentrant son effort, il réussit à la déplacer de quelques mètres pour la ranger le long d’un muret près d’un tas de casiers à homards dont il modifia l’ordonnancement pour la dissimuler.
Il revint vers le corps du lieutenant Bergoltz et, agrippant le col du manteau noir de la Kriegsmarine, il fit glisser le mort jusqu’au bout de l’embarcadère où il bascula et disparut dans le tumulte de l’écume. L’homme au ciré quitta immédiatement les lieux en courant maladroitement contre le vent dont la violence ne cessait de croître.
Dans le prolongement de la pointe est de l’île, d’autres déflagrations situaient l’emplacement d’un nouvel affrontement. L’unité allemande engagée devait être importante, à en juger par les salves d’artillerie ininterrompues échangées entre les navires ennemis. La vie paraissait avoir déserté le village.
Pas une lueur, pas un mouvement ne signalait une présence. Ce qui renforça l’incongruité de la petite charrette tirée par un mulet lorsqu’elle apparut.
L’homme au ciré menait énergiquement la bête affolée par la tempête et les explosions. Il l’attacha au plus près à l’une des bittes d’amarrage scellées dans les pierres de l’embarcadère.
Tandis que le mulet se mettait à danser sur place, tirant de toutes ses forces sur sa longe, l’homme traînait à nouveau la caisse pour l’approcher de son véhicule. Utilisant les deux longues planches qu’il avait prévues, il poussa son fardeau sur la rampe improvisée, contrebalançant avec peine les mouvements désordonnés que la bête transmettait à la charrette. Il réussit de justesse à hisser sa charge, avant qu’une des deux planches ne ripe et lui écrase un orteil. Boitillant, il libéra rageusement le mulet et disparut avec sa charrette en hurlant des imprécations que personne ne pouvait entendre.
PREMIÈRE PARTIE
Août 1944
Avec la marée montante, une légère brise iodée venait rafraîchir les îliens en proie à une agitation joyeuse pour fêter leur libération toute récente des autorités allemandes. Rassemblés au bourg, ils installèrent des tréteaux le long de la jetée pour un banquet monumental. Le maire et le curé, tous deux natifs de la région et dont les sentiments mutuels étaient amicaux, avaient sorti leurs réserves de lampions en papier multicolores. Aidés de leurs ouailles laïques et catholiques, ils accrochaient les luminaires partout où ils le pouvaient, plaçant une petite bougie à l’intérieur, la fixation accomplie.
Les familles avaient fait venir tous leurs proches pour cette fête exceptionnelle, après cinq ans de privations et de tristesse.
Liu Chang, ou plutôt Chang Liu pour les Français, se démenait avec toute son énergie pour porter, tirer, clouer, offrir sa bonne humeur et ses muscles partout où cela était nécessaire.
Ce jeune Chinois était considéré comme un enfant du pays. Pourtant son statut d’étranger était extrêmement particulier. Il n’était pas réfugié politique, loin de là, il n’était pas naturalisé dans son pays d’accueil, il n’avait aucun visa ou titre de séjour. Il était là tout simplement. Avec la protection des fonctionnaires de la préfecture et du maire de l’île, profitant de la pagaille et des perturbations engendrées par la guerre pour le soustraire à l’attention de l’occupant. Il y avait une raison affective à cela, inspirée par la compassion envers le destin tragique subi par son père. Un fait historique cruel et complètement oublié avait eu lieu pendant la Première Guerre mondiale.
Les Anglais, bien implantés en Chine où leurs appétits colonialistes commençaient à se rassasier, avaient lancé une offre publique d’engagement militaire à leurs côtés. Ils promettaient en échange une bonne rétribution et une aide aux familles chinoises en cas de décès des volontaires pour cette guerre qui ne les concernait en aucun cas.
Deux cent mille hommes se présentèrent et furent enrôlés. La grande pauvreté qui régnait alors en Chine en avait été la raison principale. Peut-être aussi les tonnes d’opium que les Britanniques importaient de leur empire des Indes pour abrutir les masses aidèrent-elles ce recrutement.
Avec la conviction que la vie d’un soldat de Sa Majesté était bien plus précieuse que les autres, on envoya les Chinois en première ligne dans les combats après un entraînement sommaire ; ce qui provoqua leur anéantissement rapide. Sur les deux cent mille sacrifiés, un seul survécut : Liu Fu-li, le père de Chang. Il parvint à regagner son pays où il trouva sa famille anéantie à l’occasion d’un soulèvement local contre les Anglais, durement réprimé, la population étant exaspérée par leurs promesses jamais respectées.
Seul Chang, né pendant l’absence de son père, avait été sauvé et caché par des voisins. Fu-li le recueillit, s’enfuit en France où il se remaria avec une Française et obtint la naturalisation, oubliant de demander celle du petit garçon né en Chine. Curieusement, personne ne s’en soucia. Chang devint français de fait en toute illégalité, aucune administration ne vérifiant à l’époque son acte de naissance. Le certificat de baptême obtenu par sa belle-mère lui servit de passeport. Jusqu’au jour où, après son baccalauréat, un inspecteur d’académie plus pointilleux que les autres s’aperçut de l’anomalie.
L’envahissement de la Pologne et la mobilisation générale contre les vues hégémoniques du chancelier Hitler renvoyèrent l’inspecteur à des problèmes plus fondamentaux. Chang avait vingt et un ans.
Son père eut l’honneur en tant que nouveau citoyen français d’être invité à combattre à la mesure de ses moyens : on lui fit surveiller les voies ferrées.
Sa belle-mère, prévoyant qu’on ne ferait pas trop de difficultés pour envoyer Chang à la boucherie, fit accepter le jeune homme dans une famille d’amis dont les parents habitaient une île en Bretagne, où, lorsqu’il fut installé, pas un militaire ne s’intéressa à son cas. Par chance il paraissait beaucoup plus jeune qu’il ne l’était en réalité. Musclé, svelte, imberbe comme presque tous les Chinois, en cette belle journée de festivités, Chang, malgré ses vingt-huit ans, offrait aux regards le visage immature d’un grand adolescent, renforcé dans sa jeunesse par un sourire permanent et de grands yeux marron à l’expression malicieuse.
Pourtant il était orphelin depuis peu, Fu-li ayant disparu quelque part dès le début du conflit, et sa belle-mère sous le bombardement par l’aviation américaine de Nantes où elle avait eu la mauvaise idée d’aller voir sa mère très âgée. Le jeune homme n’avait jamais affiché son chagrin, probablement par atavisme, les Orientaux considérant qu’il est impoli d’ennuyer les autres avec ses propres malheurs. Contrairement aux Français qui en font volontiers leur sujet de conversation favori.
— Chang ! Viens me tenir l’échelle ! vociféra le curé en équilibre instable.
— Va me chercher la brouette ! hurla la femme du maire, les bras débordant de vaisselle et de toiles cirées.
On avait calé quelques petits tonneaux sur les planches des tréteaux et le vin coulait généreusement bien que l’on fût loin de l’heure du dîner.
Il avait encore la fraîcheur de la cave du café. Le maire et le conseil municipal avaient voté à l’unanimité la distribution gratuite des nectars sur le maigre budget de la commune. Avec le sentiment du devoir accompli pour une journée aussi extraordinaire.
À son arrivée sur l’île, Chang avait compris d’emblée les codes qui régissaient la vie de la petite population, partagée en deux groupes inégaux bien distincts : le peuple des gens de mer et le peuple des cultivateurs. Les pêcheurs, dans leur ensemble, se montraient joviaux, plus généreux, attentifs au bien-être de leur entourage. Les maraîchers, rudes, assez renfermés, ne pratiquaient pas beaucoup le français, pourtant obligatoire à l’école. Ils communiquaient de préférence en breton. Chaque groupe avait bien évidemment des parents dans l’autre. Mais le mimétisme des clans finissait par marquer le nouveau venu. Seul Chang manifestait une grande aisance dans ses relations avec les uns ou les autres. Le don d’une subtile diplomatie veillait sur son comportement quotidien, lui faisant détecter dans la seconde un débordement de jalousie ou de rancune dans les propos de son interlocuteur.
Comme tous les êtres qui vivent en vase clos, les îliens n’en étaient pas exempts, loin de là. Surtout après cinq ans bouleversés pendant lesquels des tiraillements incessants assaillaient les mentalités, réveillant les vieux démons, exacerbant les opinions, créant des situations complexes que les intelligences les plus faibles ne pouvaient pas résoudre.
— Tiens ! Les voilà ceux-là !
Le vieux Yann désigna du menton le bateau navette qui accostait. Une douzaine de gendarmes en uniforme sautèrent sur le quai où deux marins-pêcheurs leur tendirent la main pour les empêcher de tomber, car ils étaient armés de fusils et évitaient de les cogner contre le bord de granit. Un capitaine et un adjudant-chef les disposèrent en rang par deux. L’adjudant commanda la marche au pas cadencé. Leur apparition introduisit un peu de calme dans la foule. Les gens leur faisaient sans le vouloir une haie d’honneur le long des maisons.
— Ils viennent retrouver leurs copains qui gardent les Boches ! …
— Oui, mais ils vont repartir avec !
— Et les putes aussi ?
— Ça, tu m’en demandes de trop !
La semaine précédente, les bateaux faisant la navette entre l’île et le continent, réquisitionnés sur demande de la préfecture, embarquaient les prisonniers allemands, presque tous convalescents et rescapés du naufrage, ou plutôt de l’échouage, du contre-torpilleur Z32 de la Kriegsmarine, le 9 juin 1944. Poursuivi par les destroyers NCSM Haïda et Huron, le HMS Ashanti des marines canadienne et anglaise, le bateau s’était éventré sur les récifs d’Enez ar Prat. Deux cent cinquante marins avaient réussi à gagner le rivage de l’île, distant d’environ trois cents mètres, mais vingt-sept hommes avaient trouvé la mort. Restaient une vingtaine de captifs en compagnie d’une quinzaine de déserteurs, refusant l’ordre d’évacuation de leurs états-majors et se constituant prisonniers sous l’autorité du maire.
Les îliens les connaissaient bien. Ces soldats faisaient partie de leur vie depuis deux ou trois ans. Ils avaient essayé de rendre le quotidien des îliens plus supportable. Certains avaient tenté d’établir des liens d’amitié.
Les attitudes étaient ambiguës, chacun essayant de tirer profit de la situation, mais les relations étaient néanmoins courtoises dans l’hypocrisie.
Un commerce plus ou moins caché se pratiquait dès la tombée de la nuit. Très peu d’argent circulait. Le troc s’imposait : un beau poisson contre un paquet de cigarettes ; des œufs, une salade, des poireaux, des pommes de terre surtout, contre du chocolat, des boîtes de conserve ; un poulet contre de l’essence, etc.
Les tarifs évoluaient en fonction des demandes et établissaient des contacts privilégiés.
Mais cela créait aussi des rancunes terribles : celui-ci « vendait » plus facilement aux Allemands qu’à son voisin ! Il en retirait beaucoup plus d’avantages !
Aujourd’hui les événements reprenaient un sens logique.
L’occupant devenait désormais l’ennemi vaincu, subissant l’humiliation qu’il avait lui-même imposée à l’« occupé ».
L’ordre dont les Germains s’étaient portés garants se retournait contre eux.
Rassemblés devant l’église, les prisonniers étaient stupéfaits d’être insultés, de recueillir sur leurs uniformes froissés les crachats de ceux avec qui ils avaient cru hier établir des rapports civilisés. Il n’y avait pas eu d’exactions dans l’île à l’encontre de la population. La Gestapo n’y avait pas mis les pieds. Les reîtres du IIIe Reich, loin sur le continent, oublièrent plus ou moins ce détachement de la Wehrmacht, pourtant proche des combats maritimes.
Ils avaient d’autres soucis.
Sur l’île, les derniers Allemands en poste s’étaient laissé surprendre par une résistance impromptue, insoupçonnée, venant les arrêter à l’aube avec une maîtrise, une traîtrise à leurs yeux parfaitement organisée.
Pour Hans Holbricht, en tête du groupe, c’était encore plus douloureux. Non seulement ceux qu’il avait aidés, en apportant des denrées prélevées sur les approvisionnements militaires, détournaient leurs regards alors qu’il essayait de leur dire au revoir d’un sourire ou d’un signe de tête, mais celle qu’il aimait, depuis l’an passé déjà, avait disparu.
— Sale Boche ! T’es moins fier aujourd’hui, lui hurla la vieille Marie à qui, la veille encore, il avait acheté des salades au double de leur prix.
Son tourment le tenaillait. Où pouvait être Soazig ? Françoise, en français. Que lui avait-on fait ?
Malgré leurs précautions, leur amour n’avait pu passer inaperçu, c’était impossible. Car il ne s’agissait pas d’une passion éphémère. Ignorant la guerre, la rivalité de leurs peuples respectifs, ils avaient conçu leur vie après la fin des hostilités. Hans, étant architecte, avait dessiné leur future maison selon les désirs de celle qu’il appelait sa femme. Tous deux l’imaginaient en Suisse, terre idéale à l’issue des combats sanglants, pour éviter les reproches de leurs compatriotes, inéluctables en de telles circonstances.
Le moment difficile était arrivé. Ils l’avaient évidemment prévu. Ils scellèrent leur avenir par la conception d’un enfant, lequel devait naître après cette guerre, ils l’espéraient. Cette guerre qu’ils oubliaient dans des étreintes clandestines.
Hans avait désobéi à l’ordre d’évacuation consécutif à l’encerclement de Brest par le général Patton.
Le fait d’être prisonnier des Français représentait au moins la garantie de ne pas être récupéré sur le front russe, sa hantise. Le général Malinovski, en cette fin d’août 1944, pulvérisait la résistance allemande dans les Carpates. Les Russes se faisaient une réputation, par leurs atrocités, à la hauteur de celles qu’ils avaient subies peu de temps auparavant.
La conscience de Holbricht était en paix : personne de bonne foi ne pouvait l’accuser de la moindre violence, du plus petit forfait au détriment des îliens. Ce n’était pas un guerrier. Non qu’il manquât de courage ou de défense s’il était menacé, mais son âme équilibrée, son métier, l’éducation affectueuse et ferme reçue de ses parents avaient formé en lui un esprit constructif, curieux de toute chose. Son moral était indestructible.
Un coup de pied l’atteignit derrière le genou gauche, l’arrachant à ses pensées. Le gendarme sur le côté, derrière lui, repoussa mollement l’agresseur. C’était Pierre Guivarc’h, le maraîcher, son principal fournisseur de pommes de terre.
— Mais pourquoi ? lui cria Hans.
L’homme se mit à ricaner, une expression stupide tordant sa bouche.
— Ta gueule ! proféra le gendarme en poussant le soldat dans le rang.
Hans perçut du coin de l’œil un regard différent dans l’alignement des spectateurs : Chang Liu, le jeune Chinois, insolite parmi les têtes bretonnes. Chang le contemplait d’un regard bienveillant. L’Allemand avait croisé bien des fois ce regard, il avait appris son invraisemblable histoire. Il lui sourit brièvement et le jeune homme répondit d’un petit salut de tête. Réconfort au milieu de l’agressivité.
Où était Soazig ? La question revenait inlassablement.
Des clameurs s’élevèrent loin derrière le défilé. Hans tendit l’oreille pour en saisir le sens, mais le vent placé défavorablement empêchait la compréhension de mots hurlés dans la colère.
L’intention, elle, était manifeste.
Instinctivement il comprit que cette flambée d’animosité s’adressait à Soazig. Peut-être à d’autres également. À quelques rares femmes ayant, comme elle, trouvé un amour interdit, mais aussi à ceux des îliens qui n’avaient pas caché leur préférence pour le régime des vainqueurs.
Le déballage ignoble des règlements de comptes allait maintenant s’étaler. Si, à l’encontre des « collaborateurs », le sentiment de revanche était justifié, combien allaient être broyés au nom de leur amour, de leur empathie, ou tout simplement par la jalousie et la haine gratuite des voisins ?
Aux environs de dix mille établiraient plus tard les historiens, criminels compris.
Hans Holbricht avait pressenti la vérité. Soazig, les mains liées, et attachée par une corde à cinq autres compagnes, essuyait les injures de tous ceux dont elle avait repoussé les avances, qu’ils fussent mariés ou non, ainsi que de leurs femmes. Celles-ci n’avaient jamais accepté sa beauté, sa distinction naturelle, la mettant ainsi à l’écart des convivialités du monde féminin. On lui avait méchamment tondu la tête avec des coups de ciseaux volontairement maladroits, ce qui laissait quelques coupures sanguinolentes jusque dans son cou. La trace de doigts d’une gifle brutale lui rougissait une joue. De la salive maculait son front et sa nuque. Mais ses yeux bleu acier fixaient l’horizon, imperturbables.
Son maintien altier, un sourire méprisant, ne faisaient qu’attiser la colère des hommes qui l’avaient convoitée et des femmes qui la jalousaient rageusement.
Elle marchait élégamment, ne se souciant que de l’être aimé et de son futur enfant.
Les autres captifs n’étaient pas aussi forts.
À part Le Goff, le charcutier, qui affichait depuis longtemps des opinions germanophiles et n’avait, proclamait-il, rien à se reprocher, tous marchaient la tête baissée, conscients de focaliser les ressentiments, les frustrations engendrées par l’état d’impuissance imposé par l’ennemi, même si celui-ci n’avait pas lourdement pesé sur l’île.
Les femmes arrêtées parce qu’elles couchaient avec les Boches étaient tondues. Les hommes, les « collabos » notoires, avaient reçu des coups de pied, des coups de poing, des gifles.
Le maire leur avait stipulé que leurs biens étaient confisqués jusqu’à nouvel ordre, leurs familles assignées à résidence. Formule bien inutile, car elles ne pouvaient faire autrement. Qui les aurait accueillies avec une étiquette maudite ? Il n’était pas question non plus de risquer d’être dépossédé de sa maison par un parent malintentionné, profitant de leur absence.
Hans remarqua çà et là des gens immobiles et silencieux.
Une cinquantaine de jeunes hommes avaient quitté l’île pour rejoindre la France libre. Douze avaient péri glorieusement au cours de missions commando pour préparer le débarquement, ou dans des parachutages nocturnes.
Les familles de ces héros se taisaient. Le poids de la douleur, ou de la joie profonde ressentie pour les survivants, modifiait leur comportement. Soulagés ou meurtris, ils avaient hâte de vivre à nouveau libres, de retrouver des journées normales, connaissant irrémédiablement le prix de l’existence.
Pierre-Yves Legarrec guettait sur le port l’arrivée du groupe. Les moteurs du bateau qui desservait l’île quatre fois par jour grondaient au ralenti, projetant des nuages de sable dans les tourbillons créés par les hélices, car la mer était encore basse.
Legarrec s’efforçait de distinguer la belle silhouette de Soazig. Il n’avait pas voulu procéder à sa capture, bien que celle-ci lui incombât d’office, avaient dit ses amis. Soazig et Pierre-Yves depuis leur petite enfance partageaient leurs journées, que ce fût à l’école communale, pour les fêtes de famille, les enterrements, ou les corvées diverses nécessitant l’effort de tous.
Le petit garçon, l’adolescent et enfin l’homme, avait toujours été amoureux de la grande fille blonde aux yeux extraordinaires. Ce fils de pêcheur ne pouvait imaginer sa vie sans elle. Et cela avait presque été une réalité. Mais il y avait eu un point de rupture que Pierre-Yves n’avait ni compris ni accepté. Les mystères des femmes et de leurs sentiments se trouvaient trop loin des préoccupations de ce rude garçon pour qui les schémas du quotidien étaient simples. Trop simples. Surtout pour une sensibilité complexe comme celle de Soazig que le soldat allemand avait su estimer et épanouir. La déception s’avérait brutale pour le Breton. L’amertume, la colère aussi, le submergeaient. On lui avait volé sa promise. Les hommes de l’île pensaient de même. Suprême humiliation, c’était un Boche qui commettait ce crime.
Conduisant la navette, Legarrec avait prétexté ne pas pouvoir aller chercher Soazig lui-même, devant préparer l’embarcation pour le transbordement. En réalité, il n’avait pas le courage d’affronter la jeune femme. Ni les autres. Trop de vie les réunissait intimement.
Le cortège apparut au bas de la rue descendant sur la jetée. Les enfants couraient en tête pour ne rien perdre d’un spectacle exceptionnel qu’ils raconteraient pendant des années avec des détails plus ou moins inventés. L’uniforme noir et bleu des gendarmes français contrastait avec le gris-vert des soldats allemands et le camaïeu gris-bleu des vêtements de la population. Quelques coiffes blanches traditionnelles ponctuaient l’agglomérat des têtes, ainsi que les casquettes bleu marine des pêcheurs.
Legarrec, bouleversé d’idées contradictoires, eut l’envie saugrenue de tirer à la mitraillette sur la foule pour l’éliminer totalement. Il ne dominait pas son chaos intérieur et… et il la vit apparaître de sa démarche de reine, son crâne nu apportant une tache originale. Le chagrin fit place à la révolte. C’était trop tard. Il aurait pu la sauver en l’emmenant de nuit dans un canot. Mais lui aurait-elle permis de le faire ? C’était improbable.
Un léger vent de noroît le fit frissonner malgré le soleil réapparaissant avec la marée montante.
Le curé choisit cet instant pour faire sonner les cloches, autant pour célébrer la libération de sa paroisse que pour annoncer la messe de dix heures à laquelle, fataliste, il n’espérait pas grand monde, eu égard aux événements en concurrence avec sa liturgie.
Le capitaine de gendarmerie monta le premier à bord avec deux de ses hommes, l’arme à la main. Il avait hâte que l’embarquement soit terminé car il redoutait des débordements dont les collaborateurs feraient les frais.
Certaines têtes brûlées bien connues de ses services, notamment par les multiples interventions dans les bars de Roscoff, commençaient à menacer. La bagarre représentait leur sport favori, surtout après l’absorption massive de boissons.
Depuis la neutralisation des Allemands, ils avaient arrosé copieusement une liberté dont ils n’avaient pas été vraiment privés. Leurs petites cervelles échauffées ne demandaient qu’à s’épancher.
Legarrec se tenait sur le pont maintenant, près de la passerelle. Les prisonniers montaient sans bousculade, respectant instinctivement la discipline, même dans la défaite.
Quand Hans Holbricht surgit sur le bateau, le marin eut envie de le tuer sur place. Que risquait-il ?
Hans le fixa dans les yeux en marchant, calme, déterminé, prêt au combat qu’il avait lu sur le visage de son adversaire. Legarrec s’avança d’un pas dans sa direction, aussitôt contré par le capitaine qui réalisa immédiatement le danger potentiel.
— Tiens-toi tranquille, Legarrec ! Ne me complique pas les choses.
Le Breton était ramassé en un tas de muscles prêts à entrer en action.
— Mets-toi aux commandes tout de suite ! Fais larguer les amarres dès que le dernier est à bord !
Le gendarme avait aboyé son ordre. Le marin obtempéra à contrecœur.
— Tu resteras à ton poste pendant tout le débarquement ! ajouta le militaire, agitant son revolver sans conviction.
Les soldats embarqués, ce fut au tour des femmes tondues et des collabos de se présenter sur la passerelle.
Toute l’île les encercla, redoublant de cris et d’insultes. Les gendarmes sur le quai formèrent une barrière face aux excités, brandissant leurs fusils devant eux pour les repousser. Un œuf lancé maladroitement rata sa cible et s’écrasa sur un képi des forces de l’ordre. L’éclat de rire général que cela provoqua eut un effet salutaire. Les crispations se détendirent. Le pauvre pandore n’osait lâcher son arme pour s’essuyer. Le jaune d’œuf lui dégoulinait lentement de la tête sur l’épaule, retenant l’attention de la foule qui en oubliait ses invectives.
Grâce à cette diversion, l’embarquement se termina rapidement.
Le bateau s’éloigna du quai dans le silence revenu d’un seul coup. Les îliens contemplaient ces passagers entassés contre le bastingage, conscients de la véritable fin de leur occupation.
Soazig, elle, n’eut pas la moindre attention en direction de l’île de Batz. Penchée à la verticale de l’étrave, elle dévisageait enfin son futur mari, à quelques mètres d’elle. Leur échange muet, tellement intense, faisait tout disparaître autour d’eux. Ils flottaient, désincarnés, dans un univers que personne ne pouvait atteindre.
13 juillet 1945
On ressortait les lampions, les tréteaux, les planches, l’estrade pour les musiciens. Il y avait eu le premier Noël, le premier Pâques et aujourd’hui le premier 14 juillet, sans « eux », les Boches. Les Allemands avaient été mis à la porte de la France officiellement le 8 mai.
La radio avait annoncé ce matin que l’Italie déclarait la guerre au Japon. Déclaration bien dérisoire. Car la guerre était là-bas maintenant, en Asie, atteignant bientôt son point final.
Riou le cantonnier, Le Menez le garde champêtre, Dupenhoët l’adjoint au maire, s’affairaient à la réussite d’une fête que tous souhaitaient magnifique.
On avait lâché les enfants et les chiens. Ils se poursuivaient, les uns riant, les autres aboyant, chapardant les gourmandises que les femmes préparaient avec, cette fois, un peu plus d’abondance.
Auguste Lebras, pêcheur, et Germain Créac’h, pensionné, après six ans de fâcherie absolue s’étaient tendu la main publiquement au café. L’assistance, un instant médusée, les avait acclamés, leur offrant le verre de l’amitié retrouvée. Les verres s’étaient succédé à un rythme soutenu. Si bien qu’ils pleuraient dans les bras l’un de l’autre, anéantis autant par le gâchis engendré par leur mésentente que par le maelström des vapeurs alcoolisées.
Yvon Querriec, le maire de l’île, refusait avec bien du mal tout ce que ses administrés lui proposaient à boire.
Pour ne vexer personne, il déambulait avec un grand verre plein, toujours le même, ce qui lui permettait de trinquer continuellement, faisant semblant de boire une gorgée. Néanmoins, il n’avait pas d’illusions sur l’état dans lequel il irait se coucher. Yvon était âgé d’une cinquantaine d’années, grand, bien bâti, son aisance pécuniaire résultait d’un travail acharné. Il était à la fois le maréchal-ferrant, le forgeron, le réparateur des machines agricoles et même des moteurs de bateaux. Il employait sept personnes, et figurait ainsi parmi les premiers patrons du canton. Son horreur des conflits et un sens aigu de la justice l’avaient porté à devenir le premier citoyen de l’île de Batz, où il était né. On le respectait, on le craignait, on lui obéissait. Il avait su rester à sa place face à l’autorité allemande, tout en obtenant pour sa population de petites améliorations négociées intelligemment. Les deux parties lui en avaient témoigné une sincère reconnaissance.
Malgré tout cela, des rumeurs circulaient, provoquées par le trait de caractère que les bigots et les cocus admettent le moins : il aimait les femmes. Toutes les femmes qui, à ses yeux, étaient séduisantes. Dans ce microcosme où tout se voit, tout se sait, il avait frôlé bien des drames, et s’était attiré nombre d’inimitiés.
Dès l’adolescence de Soazig, il en était tombé très amoureux. Mais Pierre-Yves Legarrec se trouvait le premier sur le front des assaillants. Querriec, désavantagé par sa petite quarantaine, n’avait rien pu tenter. Quand le beau Teuton eut remporté la victoire dans le cœur de Soazig, le maire, sa passion déjà émoussée, n’en ressentit que peu de dépit. Legarrec ne lui était pas sympathique. Comme ça. Sans raison.
— Alors, m’sieur le maire, tu t’en mets plein le nez !
— Mais oui ! Comme toi, mon gars !
Loïc Le Gall, membre d’une tribu de onze enfants, fit sonner bruyamment son verre contre celui de son ami. Loïc faisait partie d’une des plus anciennes familles de l’île. Maraîchers depuis la naissance de la culture sur cette terre, ils possédaient la plus grande exploitation en superficie. Leur domaine étant à l’écart, on les avait affublés du terme de « Sauvages », qualificatif plus ou moins justifié selon les personnalités du clan. Querriec les ménageait car ils n’avaient pas tous bon caractère, loin s’en fallait.
Les sept fils représentaient la caricature du parfait Breton : carrés, costauds, le visage coloré, les yeux bleus, les cheveux courts, têtus, pas très causants, durs au labeur, exigeants aussi bien envers les autres qu’avec eux-mêmes.
Mais quand ils ouvraient leur amour ou leur amitié, c’était pour toujours. Gare à celui ou celle qui trahissait. Leur hargne pouvait être aussi éternelle. Les quatre filles suivaient à peu près ce schéma. Cependant, plus sensibles, elles rêvaient parfois d’un monde où les chemins auraient été moins droits et plus ombragés. Loïc Le Gall était le seul électron libre de la famille. Constamment à l’affût, comme le maire, d’une femelle qui pourrait lui céder. Cela les réunissait ou les opposait suivant les occasions, depuis fort longtemps. Le célibat de Loïc représentait quelquefois un avantage dans leur compétition.
Il n’avait jamais accepté sa défaite devant Soazig. Beaucoup moins chevaleresque qu’Yvon Querriec, sa participation à la tonte sauvage de la salope qui couchait avec le Boche ne lui avait pas suscité d’autre état d’âme que l’excitation d’une belle revanche sur son échec personnel. Le maire, fin diplomate, lui en tenait rigueur secrètement, la discrétion étant une des composantes de sa règle de conduite.
Autre détail irritant : quand Loïc se lançait à la conquête d’une belle, lui si pingre d’habitude devenait prodigue ! Surtout depuis quelque temps.
Dès son désir assouvi, les largesses se tarissaient, laissant un goût d’amertume à la pauvre abandonnée. En bon tacticien, Querriec essayait de récupérer et de consoler l’éplorée si elle lui plaisait. Mais il n’admettait pas que l’argent fût un moyen de séduction. Cela lui semblait minable. La complicité des deux insatiables favorisait quand même leurs confidences. Ils poussaient parfois le cynisme à se communiquer des détails croustillants sur leurs proies. Ce qu’ils ne faisaient pas avec les autres. Et celles qui avaient grandi avec eux savaient parfaitement à quoi s’en tenir sur leurs frasques. Dès qu’une fille atteignait l’âge d’être courtisée, la mère se faisait un plaisir et un devoir de la mettre en garde contre les deux dons juans, âgés respectivement de vingt-sept et trente-huit ans, dont elle avait été le plus souvent victime.
— Alors, Chang, tu ne trinques pas avec moi ?
Querriec serra la main du jeune Chinois.
C’était une plaisanterie car il ne buvait que de l’eau, malgré tous les efforts pour lui faire avaler de l’alcool, du vin ou de la bière.
— Je veux bien. Mais il paraît qu’on ne trinque pas avec de l’eau !
— Si tu écoutes tous les conseils des ivrognes, tu n’as pas fini !
Chang sourit et le maire lui donna une tape amicale sur l’épaule. Quel gentil garçon, pensait-il, comme chaque fois qu’il le voyait.
— Tu as des nouvelles de la Chine ?
— Oui ! …
Querriec attendit la suite en vain.
— Alors ? Elles sont bonnes ?
— Oui ! …
S’ensuivit un nouveau silence.
— Tu ne veux pas m’en dire plus ?
— Si ! … On a repris Liuchiu, mais les Japonais l’ont incendié avant leur retraite…
— Et tu sais tout ça par ta radio ?
— Oui…
Peu de gens étaient avertis de l’existence d’un appareil récepteur radio ondes courtes entre les mains de Chang. À l’occasion d’un rangement et d’un nettoyage demandés par Querriec, il l’avait découvert parmi un stock de caisses confisquées aux Allemands et oubliées dans la remise de la mairie. Le jeune homme émerveillé avait demandé au maire de le lui prêter et celui-ci avait accepté, exigeant en échange d’être informé sur des événements mondiaux pas toujours bien développés dans la presse ou les ondes, ou même occultés.
C’était un appareil aux performances extraordinaires, permettant de capter à certaines heures des émissions à des milliers de kilomètres.
Depuis presque un an, il était régulièrement à l’écoute de la Chine, aux premières heures de l’aube, détectant de rares informations concernant les combats et les heurts politiques entre Mao Tsétoung et Tchang Kaï-chek, réunis provisoirement pour lutter contre l’envahisseur japonais. Le jeune Chinois sentait impérieusement le besoin de participer à la libération de la Chine, pas seulement des Japonais mais aussi des Américains, des Britanniques et même des Français.
Les Occidentaux considéraient ce vaste pays, l’empire du Milieu, comme une colonie. Chang aurait bien vengé sa famille des Anglais. Mais comment trouver l’argent du voyage ? Ses économies ne lui permettaient d’aller que jusqu’au port du Havre.
— À part la Chine, tu as d’autres choses à me dire ?
La question du maire le tira brusquement de son rêve d’expédition, qui n’avait pourtant pas duré plus de cinq secondes. Il se dépêcha de lui brosser un rapide tableau de la guerre du Pacifique ainsi que de la position critique du Japon face à la coalition mondiale.
Parlant et comprenant parfaitement l’anglais, Chang prenait ces informations-là directement sur une radio de New York. Querriec, admiratif de l’intelligence du jeune homme, le remercia vivement. Puis il poursuivit sa tournée, autant électorale que conviviale, qui l’emmena jusqu’au deuxième port de l’île.
La jetée massive accueillait aussi bien les bateaux de pêche que les embarcations venant du continent pour amener les denrées et les matériaux indispensables aux îliens.
En passant devant l’hôtel-restaurant qui dominait l’anse, il aperçut parmi les groupes de familles Patrick Braouzec, dit l’Intellectuel, l’homme le plus controversé de l’île. Grand, maigre, le nez proéminent coupant la brise, l’œil agressif, les cheveux hirsutes, sa personnalité évoquait un échassier provocateur et dédaigneux. Ses détracteurs racontaient toutes sortes d’horreurs sur son compte. Ses défenseurs, moins nombreux, l’admiraient pour sa culture, sa dialectique prolixe et persuasive.
Querriec redoutait ses joutes verbales habiles auxquelles, parfois, il répondait difficilement.
Lors de la mobilisation générale de septembre 1939, Braouzec avait été réformé. Le maire était un des rares à en connaître le motif : déséquilibré mental. Cela lui paraissait invraisemblable. Persuadé que l’Intellectuel avait joué parfaitement le comportement de la folie, Querriec le méprisait.
Il le soupçonnait également d’être communiste, sans en avoir la moindre preuve. Son opinion s’établissait sur certains propos entendus au café-tabac, lorsque Braouzec s’échauffait dans les discussions. Et le pire, pensait Querriec, était que l’énergumène semblait appartenir au groupe respectant les accords germano-russes, donc aux ordres de l’envahisseur.
Il allait dépasser le rassemblement lorsque Braouzec l’intercepta brutalement :
— Alors, on évite ses administrés ? Ou on ne salue plus le petit peuple ?
— Mais non ! Qu’est-ce que tu racontes ! mentit le maire effrontément. J’étais dans mes pensées.
Braouzec s’approcha.
— Forcément, avec toutes les bonnes affaires que tu fais en ce moment… L’argent, ça crée des soucis !
— Tu voudrais que je refuse du travail ?
— Non, mais tu pourrais en donner aux autres. Histoire de partager.
— On en a déjà parlé. Apprends un vrai métier et je verrai ce que je peux faire.
— Avec mon bac et mes deux années de droit, je peux être secrétaire de mairie, tu le sais. Mais tu ne veux pas parce que je pourrais mettre le nez dans tes petites affaires.
Querriec eut du mal à contenir sa colère.
— Je n’ai rien à cacher. Et je n’ai pas besoin de quelqu’un qui me cherche querelle continuellement.
Il le quitta aussitôt, et dans son énervement renversa la moitié de son verre sur ses chaussures.
Braouzec le regarda s’éloigner un moment et lui lança :
— On se retrouvera aux prochaines municipales ! J’aurai ma liste !
Les conversations, un instant interrompues, reprirent en sourdine. On connaissait l’antagonisme des deux hommes.
L’inactivité de l’Intellectuel était mise sur le compte de sa santé fragile. C’était une rumeur sans fondement, car personne ne l’avait vu malade ou soigné pour un trouble quelconque.
De quoi il vivait était une question qui, pendant un temps, alimenta la curiosité des îliens.
Une petite pension, suggéraient les uns ; un héritage, affirmaient les autres. La réponse ne s’étant pas présentée, on était passé à autre chose.
Pendant l’Occupation, Braouzec n’avait pas eu de contacts avec les soldats allemands et ceux-ci s’étaient habitués à voir le grand échalas déambuler sur l’île. Car il marchait sans arrêt, arpentant quotidiennement les moindres recoins de ce territoire exigu dont le paysage était pourtant très varié.
Il vivait dans une petite maison de pêcheur isolée, construite tout au bord de la mer sur la côte nord. L’absence de femme à son côté était aussi une question intéressante pour ceux qui, ayant une vie insipide et inculte, se préoccupaient essentiellement de celle des autres.
Là encore les avis divergeaient : il entretenait des rapports coupables avec une des filles Le Gall, mariée à un frère Legarrec, petit patron pêcheur. Quand l’homme était en mer, sa femme était dans le lit de l’Intellectuel : affirmation sans preuve. Il avait une fiancée sur le continent, ou il allait voir les putes de Morlaix, était une autre proposition. Mais rien n’était venu l’étayer.
Quand Braouzec, cessant de fixer le dos du maire, se retourna, il faillit heurter Chang Liu.
Son visage changea d’expression. Le Chinois était le seul homme capable de le faire sourire, de provoquer une expression de bienveillance sur ses traits émaciés. Il avait vingt-neuf ans, mais en paraissait au moins dix de plus.
De son côté, Chang appréciait cet homme étrange avec lequel il pouvait discuter sans fin de la Chine, s’enrichir de l’histoire de l’Europe, et reconstruire éventuellement le monde. L’Intellectuel méritait bien son surnom. Pas un îlien ne possédait ses connaissances, pas même le vieux Jézéquel, considéré à quatre-vingt-cinq ans comme la mémoire de l’île de Batz.
— Ah, maître Chang ! s’exclama Braouzec. Prêt pour fêter la Révolution ?
— Oui, bonjour, monsieur Braouzec. En attendant de préparer la mienne.
— Oh ! Un dangereux subversif veut changer l’ordre des choses ! Qu’on l’arrête immédiatement !
Il baissa la voix, faussement hypocrite.
— Tu veux un coup de main ?
Chang se mit à rire.
— Non, merci. J’y arriverai tout seul.
— Monsieur Mao Tsé-toung ne va pas être content.
Chang ne répondit pas. Son regard devint triste et se porta loin sur la mer. Braouzec devina ses sentiments.
— Tu voudrais bien le rejoindre, hein ?
— Oui…
— Mais tu n’en as pas les moyens.
— Non…
Ils se taisaient à présent, indifférents à la joyeuse ambiance autour d’eux.
Braouzec rompit le silence.
— Viens me voir à l’heure du dîner.
— Vous avez besoin de moi ?
— Non. C’est moi qui vais t’aider.
Chang, surpris, le regarda.
— Je peux vous demander en quoi ?
— Je préférerais : à quoi…
— Bon ! À quoi ?
— À retourner en Chine.
Le jeune homme, stupéfait, ne savait plus que dire.
— Mais… ce n’est…
— Pas maintenant. À tout à l’heure.
Braouzec lui tourna le dos et partit à grandes enjambées, selon son habitude.
Chang, immobile, se demanda s’il avait bien entendu. M’aider comment ? martelait sa voix intérieure.
Bien que son visage ne trahît aucune émotion, un tumulte tonitruant s’emparait de son esprit.
Il consulta sa montre, seul héritage de son père. Il fallait attendre encore quatre heures avant de savoir. Insoutenable. M’aider comment ? Tout à coup il se figea, redressant imperceptiblement la tête : que faudrait-il faire ou donner en échange du retour en Chine ? L’inquiétude fit place à l’excitation. Braouzec avait bien dit : retourner en Chine ? S’agissait-il vraiment de cela ?
Désemparé, Chang se dirigea mécaniquement vers la jetée, répondant d’un sourire aux gens qui le saluaient. Parvenu à l’extrémité, il s’assit sur la fonte rouillée d’une bitte d’amarrage et se perdit sur la ligne d’horizon irrégulière du continent.
*
Pierre-Yves Legarrec avait pris une sérieuse avance sur la hausse du taux d’alcoolémie de ses compatriotes. Les Yec’hed mad ! – à ta santé ! – fusaient de toute part, et il n’avait jamais refusé d’y répondre. Au contraire. La houle qu’il dominait parfaitement en mer le faisait tanguer à terre sur les flots qu’il absorbait maintenant depuis l’heure du petit blanc sec, après la deuxième messe du matin. Il fallait au moins ça pour oublier. Oublier Soazig, oublier sa solitude, oublier les remontrances de sa famille lorsqu’il allait à son travail, négligé, pas rasé, pas sorti des brumes de sa soirée tardive où l’ennui l’avait anéanti.
— Yec’hed mad ! mon garçon.
— Yec’hed mad ! la Marie.
La vieille Marie était un peu éméchée, mais pas au point de ne pas s’apercevoir que l’état de Legarrec devenait alarmant.
— Tu devrais ralentir un peu si tu veux danser tout à l’heure.
— Avec qui tu veux que je danse ? Y a plus personne pour moi ici ! dit-il en s’appuyant contre un mur.
— C’est parce que tu ne sais pas regarder autour de toi. Et puis tu devrais t’arranger un peu aussi. T’es à peine présentable… pour une fête !
Elle s’était rattrapée de justesse, sachant que, à part certaines exceptions, les hommes se souviennent de beaucoup de choses, une fois dégrisés.
Elle l’aimait bien, Marie Guillou, ce gosse devenu homme. Elle l’avait gardé quelquefois quand les parents partaient sur le continent. Il avait une belle frimousse à trois ou quatre ans. Un enfant gentil, serviable. Sa beauté d’adolescent l’avait plus d’une fois troublée alors que, devenue veuve, il n’y avait plus aucun homme dans sa vie.
— Allez, viens avec moi. Je vais te faire à manger. Je parie que t’as rien avalé depuis ce matin.
Legarrec fit un geste vague, traduisant que ça n’avait aucune importance. Marie insista.
— Allez, je t’emmène. Ça te fera du bien.
Elle le prit par le bras et l’entraîna maladroitement. Legarrec se laissa faire, essayant de marcher sans la bousculer. Une larme se perdit dans les chicanes de sa barbe.
— Je t’aime bien, ma petite Marie. Oh oui ! Je t’aime bien…
— Moi aussi, mon garçon. Et c’est pas d’aujourd’hui, hein ? Tu te rappelles quand tu m’avais caché mon porte-monnaie dans la cafetière ? Hein, divalis bihan !
— Ah ben oui que je m’en souviens ! Même que…
Il se mit à pleurer des grosses gouttes salées, toutes celles que la mer avait laissées dans ses yeux quand elle était de mauvaise humeur, ce qui lui arrivait assez souvent.
— Allez, allez, mon petit gars, vas-y carrément, va. Je sais ce que c’est d’être seul…
Ils disparurent au coin de la rue très étroite où se trouvait la maisonnette basse de Marie Guillou.
Les musiciens arrivèrent du continent sur un bateau de pêche de Roscoff. Querriec avait voulu un véritable orchestre, pour deux jours. Le conseil municipal avait voté pour la proposition à l’unanimité moins une voix : Jézéquel, même jeune, n’avait jamais aimé la musique. Il la trouvait inutile et dérangeante. Le chant de la mer était la seule mélodie accompagnant sa longue vie. Il le berçait tous les jours au cours de sa promenade.
L’orchestre sitôt débarqué, tous les jeunes de l’île se précipitèrent pour les accueillir, et surtout pour voir les musiciens déballer et installer leurs instruments.
Huit instrumentistes ! On n’avait jamais assisté à un tel événement musical sur l’île, où un trio était déjà considéré comme très convenable. Les enfants découvraient éblouis une basse, tout l’attirail d’une batterie, un saxophone, une trompette, une clarinette, un accordéon, un trombone et une guitare.
Les adolescents, habitués au violon, à la bombarde ou au biniou, se demandaient quelle musique pouvait faire un tel ensemble.
Les radios transmettaient bien des musiques qu’on écoutait surtout après les informations, mais c’était principalement du classique, ou des succès d’avant-guerre. La révolution se faisait par le jazz américain et quelques variétés. Plutôt rarement.
Un chanteur comique occupait l’actualité radiophonique. Il s’appelait Bourvil et sa chanson racontait les malheurs d’une jeune femme qui vendait des cartes postales et aussi des crayons. Sa personnalité, sa voix incroyable avaient séduit la France entière.
Gwenaëlle Le Gall, épouse Madec, était plantée, fascinée, devant l’estrade où le batteur disposait sa grosse caisse, sa pédale charleston, retendait la peau de sa caisse claire et enfin vissait sur leurs supports les deux gros toms.
La chaleur de cette belle journée la faisait souffrir, car elle attendait son deuxième enfant pour le mois d’août. Elle savait qu’elle ne pourrait pas danser ce soir, alors qu’elle avait vingt ans et ne désirait que cela. Son mari, Pierre Madec, portant son premier fils de deux ans dans ses bras, parlait avec l’accordéoniste afin d’obtenir des nouvelles diverses des bourgades bretonnes où il avait déjà joué.
Toute l’île se rassemblait maintenant sur la place. Les femmes avaient mis leur plus belle robe, et les hommes s’étaient rasés de près. Presque tous étaient allés chez le coiffeur, évitant pour une fois au vent et à leurs casquettes d’organiser leurs cheveux. Tous ceux qui désiraient se marier épiaient attentivement le conjoint possible, passé au tamis des clans, des situations, et bien sûr des désirs instinctifs. Les autres estimaient leurs chances, sachant que de toute façon il faudrait se montrer discret.
Loïc Le Gall, ayant fait son choix depuis quelques jours, profitait de la fête pour se rapprocher. Il voulait être le premier à inviter à danser Marie-Pierre Riou, la fille du cantonnier. Employée modeste chez Dupenhoët, l’adjoint au maire, la belle et plantureuse blonde, sans grande éducation, représentait la proie idéale pour un soir de fête. Et puis elle aussi trouvait le Loïc à son goût, bien qu’elle sût les aventures du séducteur.
Lorsque les notes éclatèrent, ce fut la consternation. À part les enfants qui n’étaient pas inhibés par les codes du comportement insulaire, personne ne savait bien danser sur le jazz pourtant très sage de In the Mood de Glenn Miller.
La musique leur paraissait incroyablement moderne. Ils l’avaient vaguement entendue, émise par leurs postes T.S.F. Mais là, avec toute la puissance des instruments en direct, la dimension sonore n’était plus la même.
Ce fut Dupenhoët qui ouvrit le bal avec sa jeune femme. Ils venaient de Morlaix, où ils avaient étudié tous deux et fréquenté une boîte de nuit-dancing avant le début de la guerre.
On les observa un moment, admiratifs pour leur audace, et aussi pour l’élégante habileté de leurs mouvements. Voyant le gringalet des Le Menez se diriger vers Marie-Pierre, Loïc Le Gall fut contraint d’inviter celle-ci et de l’entraîner dans la danse avant même de recevoir son accord. Les couples se formèrent et se dandinèrent d’abord gauchement. Puis les femmes se détendirent, osant des gestes qu’elles copiaient sur les Dupenhoët. Tout autour des danseurs, ceux qui ne dansaient pas, et qui de toute la nuit ne bougeraient pas, n’en perdaient pas un détail. Les plus vieux se régalaient des formes agréables de certaines, de l’aperçu d’un début de cuisse, de poitrines plus en valeur que d’habitude. Des femmes jugeaient sévèrement les « dévergondées » qui commençaient à bien s’amuser. La jalousie était proportionnelle à la beauté ou à la qualité d’une robe mettant la danseuse à son avantage.
À part l’accordéoniste, qui d’ailleurs ne participait pas à ce morceau, la moyenne d’âge de l’orchestre devait être proche de vingt-cinq ans. Les musiciens jouaient correctement et surtout de tout leur cœur, tout en lorgnant eux aussi les belles filles. Ils ne connaissaient que trop bien leur prestige, et à la pause, il faudrait faire vite pour ne pas finir la nuit seul. Rescapés d’un conflit qui leur avait gâché de belles années, ils se laissaient aller à la joie de vivre sans réserve.
Chang Liu, après avoir regardé au moins cinquante fois sa montre, traversa la place sans accorder la moindre attention aux danseurs, cette fois très nombreux pour un air au rythme langoureux. Évitant également les spectateurs, il prit le chemin escarpé du sémaphore qui menait aux cultures, et plus loin à la dune où se trouvait la maisonnette de Braouzec.
La porte était ouverte, découpée dans le mur par la lumière de la lampe à pétrole posée sur la table à l’intérieur.
Braouzec assis dans le jardinet, sur un billot, fumait une pipe. Il se leva à l’approche du Chinois.
— Bienvenue au paradis du paradis !
— Ah ? C’est ici ?
— Si tu obtiens mieux, je te rejoins. Je trouverai toujours quelqu’un au purgatoire pour louer ici, à n’importe quel prix.
Chang ne trouva rien à ajouter. Vivre ici impliquait une bonne dose de sagesse. Pas de superflu, une semi-retraite et une prise directe avec les éléments.
— Entre, reprit Braouzec. Je nous ai préparé une soupe de poissons. Ça non plus, tu ne l’auras pas ailleurs.
— Pas la même peut-être, mais la cuisine chinoise sait très bien faire ce genre de soupe.
— L’orgueil national, hein ? Eh bien, ça aussi je m’en suis débarrassé. Je n’ai pas envie de partir, mais je pourrais vivre n’importe où dans le monde, sans problème. À condition d’avoir la nature et quelques copains sympathiques, noirs, jaunes, rouges ou verts. Toi, pour le moment, tu veux rejoindre tes six cents millions de copains. Je comprends aussi. Assieds-toi.
Chang s’assit sur une des deux vieilles chaises branlantes et prit place à la table rustique dont le bois poli témoignait d’un usage très ancien. C’était un bel objet d’art populaire, contrairement au reste.
Braouzec retira la marmite en fonte noire de sa crémaillère, au-dessus d’un lit de braises, à l’aide d’un chiffon pour ne pas se brûler.
Il enleva le couvercle qu’il posa dans la pierre à évier, creusée de façon que les liquides s’évacuent à l’extérieur par un trou dans le mur.
Puis, attrapant une louche en bois taillée au couteau, il servit copieusement la soupe dans les deux assiettes en vieux quimper aux motifs jaune et bleu. Il s’assit à son tour.
— Bon appétit, camarade révolutionnaire.
— Merci, euh… sympathisant de la cause du peuple chinois.
Ils goûtèrent avec précaution la mixture très chaude.
— C’est délicieux, apprécia Chang. Vous pourriez ouvrir un établissement public de soupe. Dans mon pays bien sûr… Enfin, mon pays c’est aussi la France qui m’a permis de vivre jusqu’ici, et dans de bonnes conditions, précisa-t-il sincèrement.
— C’est bien que tu le reconnaisses.
Ils mangèrent en silence pendant un moment.
Braouzec reposa sa cuillère bruyamment.
— Bien. Tu dois te poser plein de questions quant à ma proposition de tout à l’heure. Je ne vais pas tourner autour du pot pendant une heure.
Chang, tendu, attendit la suite.
— Tu as compris que ton avenir n’était pas sur l’île de Batz. Ton désir de revanche sur le destin tragique de ta famille est légitime. Et puis… là-bas en Chine tout est à faire, ou à refaire, comme tu veux. Je ne vais pas me lancer dans une analyse des causes de votre déclin. Des historiens, des chroniqueurs l’ont fait mieux que moi. Ce dont je suis sûr, c’est que vous allez vous sortir de là. Et ce serait juste que tu aies ta place dans cette histoire. Alors, voilà…
Braouzec fit une pause pour choisir les bons mots. Une braise en profita pour crépiter, afin de mieux marquer l’importance de ces secondes-là.
— J’ai… j’ai décidé de t’offrir ton voyage et un petit pécule pour subsister une fois sur place.
— C’est pas…
— Ne dis rien, s’il te plaît. J’ai l’argent pour ça, ce n’est pas une difficulté. Il est bien entendu que je te demande en échange une contrepartie pénible.
Chang se raidit, prêt au pire.
— Tu m’enverras des nouvelles chaque fois que tu le pourras.
J’y tiens absolument.
Le jeune homme ouvrit la bouche, ahuri.
— Il n’y a aucun commentaire à faire, c’est comme ça. En ce qui concerne le passeport que tu n’as pas, je me suis arrangé avec le secrétaire de mairie. On t’en a bidouillé un qui te permettra de voyager sans histoires.
Il sortit d’une poche de son pantalon un passeport français qu’il jeta sur la table.
— Ça m’étonnerait que quelqu’un téléphone à la préfecture pour savoir s’il est vrai. Une fois sur place, je te fais confiance pour te débrouiller.
Chang était pétrifié, incapable d’articuler une parole. Braouzec ouvrit le tiroir de la table. Il en retira une enveloppe volumineuse qu’il posa sur le faux passeport.
— Voilà de quoi tenir au moins six mois, une fois ton embarquement payé. Si d’ici là je n’ai pas reçu de carte, j’irai te botter le cul. Maintenant tu vas me demander pourquoi je fais ça. Alors ne le demande pas, parce que je vais te le dire : tu vas agir pour moi, voyager pour moi, voir pour moi. Je n’en ai plus envie. Je suis bien ici… Je ne bougerai plus. Contente-toi de ça.
Les deux hommes restèrent silencieux.
Chang, d’une main qui tremblait légèrement, prit la bouteille de vin et remplit leurs deux verres. Il leva le sien vers Braouzec et prononça avec application :
— Yec’hed mad !
— Yec’hed mad ! C’est exactement ce que tu devais dire.
*
Hans Holbricht mangeait un quignon de pain dur et buvait dans une boîte de conserve U.S. une soupe d’eau trouble. Torse nu, pour économiser sa veste en haillons, il n’arrivait pas à se réchauffer sous un soleil pourtant cuisant. Sa force l’avait abandonné en même temps que son moral. Ils étaient près de six mille à s’entasser dans le camp n° 1101 de Rennes, parqués dans des conditions effroyables. Pas de nourriture, pas de vêtements, pas d’hygiène, pas de soins.
Depuis deux semaines, le dépôt de prisonniers était passé aux mains des Français après avoir été dirigé par les Américains.
Cela n’avait rien changé. La dysenterie faisait rage. Les hommes, squelettiques, mouraient facilement. On entassait les cadavres sous un auvent et on les recouvrait de chaux en attendant leur inhumation dans la fosse commune qu’il fallait creuser.
Les Américains avaient interdit à la Croix-Rouge allemande de s’occuper d’eux et la Croix-Rouge internationale était complètement débordée.
Dans le cadre du programme Éclipse les troupes américaines transféraient sept cent quarante mille prisonniers de guerre allemands sous l’autorité française, laquelle n’avait pas les moyens de subvenir à leurs besoins minimums.
En quittant l’île de Batz, Hans avait jusqu’ici échappé au pire. Enfermé d’abord dans une caserne abandonnée, gardée par des F.F.I., il avait ensuite rejoint le camp d’Erquy, n’hébergeant que des officiers. Son grade de lieutenant l’avait fait sélectionner.
Au printemps 45, la situation s’était alors dégradée. Affecté à des travaux agricoles pour lesquels il endurait des journées de quinze heures, le manque d’alimentation avait détruit sa résistance physique. Il s’était rendu compte aussi que ses employeurs souffraient des mêmes privations. Ils n’avaient donc cure des siennes.
Le camp ayant atteint sa pleine capacité d’accueil, il avait été désigné arbitrairement pour un transfert. Transfert dans l’enfer du camp 1101 à Rennes. Ils n’étaient pas battus, torturés, tourmentés. On les laissait simplement mourir de faim, de froid, de maladie, dans l’indifférence générale.
Les Allemands avaient déclenché un cataclysme ayant provoqué le massacre de soixante millions d’hommes. Il était normal qu’ils en payent le prix. Personne n’allait s’apitoyer sur leur sort. Hans en était conscient. La fureur éclatait dans son esprit lorsqu’il pensait à Hitler et à ses sbires qui l’avaient entraîné dans ce cauchemar, lui qui ne pensait qu’à bâtir, embellir et vivre en harmonie avec la nature.
Les Allemands avaient été subjugués par ce fou qui, dans un premier temps, les avait tirés d’une misère économique terrible, leur avait fait oublier l’humiliation d’une dévaluation monétaire sans précédent : il fallait une brouette de billets de banque pour payer un pain dans les années 1920… Le fou en avait acquis son crédit. Et maintenant la ruine revenait.
Hans se leva péniblement de la borne en pierre sur laquelle il était assis, décrocha la loque pendue à un clou, dans laquelle il rangea sa boîte de conserve.
C’était l’heure de se rassembler pour le travail, même le 14 juillet. Le signal en était donné par le capitaine qui sortait d’un bâtiment. Les hommes se traînaient vers le portail du camp. Sans se parler, ils formaient les mêmes équipes, désignées une fois pour toutes.
Hans se prépara à l’heure de marche pour gagner l’exploitation où il allait passer sa journée. Une fois l’automatisme des jambes enclenché, son esprit s’évada pour retrouver son unique raison de vivre : Soazig et le bébé, dont il n’avait aucune nouvelle.
*
Jean-Marie Le Gall, le frère de Loïc, était un des rares à avoir la tête claire en ce samedi matin du 14 juillet 1945. Il s’était couché raisonnablement avec son épouse, lui avait fait sagement l’amour dans le noir, et son sommeil avait été sans trouble.
Quelle belle journée ! pensa-t-il, alors qu’il se rendait chez la veuve Le Floc’h pour discuter de l’acquisition de ses terres. La vieille dame s’était battue jusqu’au bout pour les conserver, partageant ses revenus avec ses deux employés. Ceux-ci étant presque aussi âgés qu’elle, il fallait soit les remplacer, soit vendre. Les Le Gall, à l’affût depuis longtemps de ces terrains contigus aux leurs, pressentaient que le bon moment était arrivé de faire une offre. Loïc s’en était chargé. Madame Le Floc’h, comme toutes les personnes âgées, en était restée à des prix loin d’être actuels. Si bien que la somme proposée par Loïc lui avait semblé intéressante.
— Les terres ne seront pas pour moi, mais pour Jean-Marie qui a besoin d’agrandir son exploitation, avait-il précisé. Ajoutant qu’il aidait son cadet par ses conseils, car le jeune homme n’était pas suffisamment expérimenté.