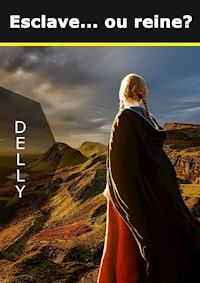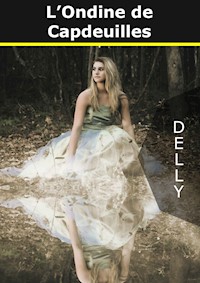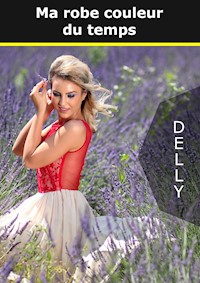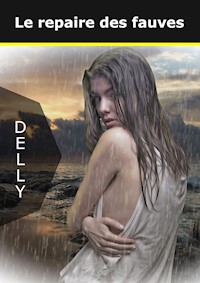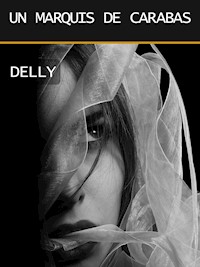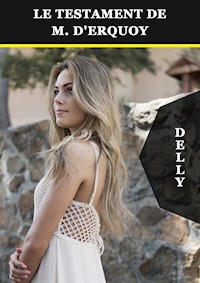2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
« Aimer, c'est souffrir. Je ne veux pas souffrir, donc je n'aimerai pas. » Telle est la détermination que prennent, chacun de leur côté, Sylvie d'Arbouze et Nigel Ogerlof. Mais qui osera faire la loi au destin ? Les voilà en présence. Elle est jolie, malheureuse parce qu'elle est orpheline et dans une situation humiliante. Nigel, doué d'un remarquable talent de violoniste, entend par hasard les sons d'un piano. Il reconnaît Chant d'exil, pièce de sa composition. C'est Sylvie qui joue. Il en fait son accompagnatrice, puis sa femme. Ce mariage, une fin ? Non, un prologue, car l'accord des époux ne va plus loin que la mise en commun de leurs talents artistiques. Et ainsi débute le drame qui se jouera entre ces deux âmes. Jusqu'où ces fous, qui se croient sages, pousseront-ils la folie ? S'acharneront-il à poursuivre un mirage trompeur ? Ils se griseront d'abord de succès et de plaisirs, puis connaîtront l'amère saveur de la lassitude. Pour traiter avec grâce ce problème délicat, il fallait un maître averti de la psychologie humaine. Ce maître, c'est Delly.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 170
Ähnliche
Folie de sages
Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIPage de copyrightFolie de sages
Delly
I
Le brouillard étendait encore sur la vallée son voile léger au travers duquel commençait de pénétrer le soleil. Le long des sommets flottaient des lambeaux vaporeux, évanouis peu à peu dans la lumière. Ainsi apparaissaient dans leur somptueuse sérénité automnale les arbres couvrant le flanc de la montagne. Entre les feuillages aux tons de rouille et d’or, le torrent bondissait tout écumant dans la vallée. Happé par le brouillard, il disparaissait, mais un grondement dénonçait la présence du gave impétueux qu’il devenait plus bas. L’air vif et frais sentait la terre humide, la feuille morte trempée de rosée, la plante sauvage éveillée sous la tiédeur du soleil. Le sifflet de petits pâtres s’appelant et se répondant troublait seul parfois l’harmonieux silence auquel servait d’accompagnement le bruit sourd, ininterrompu, de l’eau torrentueuse.
Dans la vallée la brume tenace cédait enfin, son tissu diaphane, se désagrégeait, s’effilochait lentement. Elle laissait maintenant deviner les contours d’un château tout blanc, une merveille de petit château semblant presque suspendu dans les airs, car la brume lumineuse planant encore sur le fond de la vallée laissait à peine entrevoir les jardins en terrasses et le lac dans lequel ils se miraient.
Le son grêle d’une cloche monta jusqu’au tertre ombragé de vieux hêtres sur lequel Nigel Ogerlof se tenait debout, une main appuyée à l’encolure de son cheval, l’autre caressant de sa cravache le grand chien blanc couché à ses pieds.
– Allons, il est temps de rentrer, Stip ! L’ami Pierre doit nous attendre.
D’un bond souple il se mit en selle. Le bai brun aux formes parfaites, aux mouvements fougueux, s’ébroua joyeusement. Nigel le maintint d’une main ferme et jeta un dernier regard sur la vallée.
À peine quelques parcelles de brume flottaient-elles encore çà et là. Le village apparaissait, groupé autour de son église romane qu’entourait le cimetière ombragé de platanes. Le gave s’évadait bruyamment entre les rocs qu’il couvrait de son écume.
Au bas des jardins garnis de fleurs d’automne, le lac étendait sa belle nappe d’eau qui reflétait le bleu pâle du ciel et sur laquelle des cygnes promenaient lentement leur robe immaculée.
Au-dessus, les hauts sommets, les pentes couvertes de leurs bois dorés par le soleil, les pâturages couchés au flanc de la montagne formaient un cadre de beauté lumineux à ce petit pays de la vallée.
Nigel engagea son cheval sur la pente raide ombragée de vieux arbres tordus. Des feuilles mortes se détachaient des branches brunies, voltigeaient autour du cavalier, frôlaient ses cheveux blonds, son visage aux traits fermes, un peu durs. Le chien bondissait au-devant du cheval, parfois rappelé au calme par la voix brève de son maître.
Dans la vallée, Nigel traversa le gave sur un vieux pont de pierre. Il croisa quelques paysans, quelques femmes. Tous le saluaient avec déférence, mais sans empressement, et chez lui, le léger signe de tête par quoi il leur répondait indiquait la plus complète indifférence.
Laissant à sa gauche le village, il s’engagea dans une allée de platanes, franchit une grille, chef-d’œuvre de ferronnerie, contourna le lac bleu. Devant lui se dressait, au-dessus de ses terrasses fleuries, le petit château blanc. Une rampe douce, ornée de grands vases de marbre, menait à la cour d’entrée qu’entourait une balustrade de marbre également.
Nigel mit pied à terre, jeta les rênes à un domestique et contourna le château. La façade donnait de ce côté sur une large terrasse où flamboyaient des sauges et des dahlias de tous les tons du rouge. Un jeune homme était assis là, feuilletant des journaux. Il se leva avec vivacité pour venir à Nigel, la main tendue, la physionomie éclairée d’un franc sourire.
– Tu étais en veine de promenade solitaire ce matin, Nigel ?
– J’ai été voir la brume se lever sur la vallée. Puis, comme tu le dis, j’avais des idées de solitude. Je suis un original, tu le sais, mon ami Pierre.
Il lui frappa amicalement sur l’épaule.
– ... Tu ne t’en formalises pas, heureusement.
– Non, non, mon cher. Je te connais et je te tiens pour le meilleur des amis.
– Tu me connais ?
Un sourire d’ironie venait aux lèvres de Nigel. Cette même ironie se discernait dans les yeux noirs dont les admiratrices de Nigel Ogerlof disaient « qu’ils attiraient comme le plus irritant mystère ».
– ... J’en doute, mon bon Pierre. En ce cas, tu serais plus avancé que moi.
Pierre le regardait d’un air pensif, un peu perplexe. Ce que disait là son ami était exact, il fallait le reconnaître. Ils avaient fait leurs études au même collège et n’avaient depuis lors cessé d’être en relations d’amitié. Mais pas plus maintenant qu’autrefois, Pierre ne savait ce qu’étaient véritablement l’âme, le cœur de ce beau Nigel fantasque, artiste adulé, insoucieux d’autrui, du moins le disait-il.
Les jeunes gens s’assirent près de la table couverte de revues et de journaux. Jetant sa cravache sur un siège voisin, Nigel se pencha pour prendre une cigarette dans une coupe d’onyx.
– Nous pourrions faire cet après-midi une excursion à ton goût, Pierre ?
– J’aimerais voir ces mines dont tu m’as parlé hier soir.
– Soit ! Et pourquoi ne partirions-nous pas avant le déjeuner ? Je ferai mettre des provisions dans la voiture, car il n’y a sur la route que des auberges assez primitives.
– Très volontiers ! Ce pays est admirable et je comprends que tu t’y plaises. En outre, une si parfaite installation !... Tu es un sybarite, Nigel !
– Il faut prendre de la vie tout ce qu’elle nous offre d’agréable. La beauté des choses, les satisfactions de l’art, les émotions à fleur de peau, la griserie des applaudissements, de l’admiration, des adorations féminines, voilà ce qui me plaît et de quoi je vis... Voilà ce qui ne fait pas souffrir. Que vaut tout le reste ?... tout ce que l’on appelle généralement le bonheur ? L’amour ? Les affections familiales ? Je n’ai jamais connu tout cela, je ne veux pas le connaître. C’est à peine si je fais une exception pour l’amitié. Encore est-ce seulement en ta faveur, Pierre, parce que je crois avoir reconnu en toi un être loyal et désintéressé.
– Tu n’en es pas sûr ?
Dans les yeux bleus de Pierre, qui éclairaient si bien son maigre visage bruni, passait une expression de tristesse.
– Si, autant qu’on le peut en parlant d’un être humain, qui est l’inconnu, le mystère.
– Oh ! je ne me crois pas bien mystérieux, dit pensivement Pierre. Tu peux être assuré en toute sérénité, je te l’affirme, que je suis pour toi un ami dévoué. C’est pourquoi je suis peiné des singulières dispositions d’esprit qui existent chez toi. Vraiment, ton scepticisme, ton dilettantisme m’effrayent, mon cher Nigel.
Nigel, tout en allumant sa cigarette, eut un rire moqueur.
– Est-ce parce que je t’ai dit un jour que je me gardais soigneusement de l’amour ? Je pensais que tu allais m’octroyer un brevet d’éminentissime sagesse. Pas du tout, voilà que je t’effraye ? Et pourquoi donc, s’il te plaît ?
– Je crois, Nigel, que tu agis ainsi parce que tu laisses dominer en toi ce sentiment qu’on appelle la peur de vivre et qui est surtout la peur de souffrir.
Nigel enleva la cigarette de ses lèvres. Subitement, ses traits se durcissaient. Il dit nettement :
– C’est exact. Je n’aimerai jamais parce que l’amour est essentiellement une source de désillusions et de soucis parfois cruels. Je n’aurai pas de famille parce que la famille procure des chagrins sans nombre pour une petite source de joies. Je resterai indifférent aux épreuves d’autrui, à toutes les misères de ce monde, parce qu’en cherchant à les soulager je recueillerais surtout des déceptions. De la vie, je ne veux que les fleurs.
– Nigel, ce ne sont pas là les sentiments d’un chrétien !
– Oh ! je le suis si peu, si peu ! De vagues notions religieuses inculquées à mon enfance distraite et oublieuse... et les enseignements de mon père qui ont tout effacé !
Pendant quelques secondes, Nigel resta silencieux, le front barré d’un pli profond.
– ... Mon père... il est mort, lentement tué, du désespoir causé par la mort de ma mère. Il l’aimait passionnément, uniquement, et en avait fait son idole. Le château fut construit pour elle, orné selon ses goûts pour en faire le temple de sa beauté. J’avais huit ans lorsqu’une maladie foudroyante l’enleva en deux jours. Dès lors, mon père ne fit plus que traîner sa vie. Il ne s’attacha pas à moi, et un jour il m’en donna la raison : « Je ne veux pas t’aimer parce que je craindrais trop de te perdre aussi. » C’est lui qui m’a inculqué ces sentiments dont tu t’effrayes. Ils se sont profondément implantés parce qu’ils correspondaient, je suppose, à l’instinctive horreur de la souffrance morale que j’ai toujours portée en moi.
– Mais cette horreur, nous l’avons tous, Nigel.
– Pas au même degré. En tous cas elle ne t’empêchera pas de te marier, de donner toute ton affection à une femme que la mort peut t’enlever inopinément, d’avoir des enfants qui te feront souffrir de façon ou d’autre.
– Mais c’est la vie, cela, mon pauvre ami. Des épreuves, quelques joies, des consolations...
– Eh bien, de cette vie, je ne veux pas ! Souffrir comme mon père, traîner une existence broyée, sans espoir ! Ou bien risquer d’être trahi, délaissé... oh ! non, non !
Nigel parlait avec une sourde véhémence. Une inflexible résolution durcissait son regard. Pierre pensait : « Pour que ce dilettante redoute ainsi la souffrance morale, il faut qu’il ait un cœur bien sensible ! »
Nigel avait remis la cigarette entre ses lèvres. Il regardait au loin vers les sommets voilés d’une brume lumineuse. Pierre considérait avec un affectueux intérêt le ferme profil, la bouche qui gardait un pli d’amertume. Il laissa échapper tout haut sa pensée :
– En ce cas tu ne te marieras jamais.
– Probablement. Cependant, je ne serais pas fâché d’avoir chez moi une aimable maîtresse de maison pas trop désagréable à regarder. Mais il serait peut-être difficile de lui faire admettre mon indifférence à son égard.
– Certes ! Tu ne peux guère compter sur cela, mon ami.
– Eh bien, soit, je mourrai dans la peau d’un célibataire ! Maintenant, je te laisse, Pierre. Il faut que je donne des ordres pour notre excursion.
Nigel se leva et Pierre l’imita. Ils étaient tous deux assez grands et minces, mais chez Pierre Dugannec n’existait pas la sveltesse élégante de son ami, ni cette souplesse un peu nonchalante de l’allure, des attitudes. Il avait une physionomie sans mystère, franche, intelligente, éclairée de bonté. Près d’elle, celle de Nigel semblait receler encore plus d’énigme et dégager plus de subtile séduction.
– J’ai eu ce matin une lettre de mon oncle, dit Pierre. Il m’attend pour la semaine prochaine. Tu ne te décides pas à m’accompagner dans cette Bretagne que tu aimes ?
– T’accompagner, non. Mais peut-être irai-je y faire une apparition avant de gagner Copenhague. Je reverrai avec plaisir ce golfe du Morbihan et je puis aussi bien m’embarquer sur un point de cette côte.
– Voilà une bonne nouvelle ! Quand je la transmettrai à mon oncle, il sera au septième ciel. Jusqu’ici il ne t’a entendu que par le truchement du disque. Mais si tu lui fais la faveur de jouer une seule fois pour lui, quelle joie ! Je crois qu’on trouverait difficilement plus fervent mélomane.
– Eh bien, nous le contenterons, cet excellent homme. Il est remarié, m’as-tu dit ?
– Oui, depuis six ans. Il a épousé une veuve de trente ans plus jeune que lui. Elle l’entoure de soins, d’attentions, flatte toutes ses petites manies. Ainsi elle a réussi à prendre une grande influence sur cet homme d’esprit autoritaire, maintenant âgé et mal portant.
– Elle ne t’est pas sympathique ?
– Je dois avouer que non. Mais lui, mon grand-oncle, est bon sous des dehors parfois brusques, et je l’aime beaucoup. Il a près de lui depuis deux ans une nièce de sa première femme, une orpheline sans fortune, qui est une remarquable musicienne. Mais Mme Tréven en fait une sorte de femme de charge, et même parfois de femme de chambre. Je me doute que cette pauvre Sylvie doit avoir des moments pénibles à passer. Mais c’est une étrange fille, une nature assez mystérieuse.
Les deux jeunes gens firent quelques pas sur la terrasse. Nigel dit pensivement :
– Je crois que sans cette série de concerts que je dois donner au Danemark et en Suède, je serais resté ici jusqu’à l’hiver. J’aime cela...
Il étendait la main vers les parterres fleuris où se dressaient des vases de marbre, des statues aux formes harmonieuses ; il montrait les bois, les prairies, les sommets au-dessus desquels flottaient de légers nuages, semblables à quelque duvet floconneux.
– ... Ta Bretagne est quelque chose de très différent, et qui m’attire cependant. Oui, j’irai la revoir probablement et en même temps je ferai la connaissance de la Ville-Sauzac.
– C’est un manoir assez agréable. Mon oncle y habite maintenant toute l’année, mais sa femme se rend fréquemment à Vannes où elle a de la famille, entre autres, une jeune cousine qu’elle voudrait bien me voir épouser.
– Ah ! ah ! Te plaît-elle ?
– Pas du tout ! Le genre pécore, tu vois cela d’ici ?
– Très bien. Mais tu es un bon parti, avec quelque fortune et un bel avenir comme ingénieur. Prends garde de ne pas te laisser prendre, mon cher ! Puisque tu es inconvertissable au célibat, je voudrais du moins te voir marié selon tes goûts, et le moins malheureux possible.
– Mais j’espère bien être très heureux, affreux sceptique.
Nigel eut un rire railleur.
– Combien de temps le seras-tu ? Ah ! pauvre homme que tu es, j’ai choisi la meilleure part ! Supprimer le cœur, vois-tu, c’est le grand secret de la vie.
– Chose à discuter ! En tous cas, on ne le supprime pas aussi facilement que cela.
– Mais si. Vois le mien, il n’a jamais aimé, il n’éprouve que des émotions passagères et superficielles. Je le possède parfaitement, je suis son maître et le resterai.
– Admettons-le ! Mais moi, j’aime mieux sentir mon cœur battre, connaître l’amour, les affections de la famille, et même les émotions pénibles. C’est un cœur vivant, du moins ! Tandis que le tien, s’il est comme tu le prétends, est mort, ou à peu près.
Nigel dit froidement :
– Il est mort, oui, et je ne lui permettrai jamais de revivre.
II
Trois semaines plus tard, la voiture de Nigel Ogerlof s’arrêtait dans la cour du manoir de la Ville-Sauzac.
Au jeune domestique en tablier blanc apparu au seuil du logis, Nigel demanda :
– M. Dugannec est-il ici ?
– Non, monsieur, il est parti faire une course à Arradon ; mais il sera certainement bientôt rentré.
– Alors, je vais l’attendre.
– Si monsieur veut entrer ? dit le valet dont le regard admiratif se posait tour à tour sur la superbe voiture, sur le voyageur de si fière mine, sur le grand chien blanc étendu à l’intérieur.
Nigel acquiesça et fut introduit dans un salon garni de vieux meubles disposés avec goût. Il donnait par deux portes vitrées sur un jardin ombreux. Nigel s’approcha de l’une d’elles. Et tout à coup, il tendit l’oreille. Les sons d’un piano arrivaient jusqu’à lui, sans doute par la fenêtre d’une pièce voisine. Il reconnaissait une de ses compositions, la préférée, Chant d’exil, qu’il avait arrangée pour piano seul et dont les critiques les plus compétents faisaient grand cas.
En général, il n’aimait pas entendre interpréter ses œuvres, car les meilleurs musiciens les comprenaient rarement comme lui et il en éprouvait, dans sa sensibilité d’artiste, un véritable agacement. Mais cette fois, il en était autrement. La musicienne inconnue – car il lui semblait bien reconnaître un jeu féminin – s’identifiait complètement avec l’inspiration de l’auteur. Elle savait rendre toute l’originalité, tout le charme alangui et la mélancolie tendre qui faisaient de cette œuvre quelque chose d’infiniment délicat et de très personnel.
« Un rare tempérament d’artiste ! songea-t-il. Serait-ce la nièce de M. Tréven dont Pierre m’a parlé ? »
Dans une allée du jardin s’avançait un grand et maigre vieillard, appuyé sur une canne. Nigel se retira discrètement à l’intérieur du salon. Quelques minutes plus tard, le piano se tut, puis un peu après une porte s’ouvrit et le vieillard entra.
– Vous êtes sans doute M. Ogerlof ? Pierre vous attendait un peu tous les jours...
– Je m’excuse de venir vous déranger ainsi monsieur. Mais Pierre a beaucoup insisté...
– Et il a eu bien raison ! C’est un honneur et une joie pour moi de vous recevoir, car je suis un de vos grands admirateurs. Mon neveu ne peut tarder. Ainsi que je vous le disais, il vous attendait cette semaine et ne s’éloignait guère d’ici.
Ayant fermé la fenêtre, M. Tréven s’approcha du feu qui flambait dans la cheminée en invitant son hôte à s’asseoir. Il avait un visage raviné par l’âge et la maladie, des yeux encore vifs derrière les lunettes cerclées d’écaille. Nigel put se convaincre, dans la conversation qui s’engagea, que son intelligence était restée lucide et que son esprit ne manquait pas d’agrément.
Pierre apparut peu après, tout joyeux. M. Tréven s’éloigna un moment et revint accompagné de sa femme, corpulente quadragénaire au teint encore frais, à la mise élégante. Bien que, dans sa physionomie, quelque chose lui déplût, Nigel lui sut gré de ne pas l’accabler de compliments, comme ses admirateurs des deux sexes avaient coutume de le faire. Il était orgueilleux, conscient de sa valeur, aimait, en son for intérieur, qu’on l’encensât, qu’on l’adulât, mais la fatuité n’existait pas chez lui, trop réellement intelligent pour tomber dans ce travers.
Tandis qu’il s’entretenait avec ses hôtes, quelqu’un entra, portant un plateau. Mme Tréven dit avec un accent autoritaire :
– Posez cela sur cette table, Sylvie, et servez-nous.
Nigel tourna légèrement la tête. Il vit une mince jeune fille brune, vêtue de noir. Ses paupières un peu baissées ne laissaient pas voir les yeux et elle ne les releva pas en répondant au salut de Nigel. Elle déposa le plateau sur une table près de Mme Tréven et se mit à verser le thé dans les tasses de porcelaine fleurie.
Tout en continuant de causer, Nigel la considérait discrètement. Était-ce elle, la musicienne entendue tout à l’heure ? Elle avait de très jolies mains, un peu longues, effilées, qui maniaient les objets avec adresse. Les cheveux d’un noir brillant, coiffés en une natte formant couronne sur la tête fine, faisaient ressortir la blancheur mate du visage un peu amaigri, aux traits délicats. Cette jeune personne semblait absorbée dans sa tâche ménagère et quand elle vint offrir une tasse, puis des pâtisseries à Nigel, il vit à peine son regard entre les cils foncés.
– Sylvie, mon enfant, demande un peu de lait pour moi, dit M. Tréven.
Et se tournant vers son hôte, il ajouta :
– Ma nièce, Sylvie d’Arbouze, est très enthousiaste de vos œuvres, monsieur, et elle les joue d’une façon que je trouve remarquable.
– Je m’en suis rendu compte moi-même tout à l’heure en entendant mademoiselle exécuter Chant d’exil, dit Nigel.
Cette fois, il rencontra le regard de la jeune fille. C’était un beau regard, sérieux, profond, avec un reflet d’enthousiasme.
– J’aime tant cette œuvre ! Je ne me lasse pas de la jouer.
La voix était un peu basse, avec des notes chaudes qui frappèrent agréablement l’oreille de Nigel.
– Et moi de l’entendre, ajouta M. Tréven.
– Allez chercher le lait de votre oncle, Sylvie. Comment avez-vous pu l’oublier ? dit sèchement Mme Tréven.
– Je n’en ai pas pris ces derniers jours, ma chère amie. Elle a pensé qu’il en serait de même aujourd’hui, fit observer le vieillard.
– Elle pouvait en tout cas vous le demander, mon ami.
« Eh ! Pierre avait raison en supposant que la jeune personne ne devait pas être heureuse près de cette aimable dame », pensa Nigel.
Quand il voulut, un peu après, se retirer pour gagner Vannes où il pensait coucher, ses hôtes se récrièrent. Ils comptaient bien le garder à dîner et avaient une chambre à sa disposition.
– ... Pour une nuit, ou pour plusieurs jours, si ne vous déplaît pas trop notre modeste hospitalité, ajouta M. Tréven, Pierre en sera si heureux... et je n’ai pas besoin d’ajouter que ce sera pour nous aussi un grand plaisir.
– Accepte, Nigel ! dit Pierre d’un ton de prière. Tu n’es pas pressé d’aller t’embarquer pour Copenhague, puisque tes concerts ne commencent que le mois prochain.
– Pas du tout pressé, en effet... et j’accepte votre invitation, monsieur, en toute simplicité.
Sylvie avait disparu. Nigel ne la revit que dans la salle à manger, où elle prit place près de son oncle. Elle portait une robe de voile noir très simple, à peine échancrée au cou. Pendant tout le repas, elle resta silencieuse, semblant se désintéresser de la conversation très animée entre M. Tréven, Pierre et Nigel, celui-ci original causeur, qui savait donner à tous les sujets un tour captivant. Mme Tréven jetait quelques mots judicieux dans l’entretien, mais elle paraissait occupée surtout à surveiller le service du jeune domestique. Elle était une parfaite maîtresse de maison, avait dit Pierre à son ami. Mais Nigel n’aimait pas certaines expressions de sa physionomie, certaines lueurs dures dans son regard.
Dans le salon, quand les trois hommes eurent fumé une cigarette, M. Tréven demanda :
– Aurons-nous, monsieur, la joie de vous entendre ce soir ?
– Je le ferai avec plaisir. Peut-être mademoiselle votre nièce pourrait-elle m’accompagner puisqu’elle paraît si bien comprendre ma musique ? Je voudrais voir comment elle le fera, car – Pierre vous l’a peut-être dit ? – ce n’est pas chose facile avec moi.