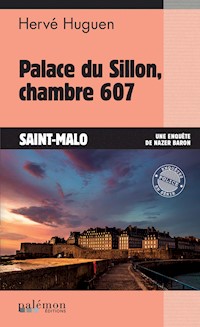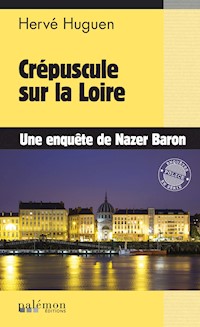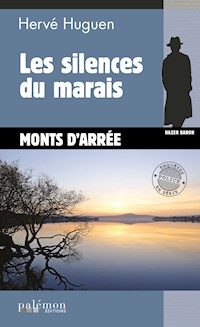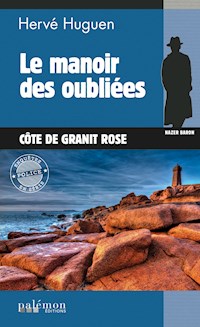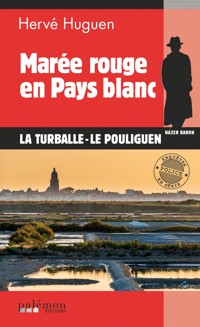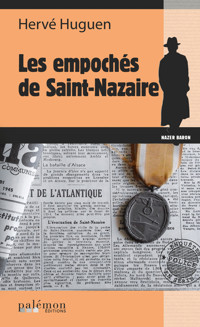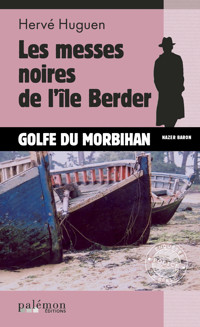Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Palémon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes du commissaire Baron
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Trois cadavres jalonnent la nouvelle enquête du commissaire Baron !
Un cadavre abandonné dans une malle sur un quai du port de Nantes ; un second, sur une île déserte ; un troisième, dans une chambre d’hôtel fermée de l’intérieur. Deux hommes et une femme « innocents » précise l’assassin qui propose au commissaire Nazer Baron un jeu de piste machiavélique. À ce dernier de déjouer les apparences pour exhumer de tragiques vérités…
Découvrez sans plus attendre une enquête du commissaire Baron sur les traces d'un assassin joueur et cruel.
EXTRAIT
Baron avait tendu la main. Le message était un simple feuillet glissé dans son sachet de protection, un document anonyme sur lequel avaient été collées des lettres irrégulières découpées dans des journaux. La taille des caractères en était variable, l’impression également, la qualité du papier changeait…
Baron déplaça lentement son regard. Sur l’avertissement retrouvé dans la poche de Boris Frilac, le laboratoire était parvenu à identifier sept origines différentes. Jamais de mot complet, uniquement des lettres, grandes ou petites, fines ou grasses, dix-sept exactement, récupérées dans des quotidiens et des revues.
« Le second innocent »
Rien d’autre. Pas de signature et sûrement pas d’empreintes. Baron raccrocha le fil de ses souvenirs. Boris Frilac, l’homme de la malle du quai des Antilles, avait bien été le premier.
— C’est votre homme ? s’inquiéta Blanlœil.
Les textes étaient rigoureusement identiques, à un mot près… Ça signifiait quoi ? Qu’un troisième innocent suivrait, un quatrième… ? Baron en avait soudain froid dans le dos.
— Les mêmes mots, le même papier… jugea-t-il en parcourant la feuille des yeux, une dernière fois.
— Vous savez ce que ça veut dire ?
Il remua négativement la tête, faisant involontairement sauter quelques gouttes d’eau du bord de son chapeau.
— Pas pour l’instant, dit-il.
C’était au moins la centième fois qu’il lisait ces mots. Ça ne lui servait à rien. Les revues et les journaux dans lesquels avaient été découpés les caractères n’étaient pas des publications confidentielles, avec des listes d’abonnés qu’ils auraient pu éplucher.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Le nantais
Hervé Huguen est avocat de profession, mais il consacre aujourd’hui son temps à l’écriture de romans policiers et de romans noirs. Son expérience et son intérêt pour les faits divers - ces évènements étonnants, tragiques ou extraordinaires qui bouleversent des vies - lui apportent une solide connaissance des affaires criminelles. Passionné de polar, il a publié son premier roman en 2009 et créé le personnage du commissaire Nazer Baron, un enquêteur que l’on dit volontiers rêveur, qui aime alimenter sa réflexion par l’écoute nocturne du répertoire des grands bluesmen (l’auteur est lui-même musicien), et qui se méfie beaucoup des apparences…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HERVÉ HUGUEN
Silence fatal
DU MÊME AUTEUR
1. Dernier concert à Vannes
2. Les messes noires de l’île Berder
3. Ouragan sur Damgan
4. Le canal des Innocentes
5. Retour de flammes à Couëron
6. Les empochés de Saint-Nazaire
7. L’inconnue de Nantes
8. Le cimetière perdu
9. Silence fatal
Retrouvez ces ouvrages surwww.palemon.fr
Dépôt légal 2etrimestre 2016
ISBN : 978-2-372601-31-3
CE LIVRE EST UN ROMAN.
Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres,
des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant
ouayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle de la présente publication, faite par quelque procédé que ce soit (reprographie, microfilmage, scannérisation, numérisation…) sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’autorisation d’effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du Centre Français d’Exploitation du droit de Copie (CFC) - 20, rue des Grands Augustins - 75 006 PARIS - Tél. 01 44 07 47 70/Fax : 01 46 34 67 19 - © 2016 - Éditions du Palémon.
«
Prologue
PROCÈS-VERBAL D’AUDITION
Personne entendue : Lampin Yvette née le 27 mars 1968
Ce jour, douze octobre
Nous soussigné (s), Paraut Roger, M.D.L. Chef O.P.J.
Duclerc Alain, Gendarme A.P.J.
Vu les articles 16 à 20 et 75 du code de procédure pénale, rapportons les opérations suivantes que nous avons effectuées.
Le douze octobre dans nos locaux, à 9 heures 45, nous entendons :
Lampin Yvette, née le 27 mars 1968 à Nantes (44), demeurant résidence Jules Verne à Notre-Dame-des-Landes, de nationalité française, qui déclare :
« Il devait être aux alentours de sept heures et demie lorsque j’ai quitté la maison. Le jour n’était pas encore levé. Je ne roule jamais vite, même dans la campagne, et la chaussée était mouillée, disons que j’ai dû atteindre Héric quelques minutes avant huit heures.
SI : J’étais à l’heure lorsque je suis arrivée à la Boulardière. Mon contrat prévoit d’y être un jeudi sur deux à partir de huit heures, et un mardi par mois, toujours à la même heure. Monsieur Deville avait l’habitude de me laisser un mot dans un cahier d’écolier que je trouvais sur la table de la cuisine, il me disait ce qu’il souhaitait me voir faire en priorité et j’y passais ensuite la matinée, je lui faisais un petit compte rendu avant de partir, en lui confirmant mes horaires. Il n’y a jamais eu de problèmes, le dernier jour du mois, je trouvais dans le cahier le chèque de ce qu’il me devait, accompagné d’un bulletin de salaire.
SI : Il s’agit bien du cahier que vous me présentez (scellé n° 24).
SI : Je travaille chez monsieur Deville depuis environ quatre ans, en fait depuis qu’il s’est séparé de sa femme qui est partie vivre à Saint-Brieuc. J’ai toujours procédé de la même façon chez lui, je faisais le plus gros du ménage et monsieur Deville s’occupait lui-même du linge et des travaux plus légers. Je dis lui-même mais à vrai dire, je n’en sais rien, c’est peut-être sa compagne ou quelqu’un d’autre. Je sais qu’il ne vivait pas seul parce que je le voyais en faisant le ménage, mais je ne connais pas cette personne, je ne l’ai jamais rencontrée. La maison est toujours vide lorsque j’arrive à huit heures, simplement, je trouve des affaires appartenant à une femme dans la maison, des vêtements et des produits de cosmétique.
SI : Je ne peux pas vous le dire, j’ignore totalement qui elle est.
SI : Je ne peux pas vous dire non plus grand-chose à propos de monsieur Deville, nous ne nous sommes pas rencontrés souvent, nous nous organisions par écrit et j’ai dû lui téléphoner seulement deux fois en quatre ans, parce que j’avais un empêchement de dernière minute.
SI : Je n’ai pas les clés de la maison, monsieur Deville m’en laissait une dans une boîte qu’il cache derrière le gros pot de terre placé à gauche de l’entrée, dans l’allée. J’ai l’habitude de la remettre à cet endroit avant de partir, une fois mon travail terminé.
Ma première surprise en arrivant a été de voir la voiture de monsieur Deville toujours garée sous l’appentis, à gauche de la maison. D’ordinaire, comme je vous l’ai dit, il n’y avait personne, monsieur Deville était déjà parti, je crois qu’il aimait gagner son bureau avant le gros des embouteillages sur le boulevard périphérique. J’ai pensé qu’il pouvait être malade ou qu’il avait peut-être pris un jour de congé… Je pensais plutôt à un souci de santé parce que les volets étaient toujours fermés, je ne voyais pas s’il y avait de la lumière.
Je me suis garée dans la cour et ensuite, je n’ai pas trouvé la clé à l’endroit où il la déposait d’ordinaire, ce qui ne m’a pas inquiétée parce qu’à ce moment-là, j’avais toujours dans l’idée qu’il se trouvait à l’intérieur et qu’il allait m’ouvrir. Je me suis approchée pour sonner et c’est là que j’ai vu que la porte était légèrement entrouverte.
SI : Je suis formelle, elle était entrouverte, comme si quelqu’un l’avait simplement tirée derrière lui en sortant, le pêne n’était pas enclenché. J’ai commencé à avoir peur, ce n’était pas du tout dans les habitudes de monsieur Deville d’oublier de boucler derrière lui. J’ai poussé et j’ai appelé dans un premier temps, sans entrer.
Personne ne m’a répondu et je ne savais pas trop quoi faire, je devinais bien qu’il y avait quelque chose d’anormal mais j’hésitais. Les premiers voisins sont à deux cents mètres et sur le coup, j’ai pensé à les prévenir, puis je me suis dit que je serais totalement ridicule si monsieur Deville ne me répondait pas pour une raison banale. Alors j’ai traversé le vestibule en appelant en direction de la salle, mais toujours rien.
SI : L’entrée était plongée dans le noir, la lumière brûlait seulement à l’intérieur, il y avait un cadre lumineux autour du battant du salon, assez pour permettre de se diriger. Je n’ai pas osé pousser la porte comme ça, j’ai frappé, j’ai de nouveau appelé et j’ai attendu. Comme personne ne me répondait, j’ai fini par ouvrir et par m’avancer dans la pièce. Il y avait une odeur bizarre. Le plafonnier était éteint, il n’y avait que la grosse lampe Empire qui était allumée sur le guéridon, j’ai vu un verre qui n’était pas vide, comme si quelqu’un avait commencé à boire là, assis au coin du canapé.
Je me suis avancée et c’est à ce moment-là que je l’ai découvert, allongé entre la table basse et le divan. Il était sur le dos, légèrement tordu, habillé d’un pantalon noir et d’un gilet sur sa chemise sans cravate. Ses yeux regardaient vers l’endroit où je me trouvais, j’ai crié tellement j’ai eu peur parce que j’ai cru qu’il me regardait entrer, et puis j’ai compris qu’il ne voyait plus rien parce qu’il ne bougeait pas du tout.
SI : Je n’ai touché à rien, je suis seulement allée vers lui et je me suis penchée, je voyais bien qu’il était mort, il ne respirait plus, et puis il y avait cette flaque de sang sous son crâne.
SI : Je vous confirme qu’il y avait bien de la lumière, seulement celle de la grosse lampe Empire, mais elle est suffisante pour éclairer la salle, je ne suis pas allée voir dans les autres pièces. La télévision ne marchait pas, ni la radio, rien… Il n’y avait aucun bruit.
SI : Monsieur Deville portait des pantoufles, il donnait l’impression de quelqu’un qui venait de se servir un verre et qui passait tranquillement la soirée chez lui, il n’était pas occupé à autre chose… Oui, c’est exactement ça, j’ai pensé qu’il était comme quelqu’un qui recevait de la visite, mais un visiteur pour lequel il n’aurait pas fait d’effort de présentation. Quelqu’un qu’il connaissait. Seulement je n’ai pas vu d’autre verre sur la table.
SI : Je suis sortie pour courir chez les voisins et pour donner l’alerte… J’ai attendu chez eux que vous arriviez. »
Chapitre 1
Quatre ans plus tard…
Une pluie lourde tirait un rideau que le vent d’est chassait à l’horizontale, ramenant des odeurs de varech depuis les roches côtières de Port-Kennet. De l’autre côté du môle, l’océan déchaîné se soulevait en lames tumultueuses, hachées par les courants, la mer désordonnée crachait des déferlantes blanchâtres. Un véritable temps de chien. Les mouettes, déboussolées par l’orage, lâchaient au-dessus de cette bave des cris stridents, mêlés au fracas des rouleaux martelant le brise-lames. On ne voyait personne. Les quais de Piriac-sur-Mer étaient déserts, dessinés par les lucioles pâles, accrochées au hasard, dans l’obscurité naissante. Une sirène braillait quelque part, sur un ton lugubre.
Solitaire dans un coin de mur, près des bassins, une silhouette noire encaissait les rafales chargées de franges d’écume. Tassée et immobile. Les bateaux, dans le Virée, cognaient de la proue contre les pontons et l’homme semblait observer, au-delà de la cale, plus à l’ouest, deux chalutiers de La Turballe faisant route pour se mettre à l’abri. Un chat maigre, le poil rendu poisseux par le bouillonnement salé, se faufila entre les échasses de la grue avant de traverser la route, la tête alourdie par la mélasse. Il marchait à l’aveugle et n’eut pas un regard en direction de la silhouette pétrifiée dans son trou d’ombre. Il ne la voyait pas, le jour déclinait rapidement, effacé par le crêpe du ciel plombé par des nuages couleur d’ardoise.
La sirène invisible expira dans une lamentation ultime, plongeant le port dans une sorte d’attente angoissée. Les mouettes semblaient perdues, filant en désordre au-dessus du bouillon, à la vitesse de chauves-souris, jusqu’à ce qu’une autre alarme leur répondît tout près, du côté du quai de Verdun, dans une espèce de râle d’agonie qui mugissait comme l’appel d’un vieux klaxon étouffé par une quinte. L’expectoration d’un mourant dans les lamentations du vent balayant les embruns…
Toujours dissimulé dans son renfoncement, appuyé contre la muraille qui le protégeait mal, face aux pontons, les mains aux poches, le commissaire Nazer Baron ne bougeait pas la tête, conservant son regard maussade immergé dans cet univers d’eau. Les gémissements du port ne pouvaient pas l’atteindre. Ceux qu’il attendait là ne viendraient pas des terres.
Le tourbillon claquait le quai à toute volée, soulevant les vagues lancées à l’assaut de la digue avec un bruissement salin.
Baron ne parlait pas, ne souriait pas. Il n’avait pas remué depuis plusieurs minutes, il fixait l’horizon assombri sans s’attarder vraiment sur ce qu’il voyait, à la manière d’un homme qui ne peut rien changer aux événements et dont l’esprit s’est évadé ailleurs, bien au-delà des limites du réel et des éléments perceptibles. À la manière d’un personnage isolé dans ses réflexions, à l’abri du temps et des autres…
Il eût pourtant été bien incapable de dire à quoi il pensait réellement, il ne percevait que des reflets s’éloignant pour se perdre au fond de l’eau, il se contentait d’effleurer des idées qu’il ne développait pas, sautant de l’une à l’autre, en repoussant certaines qui ne lui plaisaient pas, en adoptant d’autres qu’il sauvegardait précieusement pour plus tard, pour ce soir ou pour demain lorsqu’il aurait le temps, ou lorsqu’il aurait moins froid, ou lorsqu’il ne pleuvrait plus…
Lorsque viendrait le moment de résoudre le mystère…
Un réverbère clignota dans la brume. C’était l’heure boudeuse où les lumières s’allument sans attendre la tombée de la nuit. L’air charriait de vagues odeurs de poisson.
… Le mystère de la malle du quai des Antilles…
Baron pinçait les lèvres avec une amertume mêlée d’impatience. Il contemplait la mer. Une vague éclata dans un panache d’écume, derrière le môle. Puis une seconde, une troisième… L’énigme du meurtre de Boris Frilac…
Le beuglement braillard du même klaxon, du côté de l’Hôtel de Ville cette fois, lui fit soudain reprendre pied avec l’environnement. Il se décida à pencher la tête de côté et constata qu’il ne distinguait plus qu’à peine les lumières de l’Hôtel du Port et les contours du bâtiment de granit de la capitainerie, au-dessus de lui. Le déluge brouillait les perspectives et effaçait les bordures, il ferait bientôt complètement nuit si le temps ne changeait pas. Autant dire qu’ils ne verraient plus rien.
Il recula en refrénant son agacement et chercha à se fondre dans les pierres d’angle qui ne le protégeaient pas vraiment, le dos collé à la porte de hangar contre laquelle il s’appuyait. Il tira sur le rebord de son chapeau pour le rabattre davantage sur son front et fouilla à l’aveugle dans ses poches, à la recherche d’un vieux paquet de cigarettes entamé depuis des semaines.
La malle du quai des Antilles… L’affaire Boris Frilac… Le premier innocent… C’était ce qu’ils avaient pensé tous, le premier signifiait qu’il en viendrait d’autres, un autre au moins… On venait de le découvrir, sur le versant opposé de ce bras de mer en furie, sur les huit hectares d’un îlot que les hommes avaient abandonné…
Baron commençait réellement à s’irriter. Il attendait là depuis bientôt une demi-heure, et ce n’était probablement la faute de personne, l’orage n’avait pas prévenu qu’il s’inviterait. Il avait traîné un moment à l’abri dans sa voiture, il ne pleuvait pas encore vraiment lorsqu’il était arrivé, l’océan se bâchait d’une brume impalpable, le ciel conservait des zébrures de lumière entre ses rouleaux gris, ce n’était que le linceul d’une bruine un peu collante qui sentait l’iode et le brai, avec des relents de salaisons venus d’on ne savait où, pas une vraie pluie.
« Attendez-nous au port, lui avait-on demandé. Le légiste est prévenu, il sera là… Le ponton E, en face de la capitainerie… »
Le légiste n’était pas encore là et à lui non plus, ce n’était probablement pas de sa faute. Baron avait patienté, le visage morne et les yeux luisants concentrés sur les arabesques ruisselant sur le pare-brise. L’affaire de la malle du quai des Antilles…
Le grain s’était mis à tomber avec une violence imprévue alors qu’il effectuait quelques pas pour se dégourdir les jambes. Il s’était réfugié à l’abri illusoire de ce décrochement dans le mur et depuis, il observait la couche d’eau ridée inondant le parking, il entendait la mer gronder et les navires grincer sur leurs amarres, bousculés par les rafales d’un vent agressif.
L’obscurité laminait les contours, les eaux de la baie finissaient par se confondre avec le ciel dans une même grisaille de plomb, on ne distinguait plus qu’à peine le trait plus sombre de la presqu’île de Rhuys dans le lointain, vers le nord. Une heure encore sous ce temps-là, et le déplacement s’avérerait inutile.
Baron alluma une Benson en préservant la flamme de son briquet entre ses mains placées en conque, et avala une bouffée qu’il souffla en direction du môle. Les bourrasques rabattaient une giboulée hostile sur sa joue, il fuma lentement en protégeant sa cigarette au creux de sa paume, le regard mobile voyageant le long des bâtiments du quai, là où brillaient les lumières alors qu’il n’était pas encore seize heures. Le clocher arrondi de l’église Saint-Pierre-es-Liens découpait une ogive bleuâtre dans la vapeur d’eau, les trottoirs étaient totalement déserts, noircis par les ondées. La vedette se faisait attendre.
Baron jeta son mégot d’une pichenette sur les dalles trempées et remonta le col de son manteau, avant de tirer une nouvelle fois sur le bord baissé de son chapeau. De toute manière, il n’était pas question d’embarquer sans Alex Foriot, et le légiste se faisait désirer.
Des phares venaient de percer la brume au rond-point de la rue du Grain, longeant le quai en direction de l’abri où Baron, dans la pénombre de plus en plus épaisse, finissait par se confondre définitivement avec la pierre. Il identifia la voiture, une antique Mercedes modèle 1990 qui crachait noir parce qu’elle ne devait pas aimer l’humidité, ce qui n’était pas une raison suffisante pour convaincre le médecin d’en changer.
La vieille berline allemande fit demi-tour devant les plots interdisant le secteur réservé aux usagers du port, et repartit à vitesse lente, faisant briller la pellicule mouillée dans le projecteur de ses lanternes, avant d’opter pour un emplacement parallèle à celui qu’occupait la voiture de Baron. Foriot avait pourtant le choix, tout le reste de l’esplanade était vide. La Mercedes s’engagea dans l’espace, nez pointé vers la mer, et marqua son arrêt de ses feux rouges étincelants, qui s’éteignirent brusquement.
L’obscurité parut s’épaissir. La sirène ne gueulait plus, il restait le bruit des vagues, tout près, et celui de l’eau débordant des gouttières, rythmés par les cris farceurs des goélands et des mouettes.
Foriot ne bougea pas tout de suite, Baron non plus. Les rafales de vent chargées de pluie le giflaient plus mollement, il lui semblait que l’averse tombait un peu moins drue depuis un instant et que l’horizon, au-delà des limites du port, se faisait plus clair. Le ciel balayait ses nuages à la pointe de Merquel, il ne ferait peut-être pas nuit tout de suite…
Le téléphone se mit à vibrer dans sa poche.
— Commissaire ? s’inquiéta Foriot dès qu’il eut décroché. Où êtes-vous ?
— Derrière vous, le rassura Baron, à l’instant où son regard accrochait les lumières d’une vedette franchissant le môle. Vous êtes à l’heure, je crois que notre taxi arrive…
Le canot de la gendarmerie maritime glissait entre les grappes de bateaux de plaisance à l’amarre, jusqu’à atteindre le ponton E dont il se rapprocha. Baron le suivit des yeux sans quitter son abri, attendant la fin de la manœuvre avant de se décider à décoller du mur et traverser le parking, pour rejoindre le légiste qui posait le pied sur les dalles trempées, après avoir enfilé des bottes de caoutchouc.
— Je craignais de vous avoir raté… articula-t-il en redressant sa petite taille.
Il tapa ses talons contre le sol pour ajuster ses protections.
— J’ai pris le temps d’aller les chercher. La météo n’annonce une amélioration qu’en fin de journée…
Foriot était un vieux bonhomme au sang froid. Il avait aussi pris le temps de s’équiper, les épaules couvertes d’une épaisse pelisse et le crâne déplumé, protégé d’une sorte de chapeau rond et mou, dont les rebords lui tombaient sur des yeux charbonneux.
C’était un toubib d’autrefois, bourru et atteint d’une surdité qui l’obligeait à tenir constamment la tête de côté pour mieux saisir ce qu’on lui disait, de sorte qu’il conservait un air penché qui lui donnait l’allure d’un homme affecté de claudication. Un vieux bonhomme sans doute, à qui il était pourtant difficile de donner un âge.
Il tendait une main courte aux doigts potelés, à l’image de toute sa silhouette. Avec ses joues rebondies et son nez souligné d’une moustache épaisse, il affichait l’air nostalgique d’un Antoine Bourrel égaré dans le monde déshumanisé de la médecine légale, une ressemblance qu’il devait cultiver avec son gilet rayé et son nœud papillon à pois.
— Vous avez le pied marin ? s’inquiéta-t-il.
— L’atavisme, Toubib… acquiesça Baron.
L’autre soulevait une vieille sacoche.
— Ouais… J’ai quand même prévu du Nausicalm !
Le vent ne désarmait pas, la traversée, même de trois ou quatre milles seulement, pouvait s’avérer agitée.
Il claqua la portière et se laissa entraîner sur les planches mouvantes du ponton, entre les enfilades de bateaux à l’amarre qui continuaient de cogner dans le bruissement incessant de la pluie. La vedette s’était mise à quai, une silhouette noire avait bondi sur l’embarcadère.
— Lieutenant Blanlœil, se présenta l’homme, haussant le ton pour dominer les mugissements des tourbillons dans les mâts et le claquement des drisses.
Il gardait les jambes écartées pour mieux assurer son maintien. Baron lui serra la main, ignorant les aiguilles qui lui cinglaient le visage depuis qu’il avait quitté l’abri de son mur. Il sauta à bord du canot avant de tendre le bras pour assister Foriot qui grimpait à son tour. Ils se réfugièrent dans la cabine, rejoints par l’officier. Le moteur monta aussitôt en régime, le ponton s’éloigna, ils franchirent la passe à allure lente et attaquèrent la houle, aussitôt bousculés par les vagues. Tout vacillait. Quelques kilomètres à franchir. Le lieutenant Blanlœil observait l’écume au sommet des rouleaux, son bras se tendit en direction du continent.
— Ça va se calmer ! assura-t-il avant de reporter son attention vers la proue.
Baron opina en silence, arrimé à l’une des poignées. Les gifles suintantes ne parvenaient pas à submerger totalement l’horizon, l’océan semblait reprendre des couleurs derrière les vitres lessivées par l’averse mélangée d’embruns. Un parc d’éoliennes commençait à pointer dans la brume, quelque part au nord-ouest. Ils n’en avaient que pour quelques minutes de traversée, de longues minutes pour le docteur Foriot s’il fallait en juger à sa mine chagrinée.
— Nous avons été obligés de bâcher la zone, enchaîna le gendarme plus calmement, expliquant sans doute son retard.
Le ciel s’éclaircissait du côté des rochers de Branbel.
— Il y a du monde sur l’île ?
— Elle est déserte !
— Inhabitée ?
— Totalement.
— Qui vous a prévenus ? s’inquiéta Baron.
— Une communication anonyme depuis le bureau de poste de Mesquer… Le type a raccroché avant qu’on ait eu le temps de lui poser des questions.
Les contreforts de l’île Dumet émergeaient de la vapeur grise flottant au ras de la mer. La vedette de la gendarmerie maritime amortissait les chocs en freinant sa vitesse. L’océan, lourd comme du plomb, crépitait de milliers de jets d’eau rebondissant à sa surface.
— On a pensé à un noyé, ajouta le lieutenant, même si rien n’avait été signalé.
Sa vareuse dégoulinait sur le plancher.
— À qui appartient l’île ?
— Au Conservatoire du littoral. Il n’existe aucune liaison régulière avec le continent, personne n’y met les pieds en dehors des plaisanciers pendant la période estivale.
Le canot plongeait du nez sous l’effet de la décélération, ils arrivaient ; les eaux tourmentées explosaient en gerbes d’écume autour des écueils. Blanlœil resta silencieux pour suivre les manœuvres d’approche visant une sorte de vieux quai pouvant servir à l’appontement.
— Hormis les goélands et les sternes…
Il suspendit ses mots pour désigner le barnum que Baron aperçut au pied d’une construction massive.
— …Le fort Carré ! Il est abandonné, enchaîna-t-il dès qu’il eut repris sa surveillance. L’île est totalement isolée, les derniers habitants l’ont quittée il y a près de trente ans.
— Donc pas de témoins ?
— Aucun…
— Votre mort, il a des papiers ?
— Edgar Murlon, cinquante-trois ans, chauffagiste à Châteaubriant…
Le lieutenant avait répondu par-dessus son épaule, il quittait la cabine pour s’emparer d’un bout qu’il lança à l’un des hommes à terre. Le bruit du moteur diminua d’intensité, la vedette avait maintenant le flanc collé à une masse rocheuse à fleur d’eau, à la pointe est de l’île. Deux Zodiac avaient été tirés sur le sable de la grande plage, au pied du fort Carré dont les murs épais, de type Vauban, dominaient encore les lieux malgré leur abandon.
Baron sauta sur les cailloux, ses bottes pataugeant dans les remous de la marée montante, et s’empressa de quitter la zone rocailleuse pour le talus herbeux cernant la grève en demi-lune, fouettée par le ressac. Puis il attendit l’arrivée d’Alex Foriot haletant dans l’orage, épaules rentrées sous l’effet conjugué du vent et du poids de sa vieille sacoche de cuir. Le légiste avançait courbé, transperçant les rafales de son crâne chapeauté, l’œil arrimé au sol spongieux.
Ils suivirent le lieutenant qui contournait un bouquet de sapins aux troncs couchés, littéralement épluchés par la force des vents ; ils avaient le souffle court et le visage en feu, griffé par les cristaux de sable tourbillonnant dans la mélasse. Le ciel, pourtant, continuait de se dégager au loin, la tempête s’éloignait, mais il faudrait du temps.
Le barnum avait été monté au pied de la butte, à proximité des vestiges du fort de Ré, le second ouvrage militaire érigé autrefois sur l’île et désormais en ruines. Des sapeurs-pompiers du centre de Piriac-sur-Mer achevaient de consolider la tente sous laquelle s’activaient les techniciens en investigation criminelle, ils arrimaient des cordes à des pieux fichés dans les buttes rases.
Le corps de la victime était étendu à l’abri, à plat dos sur le tapis d’herbe tassé par la pluie, les bras étirés le long du corps et les jambes parallèles. Le regard mort fixait l’envers du chapiteau. L’homme avait l’allure de quelqu’un qui avait été déposé là avec précaution, presque installé sur un carré de verdure, pas de quelqu’un qui s’était écroulé sous la violence d’un impact mortel. Edgar Murlon n’avait pas été tué ici.
Il était grand, presque aussi grand que Baron, mais il paraissait deux fois plus large. Sans doute sous l’effet de ses vêtements et de sa position allongée.
— À quelle heure, l’appel ?
— Un peu avant neuf heures, précisa Blanlœil. Personne n’y a fait attention, à la poste.
À cette heure-là, il faisait à peine jour. Le temps de retraverser le bras de mer, d’amarrer le bateau et de gagner Mesquer… Ce pouvait être dangereux de naviguer dans ces parages la nuit…
— Donc il est ici depuis hier, supposa Baron. Quelqu’un avait signalé sa disparition ?
— Sa femme. Elle a appelé la brigade de Châteaubriant dans la soirée, elle était inquiète de ne pas le voir arriver. Son téléphone ne répondait pas.
La compagne de Frilac avait fait la même chose.
— Le message était dans une poche de son pantalon, annonça Blanlœil, on ne l’a pas trouvé tout de suite.
Il chercha des yeux un scellé qu’il se baissa pour ramasser.
— Tenez…
*
On était resté sans nouvelles de Frilac pendant quatre jours. Il n’était pas rentré chez lui et il n’avait pas appelé pour prévenir, son téléphone ne répondait pas, Gaëlle Kerfaou avait fini par contacter la gendarmerie au petit matin, sans succès. Aucun accident n’avait été signalé qui impliquât un certain Boris Frilac. On lui avait conseillé d’attendre, l’homme était un technico-commercial, ce ne serait pas la première fois qu’un représentant se serait assoupi dans sa voiture après un dîner professionnel trop arrosé. Il allait réapparaître, honteux sans doute, il était trop tôt pour s’inquiéter…
Mais Frilac n’avait pas donné de nouvelles, ni à sa compagne ni à son employeur, il ratait ses rendez-vous, les clients appelaient… Sa voiture avait été signalée, c’était un contractuel qui l’avait repérée en stationnement irrégulier, verrouillée et vide. L’homme avait disparu sans laisser de traces, son portable était coupé, sa carte bancaire n’avait pas été utilisée.
On avait imaginé une fugue… Mais Gaëlle Kerfaou jurait que son couple vivait en harmonie, Boris n’avait pas de maîtresse, elle en était certaine, pas de double vie, pas de dettes, son travail marchait bien.
On avait décidé d’attendre… Jusqu’à ce que l’homme au petit chien, un retraité de la rue Magin qui avait l’habitude de se promener sur les quais du port de Nantes, ait eu l’attention attirée par une malle de voyage abandonnée dans un coin de hangar, une vieille malle aux panneaux délavés et aux renforts de cuivre ternis, un objet de brocante nécessitant une remise en état avant d’être cédé pour quelques dizaines d’euros…
C’était l’odeur qui avait intrigué l’homme au petit chien, l’odeur et le poids. La cantine n’était pas vide et elle sentait mauvais. Il avait essayé d’en soulever le couvercle et n’y était pas parvenu, la serrure était verrouillée. Et il y avait l’animal qui grondait en reniflant le sol, tirant sur sa laisse en cherchant à faire le tour de la caisse. Le retraité avait alerté, il avait fallu faire sauter les ferrures.
Le corps de Boris Frilac était à l’intérieur, recroquevillé en position fœtale pour pouvoir y être enfermé. En costume-cravate. Il ne lui manquait rien, ni sa montre ni son portefeuille, seul son téléphone portable avait disparu. La tablette dont il se servait lors de ses entretiens, avait été récupérée dans sa voiture, personne n’y avait touché. Il était mort depuis quatre jours d’une balle dans le cœur, tirée à bout portant. Un petit calibre : du 6.35.
C’était le légiste qui avait récupéré le message au fond de la poche arrière du pantalon. Un message anonyme :
« Le premier innocent »
Personne n’en comprenait la signification. Innocent de quoi ? On cherchait depuis, on fouillait la vie de Boris Frilac, on remontait dans le temps, sa jeunesse à Libourne, ses différents emplois, ses amis, ses loisirs, les femmes qu’il avait connues…
On savait qu’il fallait faire vite. « Le premier… » Le meurtrier avait prévenu, il en viendrait d’autres. Au moins un autre.
Chapitre 2
Baron avait tendu la main. Le message était un simple feuillet glissé dans son sachet de protection, un document anonyme sur lequel avaient été collées des lettres irrégulières découpées dans des journaux. La taille des caractères en était variable, l’impression également, la qualité du papier changeait…
Baron déplaça lentement son regard. Sur l’avertissement retrouvé dans la poche de Boris Frilac, le laboratoire était parvenu à identifier sept origines différentes. Jamais de mot complet, uniquement des lettres, grandes ou petites, fines ou grasses, dix-sept exactement, récupérées dans des quotidiens et des revues.
« Le second innocent »
Rien d’autre. Pas de signature et sûrement pas d’empreintes. Baron raccrocha le fil de ses souvenirs. Boris Frilac, l’homme de la malle du quai des Antilles, avait bien été le premier.
— C’est votre homme ? s’inquiéta Blanlœil.
Les textes étaient rigoureusement identiques, à un mot près… Ça signifiait quoi ? Qu’un troisième innocent suivrait, un quatrième… ? Baron en avait soudain froid dans le dos.
— Les mêmes mots, le même papier… jugea-t-il en parcourant la feuille des yeux, une dernière fois.
— Vous savez ce que ça veut dire ?
Il remua négativement la tête, faisant involontairement sauter quelques gouttes d’eau du bord de son chapeau.
— Pas pour l’instant, dit-il.
C’était au moins la centième fois qu’il lisait ces mots. Ça ne lui servait à rien. Les revues et les journaux dans lesquels avaient été découpés les caractères n’étaient pas des publications confidentielles, avec des listes d’abonnés qu’ils auraient pu éplucher.
Il observa le corps étalé dans l’herbe trempée en cherchant des connexions.
— Frilac avait trente-deux ans, dit-il avec un geste en direction de la dépouille allongée, il était agent commercial et vivait en concubinage à Saint-Père-en-Retz… Si j’en crois ce que je vois, on est loin du profil.
Foriot était penché au-dessus du chauffagiste, concentré sur sa tâche, il ne s’intéressait pas à ce qui se passait autour de lui. Il devait faire parler la mémoire d’un mort, faire dire à ses tissus, à ses os, à ses muscles, tout ce que la voix n’exprimerait plus jamais. Comprendre. Et pour cela, connaître. Alors, même si des bruits lui parvenaient, il ne les enregistrait pas et les interprétait encore moins, accaparé par la seule vision du corps qu’il examinait.
Murlon était en gabardine grise aux pans écartés sur un pull-over de laine bleue, dont l’ouverture en V laissait voir le col noir d’un t-shirt. En dessous, le quinquagénaire portait un pantalon de velours à grosses côtes et des souliers de sécurité. Edgar Murlon était en tenue de travail.
Boris Frilac aussi, songeait Baron au même instant, quand on l’avait découvert sur le quai des Antilles, dans le port de Nantes. Il était en costume-cravate, tassé dans le fond d’une vieille malle de voyage close, dont on n’avait pas retrouvé la clé.
Pour Edgar Murlon, le mode opératoire variait donc légèrement, son assassin avait cette fois prévenu d’un appel anonyme passé depuis le bureau de poste de Mesquer. Fallait-il en tirer une conclusion quelconque ? Il savait que le corps pouvait ne pas être découvert avant des semaines. L’île Dumet était une île déserte, il n’existait aucune liaison régulière avec le continent et elle n’était réellement fréquentée qu’en saison par des colonies de plaisanciers. Il fallait donc que le corps d’Edgar Murlon fût découvert sans tarder.
Quel était l’intérêt ? Pourquoi vouloir faire vite ? Parce que Murlon était le second et que devait ensuite mourir un troisième innocent ? C’était une obsession pour Baron.
Foriot continuait d’examiner le corps qu’il avait en partie dénudé, il ne cherchait qu’une confirmation. Il nota l’absence d’ecchymoses aux avant-bras. Murlon ne s’était pas défendu. Le t-shirt et le pull-over remontés laissaient voir des taches au niveau du ventre et de la poitrine, Foriot était certain qu’il en trouverait d’autres sur la face antérieure des cuisses. Après le décès, le sang avait reflué à son plus bas niveau, les vaisseaux sanguins s’étaient resserrés… Murlon avait été déplacé après sa mort.
Baron avait cessé de suivre les opérations pour sortir du barnum et restait planté sur la terre grasse, respirant à pleins poumons, le regard perdu vers le ciel plombé et la ligne d’horizon sur laquelle se découpaient de nouveau les rayures de la côte. Soufflant de l’est, le vent chassait les nuages crevés vers le large, il faisait froid, mais la perspective se dégageait au-dessus du continent, la pluie tombait moins drue.
Le lieutenant s’était approché, lui aussi fixait distraitement le panorama.
— Il a du sable collé à ses talons et au bas du pantalon, releva-t-il sans bouger la tête.
— J’ai vu…
Sa main, au bout d’un instant, désigna des marqueurs plantés dans le sol.
— Le corps a été traîné depuis la plage. On voit des traces, même si l’averse a pas mal brouillé le site. L’assassin n’a pas dû s’attarder, il a traversé le bras de mer uniquement pour déposer le corps de sa victime sur ce morceau de rocher, et il a détalé ensuite.
Baron approuva en silence. Il regardait autour de lui, piochant un parfum de solitude et presque d’abandon. C’était le scénario le plus probable. Quel prétexte aurait pu utiliser le meurtrier pour convaincre un chauffagiste d’accepter un rendez-vous sur une île inhabitée ? Mais ça signifiait quoi ?
— Pas dans le but de le cacher puisqu’il nous a alertés !
— Je sais… prononça Baron, c’est difficile à interpréter.
La mer était une plaque de bronze en fusion étalée sous ses yeux, elle n’était pas encore tout à fait calmée. Un horizon vide. Pas une voile. On ne distinguait plus le bruit de la pluie dans le remous des vagues. L’ensemble ne dessinait pas un paysage triste, juste mélancolique…
— Il peut en plus être parti de n’importe quel point de la côte, soliloquait Blanlœil, le regard aiguisé. Pas seulement du continent, mais aussi de Houat ou de Belle-Île…
Ses yeux faisaient le tour, détaillant la perspective offerte en direction de Pénestin et de Saint-Gildas-de-Rhuys, plus au nord. On ne voyait pas grand-chose, juste le trait sombre marquant la ligne de terre.
— Vous connaissez l’histoire de l’île ?
— Dumet ?
— C’est là que nous sommes, non ?
— Vous pensez que ça pourrait être lié à Dumet elle-même ?
— Je cherche… murmura Baron. Frilac a été retrouvé sur le port de Nantes, au fond d’une malle de voyage. Un port… des bateaux… une île…
Pourquoi serait-ce impossible ? Il y eut quelques secondes de silence sur la plage inondée par l’averse.
— Dumet est une île clandestine, Commissaire, articula Blanlœil avec le ton de l’homme qui lance une phrase polie pour ne pas décevoir son interlocuteur, tout y est camouflé.
Il paraissait dubitatif, le regard toujours noyé dans les courants qui frangeaient l’océan.
— On dit que c’était autrefois un lieu de culte celte…
Il regardait droit devant lui tout en réfléchissant. Il réfléchissait à fond.
— La légende veut que des grottes sous-marines la relient au continent, le Trou du Moine fou, le Sphinx… L’une d’elles serait le tombeau du roi Salomon enfoui ici avec toutes ses richesses.
— J’imaginais quelque chose de plus contemporain… énonça Baron.
À vrai dire, il ne savait pas très bien ce qu’il imaginait. La solution se trouvait peut-être là, tout près d’eux, simplement ils ne la voyaient pas… Il se passa la main sur les yeux, à la manière de quelqu’un qui veut éclaircir sa vision.
— Ces forts par exemple…
— Ils étaient censés servir à la défense de l’embouchure de la Vilaine, les militaires ont quitté les lieux depuis un siècle. Le fort Carré n’avait pas un intérêt stratégique ni des capacités importantes.
— Il n’a jamais servi ?
— Pour des combats, non. Pour autre chose peut-être…
— Vous pensez à quoi ?
— Juste une idée comme ça. Des travaux d’aménagement ont été conduits dans le fort, au milieu du dix-neuvième siècle, la nuit et dans le plus grand secret, on ignore toujours aujourd’hui quelle était la nature de ce chantier souterrain.
— La quête du trésor du roi Salomon… proposa Baron avec gravité.
— Alors celui qui l’a trouvé ne s’en est pas vanté…
Le lieutenant lâcha un soupir léger. Il observait la construction au-dessus de leurs têtes.
— Dumet a aussi été l’un des théâtres de la bataille des Cardinaux, l’une des plus grandes victoires de la Royal Navy. Onze navires coulés dans la baie, je crois… Les Français y auraient également dissimulé un magot de pièces d’or qui n’a jamais été découvert.
Baron le vit souffler en observant la dune. Il pleuvait depuis plus d’une heure, les ruines se découpaient sur le fond anthracite du ciel, et Blanlœil paraissait guetter quelque chose. Il écarta les bras. Tout ça, pour l’instant, ne conduisait à rien.
— Vous avez sûrement raison, reprit-il.
— À propos ?
— De Dumet. Le corps de Murlon n’a pas été transporté ici par hasard. Il existe un message en rapport avec l’île.
— Elle est déserte.
— Clandestine, Commissaire, c’est vraiment le mot qui me vient à l’esprit… La réponse est peut-être sous notre nez, quelque part dans l’Histoire. Vous avez entendu parler de l’Organisation Todt ?
Baron haussa des sourcils curieux avant de pivoter sur lui-même, contemplant à son tour la butte herbeuse au sommet de laquelle se dressait le fortin. Blanlœil examinait les remparts crénelés du fort Carré. Le bâtiment était à l’abandon.
— Celle du Mur de l’Atlantique ?
— Vous connaissez la base de Saint-Nazaire ?
— Un peu.1
— Vous avez remarqué qu’il n’y a pas un bunker sur l’île, pas même une casemate ? Pourtant, l’Organisation Todt n’était pas avare sur le béton, la Forteresse de Saint-Nazaire n’est qu’à quelques encablures d’ici, les sous-marins en escale naviguaient à proximité, et malgré ça, rien ! Les Allemands ont préservé l’endroit, ils en avaient même interdit l’approche par une ordonnance de 1944. Curieux, non ?
La pluie l’embarrassait, il tourna le dos aux rafales déboulant du continent.
— Dumet est une île mystérieuse.
— À qui appartenait-elle avant le Conservatoire ?
— À des particuliers. Juste après la guerre, l’île a été rachetée par un industriel qui y a fait des travaux, il invitait du monde à séjourner ici, Colette Renard par exemple ; elle y a passé plusieurs étés en famille.
— Qui étaient les derniers habitants ?
— Un couple, les Fleury de Valois, ils s’étaient installés dans la maison du garde, dans les vestiges du fort de Ré. Pas d’électricité, peu d’eau et le courrier tous les quinze jours quand le temps le permettait. Officiellement gardiens du phare. Mais lui était radiesthésiste, il cherchait un trésor d’une autre nature, « le rayon orange » qui devait lui procurer une sorte de longévité, elle était une ancienne chanteuse de music-hall.
— Ils sont morts ?
— Après avoir vécu trente-trois ans ici. On a fini par les évacuer par hélicoptère en 1986, ils sont décédés quelques années plus tard. Ils sont inhumés au cimetière de Batz-sur-Mer…
Le gendarme remuait la tête : il songeait à un événement hors de l’ordinaire mais le rejetait avec une sorte de résignation car il n’avait aucun rapport avec le sujet qui les préoccupait. C’était l’histoire du Grey Gannet, un navire abandonné par son équipage. On avait retrouvé des traces étranges sur le pont, et les mêmes avaient été repérées sur l’île, mais on n’avait jamais su de quoi il s’agissait, ni ce qu’étaient devenus les marins, ni ce qui avait motivé l’abandon du bateau.