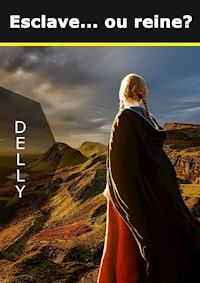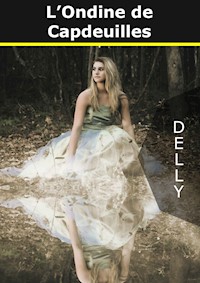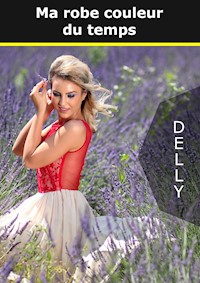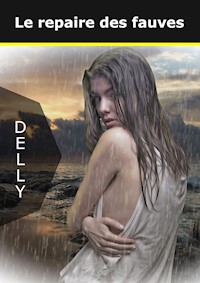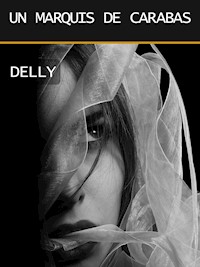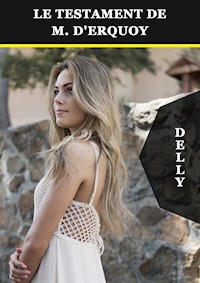2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Il m'est pénible de vous le dire, monsieur Devennes, mais ma fille Paule a décidé de reprendre sa parole. Elle s'est trompée sur la nature du sentiment que vous lui inspiriez». Ainsi Raymond Devennes, jeune avocat, apprend-il la rupture de ses fiancailles. A sa douleur s'ajoute bientôt la certitude que Paule est malheureuse avec le mari qu'elle a choisi, Me Ferdinand Daubrey, incorrigible viveur. Ariane, soeur de ce dernier, a reçu une éducation sans idéal et une connaissance trop précoce de la vie. Sera-t-elle la consolatrice de Raymond ? Avocate, penchée chaque jour sur les mi¬sères matérielles et morales d'autrui, elle peut acquérir une âme de clarté. De ces âmes qui attirent les faiblesses pour les relever, qui communiquent aux autres cette chaleur de la «lampe ardente» qui est en nous.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
La lampe ardente
Pages de titrePremière partieIIIIIIIVVDeuxième partieI - 1II - 1III - 1IV - 1V - 1VIVIIVIIIIXXPage de copyrightDelly
La lampe ardente
Delly est le nom de plume conjoint d’un frère et d’une sœur, Jeanne-Marie Petitjean de La Rosière, née à Avignon en 1875, et Frédéric Petitjean de La Rosière, né à Vannes en 1876, auteurs de romans d’amour populaires.
Les romans de Delly, peu connus des lecteurs actuels et ignorés par le monde universitaire, furent extrêmement populaires entre 1910 et 1950, et comptèrent parmi les plus grands succès de l’édition mondiale à cette époque.
Première partie
I
En quelques traits rapides, Raymond acheva le dessin commencé, puis il leva les yeux et regarda longuement la vue qu’il venait de reproduire.
Il se trouvait sur une terrasse rocheuse, entourée de pins et de bouleaux. Le regard plongeait dans la gorge au fond de laquelle bouillonnait, invisible, la torrentueuse petite rivière ; en face, il rencontrait un roc énorme, couleur de fumée, strié de roux, dressé entre les sapins et les hêtres couvrant tout ce qui n’était pas la roche nue.
À la fin de ce gris après-midi, un peu de lumière paraissait, diffusée par le soleil abaissé à l’horizon derrière un long nuage couleur de perle. Cette clarté légère touchait timidement le sommet du grand roc, caressait les arbustes qui se penchaient vers la fraîcheur humide de la rivière, sur le versant de la gorge où se voyait la petite terrasse aux balustres de sapin rouge fleuris de roses géraniums à longues traînes.
Dans cette solitude, le silence n’était troublé que par le bouillonnement du torrent. Mais bientôt, Raymond perçut un bruit de pas. En se détournant, il vit une jeune fille s’avancer dans l’allée de pins qui montait jusqu’à la terrasse. L’ombre environnante faisait paraître plus claire la fine silhouette vêtue d’une robe légère couleur de lavande, le teint délicat, les cheveux blonds. Les petits souliers de daim gris semblaient frôler le sol couvert d’aiguilles de pins.
Raymond sourit, en demandant :
– Tu viens me chercher, Paule ?
– Mais non, mon ami. Six heures sonnent seulement. Je suis à la recherche d’Ariane, qui doit se promener de ce côté.
– Je ne l’ai pas vue, cependant.
– Elle viendra certainement ici. Attendons-la, veux-tu ?
– Mais oui. Pourvu que je sois rentré un peu avant le dîner pour mettre mon smoking, cela suffit.
Tandis qu’il parlait, la jeune fille montait les quelques marches rustiques menant à la terrasse. Raymond lui offrit sa main pour gravir la dernière. Elle s’appuya sur lui en le remerciant d’un sourire.
– Tu dessinais le Roc d’Enfer ?
– Oui. C’est l’heure favorable. L’ombre l’environne, mais les contours sont nets encore. Regarde. Est-ce réussi ?
– Très bien. Ton talent s’affirme, Raymond. Le barreau comptera parmi ses membres un véritable artiste.
Elle rit, et Raymond lui fit écho.
– ... À propos d’avocat, tu ne trouves pas que M. Daubrey est changé, depuis son succès ?
Raymond eut un léger mouvement d’épaules.
– Oui, il est peut-être plus poseur encore.
– Poseur ? Quelle idée !
Une intonation de contrariété passait dans la voix de Paule.
– ... Il est conscient de sa valeur, qui est grande. Tu dis cela à cause de son apparence un peu froide ? Mais tu le connais suffisamment pour te rendre compte qu’il peut être charmant.
– Pardonne-moi de ne point partager à son égard ton enthousiasme et celui de ta mère. Je ne fais aucune difficulté pour reconnaître sa valeur professionnelle. Mais, par ailleurs, nos idées, nos opinions sont trop divergentes pour que nous soyons sympathiques l’un à l’autre.
Paule fit quelques pas vers la balustrade. Comme elle sortait de l’ombre des pins, la douce lumière l’atteignait maintenant. Son teint avait la transparence d’une fragile porcelaine, à peine rosée. Bien qu’elle fût plutôt de taille élevée, toute sa personne, mince et souple, donnait l’impression d’une grâce légère. En un geste lent, elle posa sur le bois rugueux de la balustrade ses mains longues et blanches.
– Tu fais allusion à son manque de croyance, à ses idées politiques, à son éducation si peu semblable à la tienne ?
Elle parlait sans regarder Raymond. Ses yeux semblaient considérer le roc dressé devant elle, comme une gigantesque sentinelle gardant la gorge.
Raymond dit brièvement :
– C’est un peu pour cela, en effet.
Il s’avança et vint se placer près de Paule. Le lien de parenté entre eux se pouvait déceler, pour un observateur, par quelque similitude dans les traits. Mais celle-ci ne frappait pas en général quand on voyait l’une près de l’autre la physionomie de Paule, d’une délicatesse presque excessive, et celle de Raymond, si virile en dépit de sa finesse, avec ce regard ferme, parfois ardent, un peu dominateur, et qui savait pourtant s’adoucir, comme en ce moment où il s’attachait sur Paule appuyée des deux mains à la balustrade et penchant vers la gorge sombre cette taille dont la souple minceur évoquait l’idée d’une longue tige de grande fleur élégante.
– ... C’est un peu pour cela, mais aussi parce que nos natures diffèrent trop. Car j’ai de bons camarades et même un excellent ami qui, malheureusement, ne partagent pas mes croyances ; les idées politiques de certains sont à l’opposé des miennes, mais tout en les blâmant, je ne cesse de les estimer, car je les crois sincères. Or, je reproche précisément à Daubrey son manque absolu de convictions, quelles qu’elles soient, son amoralité foncière, dont j’ai eu des preuves, son mépris de toutes « les vieilles sornettes », comme je l’ai entendu qualifier ce que nous respectons, ce qui fait la force et l’honneur d’une race. Il est, dans toute la force du terme, un arriviste, capable, je le crains, de défendre les pires causes dès qu’il y trouve son avantage.
– Je crois que tu exagères ! Vraiment, je n’ai pas du tout cette impression. Maman non plus, d’ailleurs. Tu es parfois un peu trop absolu dans tes jugements, mon ami...
Elle levait les yeux et lui souriait, comme pour atténuer le reproche contenu dans ses paroles.
– ... Il faut être indulgent pour lui, qui n’a pas eu, comme toi, de bons guides pour l’orienter dès le début de sa vie.
Raymond mit sa main sur l’épaule qui plia légèrement, et dit avec douceur :
– Tu n’es qu’une enfant, Paule. Il est des choses que tu ne peux comprendre.
Elle prit un air froissé.
– Cela veut dire que je suis très sotte ?
Il se pencha, baisa les cheveux blonds et répéta du même ton doux, nuancé de grave tendresse :
– Tu n’es qu’une enfant, tu es charmante et je t’aime, ma Paule, ma fiancée.
Toute trace de contrariété disparut du joli visage. Paule inclina un peu la tête et offrit son front aux lèvres de Raymond. Il l’entoura de ses bras, en un geste de maître. Ne lui appartenait-elle pas depuis toujours, cette blonde cousine qu’il avait connue tout petit enfant et dont on disait déjà : « Elle sera la femme de Raymond. » Leurs pères étaient cousins germains, les deux familles avaient toujours vécu dans la plus affectueuse intimité. Tacitement, il était convenu depuis des années que Raymond épouserait Paule dès que sa situation au barreau se trouverait bien assise.
Il murmura :
– Dis, chérie, nous nous marierons à la fin de l’hiver ? On m’a confié plusieurs causes qui vont, je l’espère, me faire un nom que je serai fier de t’offrir. Jusqu’ici, je n’étais qu’un petit avocat peu connu dont les gains restaient assez maigres...
– Oh ! tu sais bien qu’il ne faut pas te préoccuper de cela ! J’ai ma dot, et maman nous comblera...
– Je ne veux pas devoir la fortune à ma femme, tu ne l’ignores pas.
– Oui, je sais que tu as une âme fière.
Elle le regardait avec tendresse. Ses yeux, d’un gris changeant, avaient la douceur d’une caresse, dans l’ombre des cils blonds lentement baissés.
Il demanda, de la même voix murmurante :
– Tu m’aimes ?
– Oui, je t’aime.
Ils se plaisaient ainsi à se redire ce qu’ils n’ignoraient pas, comme tous les amoureux. Paule se blottissait davantage entre les bras vigoureux, les bras protecteurs. La clarté du pâle couchant se répandait sur ses cheveux blonds sans y éveiller aucun reflet. Au-dessous d’eux, sur la pente, les feuillages baignaient dans cette lumière mourante.
Il y eut un frémissement de feuilles et un grand corps velu bondit d’un buisson au bas de la terrasse. Paule se redressa, se détourna et dit en souriant :
– Voilà Aby. Ariane ne doit pas être loin.
– Tu parlais tout à l’heure de changement, à propos de Daubrey. Celui de sa sœur est autrement frappant.
– Oui, surtout pour toi, qui ne l’avais pas vue depuis quelque temps. Elle est, sans conteste, tout à fait charmante.
– Tout à fait ! dit Raymond, en donnant une caresse au chien qui s’approchait de lui.
Un bruit de pas légers se faisait entendre, venant d’un raide petit sentier qui descendait au fond de la gorge par de nombreuses sinuosités. Paule dit gaiement :
– Cette Ariane est intrépide ! Elle a déjà exploré tous nos petits chemins.
Au bas de la terrasse, une jeune fille apparut, vêtue de gris, le visage rosé par l’air, par la marche dans les sentiers difficiles. En quelques bonds souples, elle fut sur la terrasse, près de Paule et de Raymond.
– Je venais encore voir ce fameux Roc d’Enfer. C’est à cette heure qu’il devient plus sombre ?
– Oui, voyez, mademoiselle.
Le grand roc gris, en effet, n’était plus que ténèbres. La lumière s’écartait du sommet. La gorge devenait un noir abîme d’où montait le grondement de l’eau bouillonnante.
Accoudée à la balustrade, Ariane penchait vers elle sa tête coiffée de cheveux légers. Le rayon de soleil prêt à disparaître semblait s’attarder complaisamment sur les boucles d’un brun clair et doré, sur le front mat si bien modelé. Quand la jeune fille se redressa, ses yeux couleur de violette parurent tout éclairés par cette pâle lumière.
– Ce lugubre roc mérite son nom. Tu m’avais dit, Paule, qu’il avait une légende ?
– Une légende qui n’est peut-être que la vérité. Autrefois, une jeune fille, désespérée, se jeta de là-haut dans la gorge, sous les yeux du fiancé qui l’avait abandonnée. Il se tenait ici même, prétend-on. Accablé de remords, il s’enfuit, erra longtemps et se réfugia dans un monastère où, après des années de dure expiation, il mourut dans de grandes souffrances, comme il l’avait demandé pour obtenir le salut de sa fiancée.
Un pli d’ironie parut aux lèvres d’Ariane, d’un rose vivant et frais.
– La pauvre fille ! Mourir par amour, quelle folie !
– Vous trouvez que cela n’en vaut pas la peine, mademoiselle ? dit Raymond.
Il considérait avec intérêt cette physionomie, dont le charme si prenant ne s’accordait pas avec le souvenir gardé par lui de la jeune étudiante très rieuse qui avait des mots jolis et mordants, s’habillait très mal et s’amusait elle-même de son allure dégingandée, de ses mouvements disgracieux, de ses traits mal formés.
– Quand je serai en robe et en toque au banc des avocats, on me confondra avec mes confrères masculins, avait-elle coutume de dire.
À cette époque, Raymond partageait cette opinion, surtout quand il voyait Ariane près de Paule, si fine, élégante, si féminine toujours. Mais maintenant, il lui fallait changer d’avis. Sans être d’une beauté régulière, Ariane avait beaucoup mieux : la grâce dans chacun de ses mouvements, une physionomie singulièrement vivante, expressive, un teint d’une belle matité qu’un jeune sang vif venait colorer souvent, et ces yeux qui semblaient contenir tout un monde de pensées, graves ou gaies tour à tour.
À la question de Raymond, Ariane eut un rire moqueur.
– Ah ! certes, non ! L’amour, c’est une chose qui ne m’intéresse pas.
– Tu dis cela, mais un jour...
Paule passait son bras sous celui de son amie. En même temps, elle glissait vers Raymond un regard qui disait : « Je sais, moi, combien cela est doux et désirable. »
Ariane rit de nouveau.
– Je ne pense pas qu’il me rende folle à ce point, tout au moins. En attendant, mon travail, ma profession, me suffisent. Eux, du moins, ne me feront pas souffrir – en tout cas, pas par le cœur. Or, je ne crains guère que cette souffrance-là.
Elle pencha un peu la tête pour regarder une dernière fois au fond de la gorge, et Raymond remarqua le joli ton doré que prenait sa chevelure sous le jeu de la lumière.
– ... Je crois qu’il est temps de rentrer. Il faut que je me recoiffe, après avoir passé dans ces délicieux petits sentiers où des branches s’accrochent sans façon aux cheveux.
– On ne s’en aperçoit pas, dit Paule. Tu n’es plus la fillette ébouriffée d’autrefois... Tu te souviens, Raymond ?
– Très bien, dit-il en souriant.
Un rire léger s’éleva. Une très jeune gaieté brillait dans les yeux d’Ariane.
– Et moi, j’ai gardé le souvenir d’un grand jeune homme correct qui me fit une observation sur ma toilette négligée. C’était sur la plage de Cabourg et j’avais douze ans. Je vous en ai voulu pendant huit jours, monsieur, puis j’ai oublié !
Un sourire entrouvrait ses lèvres, montait jusqu’à ses yeux, un fin sourire où se glissait un peu d’amusement, un peu d’ironie.
Raymond riposta gaiement :
– Vous avez fort bien fait. Je me mêlais là de ce qui ne me regardait point et vous êtes très bonne de ne pas m’en avoir gardé rancune.
Elle eut un léger mouvement d’épaules, un plissement de lèvres moqueur, qui signifiaient également : « C’est que cela ne me touchait guère, au fond. » Puis elle se pencha pour jeter un regard vers l’album que Raymond avait posé sur un banc.
– C’est de vous ? Je puis voir ?
Raymond le prit et le lui tendit. Elle le feuilleta longuement. Paule, près d’elle, se penchait pour regarder aussi. Elles formaient un groupe charmant dans le cadre sévère des pins. Appuyé contre la balustrade, le dos tourné au Roc d’Enfer, Raymond les regardait. Il songeait : « Quelle est la plus jolie des deux ? » Et son cœur amoureux répondait sans hésiter : « C’est Paule, ma Paule aux traits délicats, au teint de fleur à peine éclose. »
Ariane releva les yeux en disant :
– Mais vous avez un talent très intéressant, monsieur ! Il est presque dommage que vous n’ayez pas choisi la carrière artistique plutôt que le barreau... Je vous laisse maintenant, car il est vraiment temps d’aller m’habiller. Tu ne viens pas, Paule ?
– Non, puisque je suis prête, je resterai un instant encore. L’air est délicieux à respirer, après cette journée de chaleur orageuse. Mais Raymond rentre aussi ; il va t’accompagner.
Les deux jeunes gens, précédés d’Aby, s’engagèrent dans l’allée de pins qui descendait en pente douce. Ariane disait son plaisir de connaître ce coin de Périgord si pittoresque, et cette vieille maison, héritage de Paule, où plusieurs générations d’Évennes avaient passé. Rien n’était plus expressif que cette voix au timbre clair, et Raymond, en l’écoutant, se disait : « Avec cela et ses yeux, elle gagnera toutes ses plaidoiries. »
Au bas de l’allée s’étendait un parterre à la française qui précédait la maison, vaste bâtisse du XVIIe siècle dont la façade, vers le jardin, disparaissait presque sous les feuillages aux tons de cuivre. Debout près d’un if taillé en champignon, un homme de haute taille, de large carrure, la considérait attentivement. Au bruit des pas, il se détourna et vint au-devant d’Ariane et de Raymond.
– Tu es arrivée de ce matin et il a fallu déjà que tu fasses connaissance avec le parc, Ariane ? Sans doute, Évennes, avez-vous découvert ma sœur sur quelque sentier de chèvres ?
Il parlait d’un ton plaisant. Un sourire venait détendre sa face rasée, aux traits forts, et donnait un soudain éclat aux yeux d’un vert changeant.
– Mais pas du tout ! Nous nous sommes rencontrés sur la terrasse, en face du Roc d’Enfer.
– Ah ! ce fameux roc ! J’irai le voir demain.
Ariane dit avec une légère moue de dédain :
– Ce sont des choses qui ne t’intéressent pas.
Ferdinand Daubrey eut un rire bref, en rejetant en arrière une mèche de son épaisse chevelure brune.
– En effet, je ne suis pas, comme toi, enthousiaste des spectacles de la nature. Mais une belle vue me plaît assez quand même. Cela repose l’esprit... À quand le procès Valliers, Évennes ?
– Vers décembre ou janvier. J’ai maintenant en main toutes les pièces du dossier.
– Vous aurez là une belle plaidoirie. C’est une affaire passionnante ! Je vous l’envie, mon cher !
– Vous n’en manquez pas, cependant. On m’a dit que Vernouroux vous avait pris comme défenseur ?
– C’est exact. Eh ! il n’aurait pas eu l’idée de s’adresser à vous, celui-là ! Dans le monde de la haute canaillerie, on connaît déjà les opinions intransigeantes de Me Évennes.
Il souriait à demi. On pouvait à peine discerner dans son accent un léger sarcasme.
Raymond dit froidement :
– En effet, je méprise trop ces gens-là pour avoir l’idée de les défendre.
Ariane s’amusait à chatouiller son visage avec un dahlia pourpre qu’elle venait de cueillir. Son regard intéressé allait de la physionomie fine, expressive de Raymond, à celle de Ferdinand, plus rudement taillée, non dépourvue cependant d’une certaine beauté vigoureuse, mais si impénétrable derrière l’impassibilité des traits et le regard indéchiffrable sur lequel, souvent, se baissaient de longues paupières molles.
Aux derniers mots de Raymond, Ariane répliqua d’un ton mi-amusé, mi-railleur :
– C’est pourtant en défendant ces gens-là qu’on se met en vedette. Ces gros financiers, ces filous de haute marque, voilà ce qui fait la fortune d’un avocat, ce qui lui donne la notoriété. Or, n’est-ce pas là le but que vous vous êtes proposé en choisissant une carrière ?
– Ce ne doit être qu’un but secondaire, mademoiselle. Le principal est l’accomplissement de mon devoir chrétien et social, la mise en valeur de mes facultés pour le plus grand bien de mon prochain et ma propre amélioration morale. Après cela, il ne m’est pas défendu de rechercher un large profit matériel et la notoriété, pourvu que je reste dans les limites prescrites par ma conscience.
Daubrey eut un fugitif plissement de lèvres. Il murmura, avec une douce ironie :
– Amélioration morale... conscience... Ce sont de très beaux mots.
– Très beaux, dit Ariane, avec un rire léger.
Elle se pencha et glissa le dahlia dans le collier du chien.
– Allons nous habiller, Aby, ou bien nous serons en retard.
– À tout à l’heure, dit Daubrey, voyant que Raymond se dirigeait aussi vers la maison.
Au seuil de la porte vitrée qui ouvrait sur le vestibule, Ariane se détourna en levant sur le jeune homme un regard où se discernait une sorte de curiosité pensive.
– Vous croyez à ce que vous dites, monsieur ?
– Comment, si j’y crois ?
– Je dois vous paraître très impolie, en vous demandant cela. Mais je suis tellement sceptique ! Des mots, de beaux mots, comme dit Ferdinand, combien en entend-on ! Mais si rarement les actes s’accordent avec eux !
– Cela se produit peut-être plus souvent que vous ne le pensez, mademoiselle. Mais il est pénible de vous voir si dépourvue d’illusions, à votre âge.
Elle secoua la tête. Une ombre semblait couvrir l’éclat de son regard.
– C’est très raisonnable, en tout cas. Cependant, j’aimerais vous croire sincère, mais il me faudrait, pour cela, vous connaître mieux, – chose difficile, car une âme d’homme doit être quelque chose de si décevant !
– Que dirons-nous, alors, des âmes féminines ?
Elle éclata de rire.
– Ah ! oui, les âmes mystérieuses, la Joconde et le reste ! Non, nous ne renfermons pas tant d’énigme que cela, allez ! C’est l’homme qui nous pare de cet attrait supplémentaire – car quel attrait vaut celui du mystère, réel ou supposé ?
Elle entra dans le vestibule, dont le dallage en mosaïque résonna sous ses fins talons. Raymond, en s’avançant derrière elle, fut frappé de son allure décidée qui s’alliait harmonieusement à la grâce souple de la démarche et des mouvements. Rien ne rappelait plus l’adolescente dégingandée, ni même la jeune fille en voie de transformation qu’il avait rencontré une fois, l’année précédente, chez Paule.
Sur le palier du premier étage, Ariane se détourna et lui tendit la main.
– Vous ne me garderez pas rancune pour mon doute impoli ?
Dans la pénombre, ses yeux riaient. Raymond serra les doigts tièdes en répondant gaiement :
– Non, parce que j’aime la sincérité avant tout.
– Comme moi. Nous nous entendrons bien.
Elle disparut dans le corridor où se trouvait sa chambre, tandis que Raymond gagnait le second étage. Il songeait :
« Qu’est-ce que cette nature ? Paule la dit très bonne, très franche, d’une parfaite rectitude morale. Mais elle se laisse facilement circonvenir, ma chère Paule. En tout cas, ce doit être une nature intéressante et peu banale. Pauvre enfant, aura-t-elle la force de passer indemne entre les pièges qui la guettent, si jeune et charmante, sans appui moral, avec une âme vide de Dieu ? »
Puis, reportant sa pensée vers Ferdinand Daubrey, il se posa une fois de plus cette question :
« Pourquoi a-t-il accompagné sa sœur ici ? »
Car bien que sa mère, morte dix ans auparavant, eût été l’amie de Mme Berthe Évennes, bien qu’Ariane et Paule se connussent intimement depuis l’enfance, Ferdinand n’avait jamais eu que des rapports assez cérémonieux avec la mère et la fille. Ce milieu de bon ton n’avait rien qui pût plaire à un viveur tel que lui. Quant à Raymond, qui le voyait au Palais, il échangeait avec lui quelques mots, une poignée de main sans chaleur et c’était tout. Il existait d’ailleurs, entre eux, une différence d’âge de plusieurs années, et tandis que Daubrey comptait déjà parmi les noms importants du barreau, Raymond Évennes sortait seulement de l’ombre.
Comme celui-ci l’avait dit à sa cousine, les divergences entre eux étaient trop grandes pour qu’une sympathie les rapprochât l’un de l’autre. Il avait donc éprouvé une réelle contrariété en apprenant, l’avant-veille, qu’Ariane et son père, le président Daubrey, invités par Mme Berthe à passer le mois de septembre à sa propriété des Grands-Sapins, s’annonçaient pour le lendemain en compagnie de Ferdinand.
« Il a offert de nous conduire dans sa voiture en se rendant à Biarritz, ajoutait Ariane, et il sera heureux de cette occasion de vous saluer au passage. »
Naturellement, Mme Berthe l’avait engagé à demeurer quelques jours et il avait accepté, à la grande surprise de Raymond. Quel intérêt pouvait-il trouver à ce séjour, si court fût-il, dans cette demeure isolée, dépourvue, ainsi que ses alentours, des distractions qui lui étaient chères ?
« Après tout, il n’est peut-être pas fâché de se mettre un peu au vert avant de reprendre sa vie de plaisir à Biarritz », conclut Raymond.
Mais il appelait de ses vœux le moment où la voiture de son confrère franchirait la grille des Grands-Sapins pour prendre la route du pays basque. En outre, l’engouement de Mme Évennes pour le jeune avocat l’agaçait quelque peu. Cela datait d’une plaidoirie brillante, emportant un acquittement imprévu, qui avait mis fortement en vedette Me Daubrey. Mme Berthe aimait les gens à succès. Le jour de cette fameuse plaidoirie elle était là et avait amené sa fille. Du banc des avocats, Raymond voyait la jolie tête coiffée d’un petit chapeau de velours gris. Paule ne lui avait jamais paru plus fine, plus délicatement élégante que sous ces voûtes austères, au milieu de l’assistance mêlée qui s’entassait pour ce sensationnel procès. Mais il lui déplaisait qu’elle fût là, précisément à cause de cette assistance. Car l’affaire par elle-même ne comportait pas de dessous scandaleux et Mme Évennes en avait profité pour faire entendre à Paule la parole de Daubrey.
Quand Raymond descendit de sa chambre, il trouva Mme Berthe occupée à chanter un duo avec Ferdinand. Elle avait encore une belle voix et la basse de Daubrey ne manquait pas d’agrément. Le président, enfoncé dans un fauteuil moelleux, écoutait en se tournant les pouces. En même temps que Raymond, par une autre porte, entraient Ariane et Paule. Cette dernière s’extasia sur la voix de Ferdinand, à qui Mme Évennes fit aussi force compliments. Il les recevait avec cette assurance d’homme satisfait de lui-même qui impatientait secrètement Raymond.
« Comment peuvent-elles avoir quelque sympathie pour ce personnage ? » songeait-il.
Pendant le dîner, il parla peu, occupé surtout à étudier les nouveaux hôtes des Grands-Sapins. Le Président, peu loquace et dyspeptique, buvait de l’eau et mangeait à peine. Son visage maigre, encadré de favoris grisonnants, gardait à demeure une expression aimable et approbative. Il était de notoriété, au Palais, que le président Daubrey n’avait pas été comblé des dons de l’intelligence, mais qu’on ne pouvait trouver d’homme plus accommodant, toujours de l’avis de chacun et de tous et répandant libéralement l’eau bénite de cour. On disait encore que de hautes protections l’avaient, seules, fait parvenir aux fonctions qu’il occupait de façon assez banale, sans que son mérite eût aucune part à une si brillante carrière. De tout cela, M. Daubrey s’inquiétait peu. Il continuait de présider les audiences avec la même indifférence aimable et de soigner son estomac, qui l’inquiétait. Pour sa femme, nature sensible et tempérament maladif, il avait été un de ces doux despotes dont l’égoïsme suffit à empoisonner une existence. Quant à ses enfants, il leur laissait depuis longtemps liberté absolue et disait agréablement à ses amis : « J’en ai fait des consciences libérées. Rien ne les gênera dans la vie, ces deux petits-là ! »
Le système donnait déjà ses fruits en Ferdinand. Quant à Ariane...
Ariane, c’était encore le mystère. Raymond la regardait, assise près de lui, causant et riant. Le rose pâle de sa voix semblait rendre plus douce encore sa peau mate. Quand elle s’animait, ses yeux prenaient un éclat qui éblouissait. Elle montrait une gaieté franche et très jeune. Raymond songeait :
« Elle doit être encore honnête et droite. Mais que deviendra-t-elle, abandonnée à sa seule raison ? Pauvre enfant ! »
En face de lui, Ferdinand Daubrey étalait sa large carrure. Il posait, comme l’avait dit tout à l’heure Raymond à sa cousine. Se sachant très écouté, il parlait beaucoup, avec agrément d’ailleurs. Au contraire de sa sœur dont tous les traits n’étaient qu’expression, les siens restaient impassibles. L’ensemble de sa physionomie eût paru très froid sans quelques lueurs vives, parfois aiguës, d’autres fois caressantes, traversant le regard intelligent auquel le jeu habile des paupières donnait un attrait d’énigme.
Mme Berthe écoutait son hôte avec un visible plaisir. Paule aussi, d’ailleurs. Elle souriait aux propos spirituels du jeune avocat, sourire assez banal, du reste, ne différant guère de ceux qu’elle adressait à d’autres hôtes. Mais Raymond – il ne s’expliqua pas pourquoi – en ressentit une impatience qui confinait à l’irritation.
II
La lumière qui se mourait, enveloppait les vieux murs roussis de la chapelle des Saints et avivait la pourpre des digitales dressées dans les crevasses, si nombreuses que l’antique sanctuaire paraissait destiné à crouler dans un temps peu éloigné. L’ombre semblait plus profonde, en revanche, sous le porche ogival vers lequel penchaient les branches d’un orme séculaire. La façade étroite, ornée de sculptures naïves, s’éclairait de lueurs mouvantes chaque fois qu’un léger coup de brise déplaçait le feuillage à peine jauni encore.