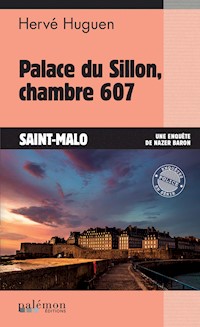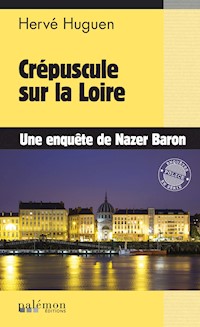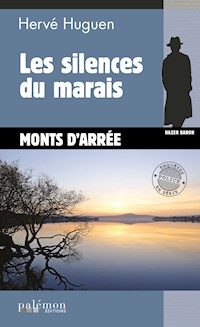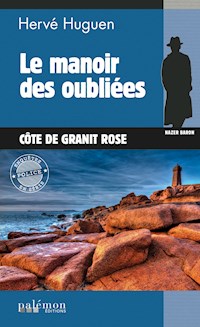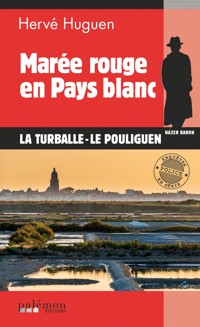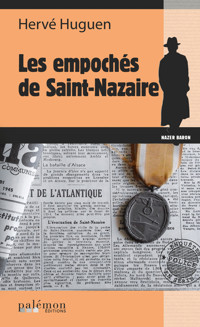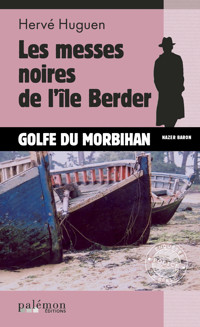Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Palémon
- Kategorie: Krimi
- Serie: Les enquêtes du commissaire Baron
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Des corps sans vie sont retrouvés, à 23 ans d'écart, le long du canal de Nantes...
1988. En six mois, trois jeunes femmes mystérieusement disparues furent retrouvées le long des berges du canal de Nantes à Brest, victimes d’un tueur maniaque qui ne sera jamais identifié. Vingt-trois ans plus tard, un corps sans vie est abandonné sur les mêmes rives, le long du seuil de partage de Bout-de-Bois. Puis c’est au tour d’une cinquième femme d’être découverte à proximité de l’écluse de la Prée. Toutes deux présentent exactement les mêmes caractéristiques physiques que les disparues de 1988.
Persuadé que le Prédateur du canal s’est réveillé, le commissaire Nazer Baron exhume les vieux dossiers. L’enquête le mène à un suspect entendu naguère comme simple témoin, dénoncé par sa propre épouse, mais qui nie avec toute l’énergie de l’innocence. Pourquoi aurait-il tué ces malheureuses ? Pourquoi recommencer après vingt-trois années d’oubli ? De Nantes à la forêt du Gâvre, Nazer Baron suit la piste comme on longe les méandres d’un cours d’eau. Au gré de ses intuitions. Au gré des impasses et des rebondissements. Seul face à un assassin qui semble avoir tout prévu.
Découvrez sans plus attendre cette nouvelle enquête du commissaire Baron qui se retrouve, seul, face à un assassin prêt à tout !
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Bien construit, bien écrit, un roman d'atmosphère comme l'affectionnent les lecteurs de Georges Simenon. - Louis Gildas, Télégramme
EXTRAIT
Elle marcha en titubant jusqu’à la salle de bains attenante et se glissa sous la douche, laissant le jet la laver longuement de toutes ces scories qui la salissaient. Au moins elle n’entendait plus les gémissements du vent. Ni la chouette. Ni le craquement des poutres dans le grenier au-dessus de sa tête.
Elle coupa l’arrivée d’eau. Silence. La nature lui accordait quelques instants de répit. Elle se sécha à l’aide d’une serviette rêche dont elle se servit pour frotter rageusement chaque partie de son corps. Se débarrasser des déchets. Gommer l’atroce soupçon.
Elle était rouge de la tête aux pieds lorsqu’elle repassa dans sa chambre, mais elle se sentait mieux. Ses pas la guidèrent vers la commode dont elle amena à elle l’un des tiroirs rempli de boîtes de différents formats, des coffrets à bijoux qu’elle dégagea pour extraire du fond du logement un écrin frappé en lettres dorées des coordonnées d’une joaillerie parisienne. Elle souleva le couvercle avec toujours ce même frémissement incontrôlable. Une boucle d’oreille. Unique. Même pas jolie. Une fausse pierre un peu grossière, trop épaisse, sertie de plaqué. Vulgaire.
Marlène avait du mal à détacher son regard. Une émeraude de pacotille à laquelle elle n’aurait sans doute pas prêté vraiment attention lorsqu’elle l’avait découverte. Une babiole perdue, peut-être même jetée, ou tombée d’une poche, quelle importance ? Elle ne se serait même pas interrogée sur l’endroit où elle l’avait trouvée. Un bijou en toc ! Elle n’était pas jalouse. Elle aurait oublié. Sauf qu’elle l’avait déjà vue. Ailleurs !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Le nantais Hervé Huguen est avocat de profession, mais il consacre aujourd’hui son temps à l’écriture de romans policiers et de romans noirs. Son expérience et son intérêt pour les faits divers - ces évènements étonnants, tragiques ou extraordinaires qui bouleversent des vies - lui apportent une solide connaissance des affaires criminelles. Passionné de polar, il a publié son premier roman en 2009 et créé le personnage du commissaire Nazer Baron, un enquêteur que l’on dit volontiers rêveur, qui aime alimenter sa réflexion par l’écoute nocturne du répertoire des grands bluesmen (l’auteur est lui-même musicien), et qui se méfie beaucoup des apparences…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HERVÉ HUGUEN
Le canal
des Innocentes
DU MÊME AUTEUR
1. Dernier concert à Vannes
2. Les messes noires de l’île Berder
3. Ouragan sur Damgan
4. Le canal des Innocentes
5. Retour de flammes à Couëron
6. Les empochés de Saint-Nazaire
7. L’inconnue de Nantes
8. Le cimetière perdu
9. Silence fatal
Retrouvez ces ouvrages surwww.palemon.fr
Dépôt légal 1ertrimestre 2016
ISBN : 978-2-372601-21-4
CE LIVRE EST UN ROMAN.
Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres,
des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant
ouayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle de la présente publication, faite par quelque procédé que ce soit (reprographie, microfilmage, scannérisation, numérisation…) sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’autorisation d’effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du Centre Français d’Exploitation du droit de Copie (CFC) - 20, rue des Grands Augustins - 75 006 PARIS - Tél. 01 44 07 47 70/Fax : 01 46 34 67 19 - © 2016 - Éditions du Palémon.
Chapitre 1
Il regarda le cadran lumineux de sa montre-bracelet. Vingt et une heures quarante-cinq. Cela faisait une demi-heure qu’il s’était rangé sous les larges branches du hêtre pour se mettre en observation, toutes lumières éteintes. Tout était tranquille. De gros nuages boursouflés couraient dans le ciel d’encre, filant vers l’ouest et charriant avec eux les rafales aigres d’un vent acide. Quelques minutes plus tôt, un avion gros-porteur d’Airbus avait crevé la couche charbonneuse et l’homme avait suivi des yeux la descente rapide des clignotants colorés en direction de l’aéroport de Nantes-Atlantique.
Puis tout était redevenu calme. De l’autre côté de la route, la façade isolée du Stuart Pub jetait au travers de ses vitraux deux grands carrés de lumière qui venaient s’étaler sur la chaussée. Une demi-douzaine de voitures étaient garées sur l’esplanade de terre, à gauche du bâtiment. On devinait des silhouettes qui s’agitaient derrière les carreaux irisés. La voie était à l’écart du village, plus aucun véhicule n’était passé depuis cinq bonnes minutes.
L’homme sembla se décider et posa un pied à terre après avoir coupé l’alimentation du plafonnier. Vingt et une heures cinquante-cinq. Il avait promis d’être là avant vingt-deux heures, elle n’allait pas tarder à s’impatienter. Il repoussa doucement la portière avant de s’éloigner et s’assura avec vigilance que tout était bien désert autour de lui. Il faisait vraiment froid, le vent mordant bousculait des feuilles mortes entassées dans l’ornière creusée le long du terre-plein.
D’un pas volontairement lent, l’homme traversa la chaussée vide en remontant soigneusement le col de son manteau, un épais vêtement de laine de couleur passe-partout qu’on ne remarquerait pas, et poussa la porte du Stuart en prenant le temps de refermer ensuite avec soin derrière lui.
Il enregistra tout d’un regard circulaire, la salle en longueur, l’éclairage tamisé qui brouillait les contours, la musique dans laquelle se noyaient les conversations, la dizaine de consommateurs accoudés au zinc ou groupés autour des tables. Certains tournèrent la tête avec indifférence. Personne ne le salua.
Il capta sa présence. Elle était là, installée à proximité de l’entrée, à l’un des premiers guéridons, et il apprécia d’être dispensé de traverser l’espace au milieu des clients qui n’auraient pas manqué de le dévisager. Elle était la seule non accompagnée, elle patientait devant un demi, une Kilkenny à la robe presque rouge, et il devina qu’elle avait fait des efforts de toilette pour ce rendez-vous. Elle était maquillée, davantage que pour leurs premières rencontres, mieux coiffée aussi, son vêtement ouvert laissait entrevoir un gilet couleur vert pomme, décolleté en pointe. La table interdisait à l’homme de découvrir ce qu’elle portait en dessous, une jupe manifestement, il voyait les bottes de cuir enserrant ses mollets.
Un éclair de satisfaction lui traversa les yeux. C’était exactement ça. Exactement ça !
Il marcha vers elle, répondant par un sourire au soulagement qu’elle affichait. Elle avait dû craindre d’attendre encore longtemps, peut-être même redouter de se faire poser un lapin.
— J’ai fait au plus vite, mentit-il.
Il ne lui dit pas qu’il était là bien avant elle, dissimulé dans l’ombre noire du hêtre, et qu’il l’avait vue arriver au volant de sa petite Twingo vingt minutes avant l’heure de leur rendez-vous. Bon signe. Elle était impatiente.
Il accepta les deux baisers mouillés qu’elle posa maladroitement sur ses joues et prit place en face d’elle. Le murmure des conversations ne s’était pas interrompu. Personne n’avait fait vraiment attention à lui. Il vérifia tout de même d’un coup d’œil qu’ils n’étaient pas observés. Le patron était seul à servir. En épaisse chemise de cow-boy aux manches relevées, il faisait distraitement rouler des dés sur un plateau de 421.
— Pas trop fatigué ?
Il revint à elle. Il lui avait raconté qu’il était commercial dans un gros consortium industriel allemand, spécialisé dans la construction mécanique, les turbines électriques et les éoliennes, qu’il avait un rendez-vous extrêmement important avec des ingénieurs venus de Hambourg et qu’il lui serait difficile d’arriver avant vingt-deux heures. Mais il voulait absolument la voir. Elle avait été flattée en faisant celle qui comprenait. Des turbines électriques… Ce devait être fascinant. Des turbines. Elle ne savait même pas ce que c’était.
Elle n’attendait que cela finalement, elle était seule depuis près de trois ans, elle souffrait du manque, de tendresse et de caresses, de présence. Une chaleur trop longtemps refoulée lui avait gonflé les veines, elle ne s’était même pas interrogée sur ce rendez-vous tardif dans un pub de campagne. Il avait probablement craint de tout gâcher en se précipitant et il marquait une dernière étape, une sorte de passage obligé au Stuart Pub. Elle lui manquait ! Il voulait la voir pour l’emmener ailleurs, non ? Chez lui.
— Ça va… opina-t-il avec une moue qui montrait quand même de la lassitude, je vais sans doute être obligé de partir quelques jours à l’étranger, en Inde. On a de très gros clients là-bas.
Elle ouvrait de grands yeux admiratifs. L’Inde… Elle avait vu des clichés à la télévision, d’immenses grappes humaines, des barbus au torse couleur de bronze, des milliers de gens qui se baignaient dans les eaux sales d’un fleuve, elle n’avait pas très bien compris pourquoi mais l’image l’avait fait rêver. D’un autre monde, d’une autre vie possible. Son ex-mari travaillait à la Sanogri, ce n’était pas un métier honteux et il n’était pas feignant, mais tout ce qu’il pouvait lui offrir, c’était des mains sales et des odeurs de graisse le soir à la maison. Une maison qu’ils n’étaient pas prêts de posséder, sans doute abonnés à vie aux trois pièces HLM et aux vacances sous la tente, dépaysement garanti entre les lavabos communs et les concours de maillots… À quarante ans, elle avait fait le bilan d’une existence qui la consumait à petit feu. Elle avait pris l’habitude de s’évader sur le net. Et bien sûr elle avait fini par quitter la maison et le mari.
L’homme en face d’elle jetait des regards dépités sur ce qui les entourait, il ne pouvait s’empêcher d’afficher son manque d’enthousiasme, il devait aspirer à autre chose après sa longue route et elle jugea elle-même le décor miteux.
— Vous préférez aller ailleurs ?
Il hocha la tête. La musique jouait trop fort, ça gueulait un peu du côté du bar, des passionnés de foot qui refaisaient le match. Le patron se mêlait à la conversation tout en lançant ses dés, il n’avait prêté aucune attention à ce client attardé et inconnu qui exhalait le fumet faisandé du rencard adultère. Un sourire étira les lèvres de l’homme, c’était bien ce qu’il avait escompté.
— Mon penty est à trois kilomètres, dit-il en fixant sa compagne de ses yeux sombres. Si vous voulez, je vous offre un verre…
Il eut un coup de menton couplé d’un sourire prometteur :
— … Autre chose que ça…
Elle tressaillit. Elle avait ressenti une nouvelle poussée de fièvre. C’était bien ce qu’elle avait envisagé, il ne lui avait fixé rendez-vous au Stuart que parce qu’il habitait tout près. Le grand saut. Elle était décidée, elle accepta d’un battement de cils.
Il tira un billet de sa poche et elle remarqua qu’il n’avait pas ôté ses gants. Il coinça la coupure sous le demi de Kilkenny qu’elle n’avait pas vidé, et se leva sans attendre sa monnaie. Grand seigneur. Elle se demanda ce que ça gagnait, un commercial en turbines électriques qui voyageait en Inde…
Le coup d’œil qu’il lança dans sa direction lorsqu’elle écarta légèrement les jambes pour quitter sa chaise ne lui échappa pas.
— Bonsoir…
Le patron vira à peine la tête et n’enregistra que les cinq euros abandonnés sur la table. Le couple lui tournait déjà le dos. Une langue d’air glacé vint lécher le plateau du zinc, la clochette aigrelette de la porte mourut dans les accords de musique country. Dehors, Évelyne Carohé frissonna sous la morsure du froid et l’homme s’en aperçut, il enroula un bras protecteur autour de ses épaules en la poussant doucement à travers la chaussée, vers l’ombre épaisse que formaient les branches du hêtre.
— Je me suis garé là. Et vous ?
— Sur l’esplanade, dit-elle en se serrant contre lui comme si elle cherchait une protection. Vous me ramènerez ?
Il opina en souriant. Bien sûr qu’il la ramènerait ! Après… C’était exactement ça. Exactement ça !
Il fallait pratiquement atteindre l’arbre pour deviner quelques éclairs de chrome piqués par les reflets des vitraux du Stuart. Une grosse voiture. Ce devait être son entreprise qui la lui payait, des turbines électriques produites par un consortium allemand, c’était ce qu’il lui avait dit et qu’elle avait répété à sa copine Isabelle. Sans rien comprendre. Le seul mot qui avait quelques résonances en elle, c’était allemand, ça faisait solide et sérieux, ça sentait Mercedes et BMW…
Il ouvrit la portière et la regarda s’installer. Cette fois elle ne fit pas d’efforts pour dissimuler ses cuisses, d’autant plus que l’éclairage intérieur ne fonctionnait pas. Il vint s’installer près d’elle, souffla sur ses doigts comme si l’épaisseur des gants de cuir ne le protégeait pas suffisamment.
— Quel froid… murmura-t-il.
Il la regarda. L’instant d’après il avait son bras autour de ses épaules et se penchait vers elle.
— Vous m’avez manqué…
Ce n’était qu’un aveu murmuré, il ne lui restait qu’un infime espace à franchir et elle n’attendait que cela. Elle n’espérait que cela. Elle fronça le nez, entrouvrit les lèvres, devina un souffle chaud à l’instant où elle fermait les yeux.
Elle lui rendit son baiser avec le cœur battant d’une collégienne, en devinant qu’il retirait le gant de sa main gauche, ses doigts cherchaient déjà, oubliant l’appréhension de l’instant précédent, s’insinuaient, rencontraient de la dentelle, caressaient une bande de peau nue.
Évelyne ne vit pas l’éclair dans son regard baissé. C’était exactement ça. Exactement ça ! Il ne devait pas se précipiter, il avait la nuit devant lui, et même l’éternité s’il le décidait. Il allait leur montrer, à tous ces savants !
Il suspendit son geste et la fixa, yeux dans les yeux, les lèvres encore soudées. Elle était précisément ce qu’il cherchait, la quarantaine mature, brune aux cheveux mi-longs, un peu charnue avec sûrement de la peau d’orange dans le haut des cuisses. Il glissa ses doigts nus dans une mèche au-dessus de l’oreille et déposa un dernier baiser volontairement doux.
— Champagne ?
Elle n’osait plus parler de peur de rompre le charme, elle se serait donnée tout de suite, là dans la voiture, s’il le lui avait demandé. Mais il était trop bien pour ça, trop soucieux de son bien-être à elle, trop raffiné. Elle mesurait la chance qui était la sienne. Un prince ! La voiture ce serait pour plus tard, quand ils se connaîtraient mieux et qu’ils auraient envie de jouer.
— Hum…
Il prit cela pour une approbation et fit face au volant. Elle ne remarqua pas qu’il n’allumait les feux qu’après avoir roulé une bonne centaine de mètres et négocié la première courbe. De toute façon, elle avait la nuque contre l’appuie-tête, elle rêvait en oubliant la nuit, avec une folle envie de poser sa main sur sa cuisse à lui.
Il lui avait dit s’appeler Gabriel, comme l’ange, la Force de Dieu, le messager du Tout-Puissant.
D’une simple pression des doigts, il venait d’augmenter le volume de la musique que diffusaient les quatre baffles insérés dans les portières. Elle reconnut l’arpège du piano, la voix cassée, la mélodie si lourde d’émotion. Bryan Adams.
« Look into my eyes… you will see
What you mean to me… »
Le timbre fabuleux du Canadien était comme écorché par le granit des roches nues que longeait la voiture. Évelyne en ressentit des picotements sur les bras.
« Search your heart… search your soul…
And when you find me there you’ll search no more… »
Elle ne comprenait pas le sens des mots et pourtant elle devinait qu’ils recelaient une signification. Il se mit à fredonner avec le disque.
« … You know it’s true
Everything I do… I do it for you… »
Elle distinguait son profil dans la luminosité du tableau de bord, un nez pointu, des yeux sombres, des cheveux drus et toujours très noirs alors qu’il devait accuser autour d’une quarantaine d’années. Il tourna la tête pour lui sourire. L’étirement des lèvres creusait des fossettes dans ses joues.
— Everything I do, I do it for you…
Elle n’osa pas lui dire qu’elle ne saisissait pas et se mit à lui masser la nuque. Ils roulaient depuis un moment maintenant, plus de trois kilomètres sûrement, il avait dû exagérer un peu en évaluant la distance. Elle se demanda où ils étaient, ils traversaient des hameaux de quelques maisons fermées, sans rencontrer âme qui vive.
— On arrive, annonça-t-il brusquement.
Au-dessus d’eux, la nuit était d’une telle noirceur qu’elle faisait l’effet d’un tunnel, sans le moindre repère lumineux. Seuls les phares éclairaient maintenant une allée à peine carrossable s’enfonçant entre deux haies décharnées, les suspensions du véhicule amortissaient sans les gommer totalement les nombreux nids-de-poule qui crevaient la chaussée.
— On est où ?
Collée à la vitre, Évelyne cherchait désespérément à pénétrer les ténèbres en plissant inutilement les paupières. L’obscurité les enveloppait, épaisse, inviolable. Évelyne devinait simplement la présence d’arbres au-dessus d’eux, des branches échappées des buissons griffaient la carrosserie, ils s’enfonçaient dans une forêt.
— Mon penty, dit-il fièrement sans répondre à la question, mon refuge… C’est ma grand-mère qui me l’a laissé.
Les feux de la voiture venaient de faire jaillir un muret qu’ils franchirent avant de s’immobiliser devant la maison, une petite longère en pierre de taille à un niveau surmonté d’un grenier.
— Ti mamm goz, annonça-t-il fièrement en coupant le moteur et en se penchant vers elle. Vous savez ce que ça veut dire ?
Il percevait son appréhension soudaine, elle s’était inquiétée en le voyant s’enfoncer dans ces ténèbres sans repères. Sa main effleura un genou, devina qu’Évelyne n’était plus disposée à le laisser s’aventurer davantage.
— Champagne ? répéta-t-il avec une moue encourageante.
Elle n’eut pas le temps de réagir, il s’éjectait de la voiture et gagnait le perron dont il déverrouilla le battant avant d’éclairer. Un rectangle de lumière jaune enveloppa la voiture, il vint lui ouvrir, tendit la main pour l’aider à descendre et traverser l’espace de terre battue, la précéda à l’intérieur où la chaleur apaisante lui tomba sur les épaules. Éclairage indirect, livres aux murs, vaste canapé, écran plat, cheminée dans laquelle il ne restait plus qu’à brûler les branchettes.
— Bienvenue dans ma modeste demeure, prononça-t-il après s’être incliné cérémonieusement.
Il avait un briquet à la main, avec lequel il enflamma un chiffon de papier journal coincé sous les brindilles sèches. Lorsqu’il se redressa, la bûche craquait déjà et Évelyne se remit à respirer. C’était bien Gabriel qu’elle avait devant elle, son Gabriel qui se débarrassait de son manteau et apparaissait dans une tenue entièrement noire qui lui était familière, pantalon de laine et pull-over à col roulé. Il allongea les bras pour l’aider à se défaire de son vêtement et ne cacha pas son plaisir en la découvrant en jupe courte sous le gilet vert pomme, jambes gainées de soie noire. Des jambes épaisses, rondes, fortes… C’était exactement ça. Exactement ça !
— Vous êtes très jolie, admira-t-il.
Sincère. Il imaginait déjà le plaisir qu’il allait en tirer, sa souffrance se muait en pulsion. Irrésistible. Maintenant. Tout de suite. Après…
— Asseyez-vous…
Musique. Il fouilla dans une pile d’enregistrements à la recherche d’un son d’ambiance, opta pour Barbara Dennerlein, une Munichoise virtuose de l’orgue Hammond, et posa la galette sur la platine.
— Alors ? Vous ne m’avez pas répondu. Champagne ?
Évelyne s’était laissé couler sur les immenses coussins du canapé et ne boudait pas son bien-être. Champagne bien sûr… Elle avait la nuit devant elle et même davantage, on était vendredi, personne ne l’attendait avant le lundi suivant, il pouvait bien la séquestrer, elle était consentante.
Il revint de la cuisine porteur d’une bouteille à l’étiquette dorée et de deux coupes, lui en tendit une, leva l’autre à hauteur de ses yeux.
— À vous…
Ses pupilles luisaient lorsqu’il la regardait et elle y lut de l’envie, pas autre chose. Elle était merveilleusement bien, Gabriel était exactement son type d’homme et elle aimait la manière dont il avait aménagé son penty. Divinement cosy. Les flammes de l’âtre faisaient rougeoyer les panneaux de la bibliothèque, le son qui l’envahissait semblait provenir de partout à la fois.
— C’est de l’orgue ?
— Hammond, répondit-il gentiment, un orgue électromécanique. Le principe est celui d’une roue phonique qui tourne devant un aimant générant un champ magnétique, c’est la combinaison des deux qui produit ce son très particulier.
— Je connais.
Elle ne voulait pas avoir l’air d’une idiote.
— Bien sûr. Procol Harum. Rhoda Scott aussi sans doute…
Qu’est-ce qu’il attendait ? Elle vida sa coupe très vite et tendit son bras. Il la resservit et cette fois s’installa près d’elle. Elle avait chaud à l’intérieur, elle était euphorique.
Ce fut elle qui l’embrassa et il répondit. Elle aimait son haleine et le goût de ses lèvres, bien sûr qu’il avait envie d’elle, elle le vérifia d’une caresse appuyée. Il la renversa sur le canapé, prit son temps, la précipitant dans un chaos mental au fond duquel elle plongea sans entrave. Elle était merveilleusement bien. Il avait les mains chaudes, elle ne résistait pas. Elle sentit qu’il la déshabillait, des doigts habiles défaisaient son chemisier, en écartaient les pans, trouvaient la voie des agrafes dans son dos. Elle creusa les reins comme pour l’aider, se laissa aller aux frôlements qui lui gonflaient les seins, mais elle avait un peu de mal à fixer ses idées, tout était subitement devenu confus, elle somnolait sur les coussins, la tête agitée de gauche à droite. La lumière changeait, indécise, mélangée à des filaments qui brouillaient son regard. Elle tenta de se redresser et se découvrit presque nue, écartelée…
Saoule. Non ! Pas avec deux coupes ! Même après une Kilkenny… Ça tournait et en même temps elle avait terriblement envie de lui. Elle devina qu’elle se mettait à rire. Sans raison. Ou alors juste ce bien-être que procuraient ces mains qui osaient enfin, ces doigts impatients en elle… Peut-être bien qu’elle était ivre après tout, elle repérait dans le brouillard le visage flou de Gabriel. L’envoyé de Dieu, le messager du Tout-Puissant ! Mon prince… Il chantonnait en lui arrachant ses derniers vêtements.
— Everything I do… I do it for me…
La chanson dans la voiture… Bryan Adams… Non, quelque chose avait changé, elle ne savait pas quoi… C’était difficile de se concentrer… Elle était nue désormais, la chaleur du feu embrasait la mousse tout en haut de ses cuisses, elle creusa les reins pour se tendre vers lui… Une violente douleur lui traversa le ventre. Elle ouvrit la bouche pour hurler mais le son s’étouffa dans le fond de sa gorge.
Le messager de Dieu lui enfonçait entre les lèvres une immonde boule de tissu dans laquelle elle planta ses dents. Elle était épuisée, en relaxation musculaire totale, incapable de résister lorsque Gabriel la tira par les cheveux jusqu’à une pièce contiguë où il la jeta sur un matelas recouvert d’un tissu glacé.
Elle frissonna, tenta désespérément de fixer son regard sur la silhouette voûtée vers elle. Gabriel ! Gabriel… Une souffrance atroce lui déchira les entrailles.
Gabriel…
*
Le vent hurlait en s’engouffrant dans les ouvertures crevées de la vieille grange en ruine, à côté de la maison, et le son amplifié des bourrasques donnait le sentiment qu’elles soufflaient en rafales tempétueuses. Une branche gémissait en frottant contre les pierres d’angle. Lugubre.
Marlène frissonna, la poitrine comprimée. Le soudain ululement d’une chouette perchée à proximité accentua violemment son malaise. Elle rejeta les couvertures et resta immobile, allongée dans le noir, guettant les craquements de la nuit comme autant de signes de menace. Deux heures du matin. Elle n’avait pas fermé l’œil, elle ne le fermait plus depuis des jours et des nuits, depuis une éternité lui semblait-il, depuis que la rongeait ce doute atroce… Ce poison… Elle comprima son sein gauche dans sa main en conque, son cœur à force de cogner lui faisait mal, elle comprit qu’elle ne résisterait pas longtemps dans cette obscurité malsaine.
Elle devait se ressaisir sous peine de descente aux enfers. Elle se dressa sur un coude pour atteindre la poire de la lampe de chevet, fit jaillir la lumière avant le chaos total et contempla avec lassitude le mobilier stoïque, les huiles accrochées aux murs, les photographies encadrées sur la commode à dessus de marbre. Rien n’avait bougé, tout était à sa place, solide et confortable. Un décor qui la rassurait autrefois mais un décor qui, dans la profondeur de la nuit, lui hurlait à la face la pauvreté de sa solitude.
Elle eut soudain envie de pleurer. Sa chemise de nuit était trempée de sueur, sa peau exhalait une odeur aigre qui imprégnait le lit. Un parfum de cauchemars. Elle devinait des gouttes qui suintaient sous ses bras, des plaques humides sur sa poitrine et dans le creux qui séparait les seins, dans les plis que formait son ventre tordu par la position qui lui creusait les reins.
Elle se leva péniblement et fit passer son vêtement par-dessus sa tête avant de le rouler en boule et de le serrer contre ses cuisses. Le miroir de la coiffeuse lui renvoyait son image, ses traits tirés, sa peau terreuse, ses yeux sombres défaits par l’angoisse. Un spectre. Elle finissait par se faire peur. En un mois ses cheveux bruns, qu’elle gardait longs, avaient terni et accrochaient maintenant les reflets de lumière dans des racines grisâtres, ses joues avaient fondu, le dessin de ses lèvres avait un pli amer qui ne souriait plus.
Elle marcha en titubant jusqu’à la salle de bains attenante et se glissa sous la douche, laissant le jet la laver longuement de toutes ces scories qui la salissaient. Au moins elle n’entendait plus les gémissements du vent. Ni la chouette. Ni le craquement des poutres dans le grenier au-dessus de sa tête.
Elle coupa l’arrivée d’eau. Silence. La nature lui accordait quelques instants de répit. Elle se sécha à l’aide d’une serviette rêche dont elle se servit pour frotter rageusement chaque partie de son corps. Se débarrasser des déchets. Gommer l’atroce soupçon.
Elle était rouge de la tête aux pieds lorsqu’elle repassa dans sa chambre, mais elle se sentait mieux. Ses pas la guidèrent vers la commode dont elle amena à elle l’un des tiroirs rempli de boîtes de différents formats, des coffrets à bijoux qu’elle dégagea pour extraire du fond du logement un écrin frappé en lettres dorées des coordonnées d’une joaillerie parisienne. Elle souleva le couvercle avec toujours ce même frémissement incontrôlable. Une boucle d’oreille. Unique. Même pas jolie. Une fausse pierre un peu grossière, trop épaisse, sertie de plaqué. Vulgaire.
Marlène avait du mal à détacher son regard. Une émeraude de pacotille à laquelle elle n’aurait sans doute pas prêté vraiment attention lorsqu’elle l’avait découverte. Une babiole perdue, peut-être même jetée, ou tombée d’une poche, quelle importance ? Elle ne se serait même pas interrogée sur l’endroit où elle l’avait trouvée. Un bijou en toc ! Elle n’était pas jalouse. Elle aurait oublié. Sauf qu’elle l’avait déjà vue. Ailleurs !
Elle remua les doigts pour faire jouer les reflets sur la pierre. Ce n’était pas seulement la même, c’était cette pierre-là qu’elle avait vue ! Dans le journal, insérée au cœur d’un article dont on parlait beaucoup. Sur le portrait placardé en tête d’un avis de recherche, l’image d’une jeune femme mystérieusement disparue. Et retrouvée depuis. Morte. Torturée.
Un bruit monta de la route, un moteur ronflait à l’intersection, donnait de la puissance pour aborder la côte vers la propriété. Marlène se précipita pour éteindre la lampe et demeura figée dans le noir, sens en éveil, capable de traduire chaque son qui percerait la nuit. Pistons au ralenti, un déclic, le déclenchement du portail électrique dont les vantaux s’écartaient doucement… Des phares balayèrent la façade, se glissèrent avec indiscrétion dans les rainures des volets, allèrent se cogner au mur avant de mourir.
Marlène ne respirait plus. Moteur coupé. La voiture n’avait pas été remisée au garage. Peut-être repartait-il très tôt le lendemain matin… Non, dans quelques heures seulement, il était près de deux heures et demie.
La clé tourna dans la serrure, à peine audible. Il retenait ses gestes pour ne pas l’éveiller. Elle devina que la porte s’ouvrait et se refermait, il avait dû la soulever légèrement pour éviter le frottement sur les tommettes. Elle suivait son parcours. Progression dans le noir jusqu’à la cuisine où il allumait enfin… le réfrigérateur. Il se servait un verre, elle aurait parié pour un jus d’orange… Il traînait un peu, peut-être qu’il fumait, ce qui lui arrivait de temps en temps. La fatigue…
Elle devina qu’il bougeait. Le couloir, la chambre d’amis dans le fond, avec douche et cabinet de toilette… Il se déshabillait, elle l’imaginait dans cette minuscule salle d’eau, il se glissait dans la cabine, fermait les portes, elle entendit l’eau giclant dans les tuyaux. Lui aussi avait besoin de se laver. De quoi ?
Elle en profita pour enfiler une chemise de nuit propre et replacer l’écrin au fond de sa cachette, puis elle quitta la chambre dans le noir et se figea sur le grand palier, les mains frémissantes serrées sur la rambarde, avec une force telle qu’elle s’en blanchissait les jointures. Elle dominait le rez-de-chaussée, face au couloir dans lequel il allait apparaître.
L’écoulement cessa brutalement et ce fut le silence. Assourdissant. Marlène ne percevait plus rien, il devait poser chacun de ses gestes et s’efforcer de ne pas trahir sa présence. Elle avait toujours cru qu’il faisait ça pour elle. Par égard. Par amour.
Le boyau s’éclaira violemment l’espace de trois secondes, il était sorti de la salle de bains et revenait sur ses pas en se guidant sur les lumières de la cuisine. Il entra dans le champ de vision de Marlène. Son peignoir était à l’étage, ses vêtements aussi, il avançait entièrement nu et l’image avait quelque chose de cocasse lorsqu’il se figea en apercevant la tache blanche que formait la chemise de nuit au sommet de l’escalier.
— Marlène !
Il montrait un visage navré.
— Je t’ai réveillée, chérie…
Elle eut de la peine à articuler, la gorge serrée par l’angoisse :
— Je ne dormais pas.
— Je suis désolé… Je suis lessivé, il est presque trois heures, j’ai pris le dernier train…
Il attaqua les premières marches pour la rejoindre.
— Heinrich n’était évidemment pas pressé, lui !
— Ça s’est bien passé ?
— Au poil…
Il atteignait le palier. Les traits marqués par la lassitude. Ce fut pourtant lui qui remarqua :
— Tu as une mine de déterrée. Ça ne va pas ?
— Je t’attendais.
Elle le laissa la prendre dans ses bras, sentit l’humidité qui imprégnait encore sa peau.
— Je t’avais prévenue que je rentrerais très tard, tu aurais dû dormir.
— Je sais, Michel, je ne pouvais pas.
Il baisa sa tempe.
— Va t’allonger, j’arrive.
Elle le regarda descendre avant de se décider à retourner au lit, elle l’entendait qui s’activait en bas, il avait besoin de décompresser avant de se coucher, il lisait son courrier, ouvrait à nouveau le réfrigérateur, se confectionnait un sandwich. Il n’était pas bien. Elle devinait qu’une chose terrible dont il ne voulait pas parler s’était immiscée entre eux. Elle guettait désormais chacune de ses apparitions. Atroce.
Elle avait éteint sa lampe de chevet et s’efforçait d’adopter une respiration régulière, le dos tourné, lorsqu’il vint s’allonger près d’elle, sans chercher à se rapprocher. Elle sentit simplement la main qu’il posa sur son bras, par-dessus les couvertures. Et elle se dit que cette main-là lui faisait désormais horriblement peur.
Chapitre 2
Maintenant elle était réellement inquiète. C’était la quatrième fois qu’elle passait à l’appartement pour tambouriner en vain contre le battant de bois désespérément clos et personne ne répondait à ses appels. Isabelle Amon cessa de cogner. Elle n’avait pas les clés et dans cette rue bordée d’immeubles où personne ne se connaissait vraiment, il était inutile d’espérer l’assistance des voisins. Dix fois elle avait appelé, sur le fixe, sur le portable, au bureau où Évelyne n’avait pas mis les pieds depuis la journée de lundi. Et on était mercredi. C’était anormal. Inquiétant.
Isabelle sortit du bâtiment et resta plantée sur le trottoir mouillé, encore hésitante sur la conduite à tenir. C’était évidemment délicat. Évelyne avait quarante ans et Isabelle n’était ni sa mère ni sa sœur, elle avait pu décider de s’absenter trois ou quatre jours sur un petit coup de folie qui resterait sans conséquence, et elle n’apprécierait certainement pas qu’Isabelle ait pris l’initiative de lancer le branle-bas.
D’un autre côté, son silence ne laissait pas d’être inquiétant. Même si elle avait fugué avec ce Gabriel, pourquoi couper son portable ? Et sa Twingo n’était pas là, à l’emplacement habituel.
Isabelle traversa le carrefour en direction du Grain au Pain devant la façade jaune duquel elle avait laissé sa voiture, courant sous l’averse qui lessivait Nozay, et se mit au volant, mais elle ne démarra pas. Elle ne savait rien de ce Gabriel, presque rien c’est-à-dire pas grand-chose. Ce que lui en avait dit Évelyne, son amie de toujours. La quarantaine comme elle, célibataire, bel homme, commercial dans un consortium allemand fabricant de turbines électriques. Des mots inhabituels dans la bouche d’Évelyne et qui avaient fait sourire Isabelle. Ils avaient rendez-vous vendredi soir à vingt-deux heures dans un pub. Isabelle ignorait lequel. Elle forma le numéro et pour la énième fois aboutit à la messagerie. « Vous êtes bien sur le portable d’Évelyne Carohé, je suis absente pour le moment, mais laissez un message… »
Isabelle coupa sèchement l’appel. Des messages, elle en avait laissé une demi-douzaine, de plus en plus pressants, de plus en plus inquiets au fur et à mesure que passaient les heures. Elle avait encore le portable en main lorsqu’il se mit à vibrer sur l’air synthétique de Toréador. Elle baissa vivement les yeux. Évelyne !
Non. Numéro inconnu.
— Allô ?
— Madame Amon ? C’est Anne-Marie Le Fur. Vous avez des nouvelles ?
La responsable d’Évelyne à l’usine de mercerie de la zone du Pré Saint-Pierre. Au bout de quelques appels vains, Isabelle avait exigé de lui parler.
Évelyne Carohé était une employée irréprochable, qui ne s’absentait jamais sans raison, qui prévenait en tout état de cause. Elle ne s’était pas présentée à l’embauche depuis lundi matin et n’avait pas appelé.
— Rien, répondit Isabelle, je suis devant chez elle, il n’y a toujours personne.
— Et le téléphone ?
— Toujours sur messagerie. J’hésite à prévenir.
— Vous devriez peut-être, estima Anne-Marie Le Fur, je ne pense pas qu’Évelyne vous en veuille lorsqu’elle rentrera.
C’était contradictoire, songea Isabelle. Si elle était si persuadée du retour d’Évelyne, pourquoi alerter ? Parce qu’elle était inquiète tout simplement, personne n’avait vu Évelyne depuis trois jours. Davantage même si l’on comptait le week-end. Cinq jours qu’elle avait disparu.
— Vous avez raison, je vais m’arrêter à la gendarmerie.
— Prévenez-moi dès que vous avez du nouveau.
Isabelle promit et raccrocha. Il fallait remonter la rue Letourneau en direction du centre hospitalier et elle se lança dans la côte, tournant le dos à l’église Saint-Pierre. Il n’y avait quasiment personne dans les rues, les habitants étaient calfeutrés chez eux, les vitrines éteintes. Certaines à vendre… « À céder »… « À acheter »… La cité comme partout pataugeait dans la crise.
Elle s’arrêta devant le poste de gendarmerie, un ancien bâtiment d’habitation tout en longueur, de plain-pied, aux murs de pierre et aux ouvertures masquées par des rideaux blancs, qu’elle se fit ouvrir avant de pénétrer dans le local, déprimée. C’était triste et froid, même si le fonctionnaire faisait des efforts pour paraître accueillant. Il lui demanda ce qu’elle voulait. Signaler la disparition de quelqu’un.
— De votre famille ?
Non, d’une amie qui n’avait pas donné de nouvelles depuis cinq jours.
Cinq jours ? Un week-end prolongé… Mineure ? Non, la quarantaine, divorcée, libre. C’était son ex qui avait la garde des enfants, à Redon. Elle avait rendez-vous avec un homme qu’elle connaissait depuis peu, ils devaient se retrouver dans un pub vendredi soir, vers vingt-deux heures.
Quel pub ? Elle ne savait pas.
Et le nom de cet homme ? Elle ne savait pas non plus. Évelyne l’appelait Gabriel.
Le fonctionnaire restait sceptique, il consulta la main courante. Qu’est-ce qu’elle a comme voiture, votre amie ? Une Twingo. Isabelle n’était même pas certaine de la couleur.
Non, rien n’avait été signalé qui impliquât une Twingo, ni accident ni panne. Évelyne Carohé ? Pas d’intervention PS, pas de plainte, rien…
— Vous ne devriez pas vous inquiéter, rassura-t-il avec un sourire de bon grand-père, elle file seulement le parfait amour et elle a oublié l’heure.
Isabelle opina. Elle se sentait maintenant parfaitement ridicule avec ses craintes irraisonnées, Évelyne allait rentrer, auréolée de bonheur, et lui fracasserait le crâne en apprenant ce qu’elle avait fait. D’ailleurs peut-être était-elle déjà chez elle.
— Je vais noter quand même. Elle habite où ?
Elle lui dit tout ce qu’elle savait.
— Prévenez-nous dès son retour.
Isabelle ressortit. Elle ne logeait pas très loin, dans le vieux bourg, et n’avait pas envie de repasser dans le quartier de l’église, elle tenta un ultime appel.
« Vous êtes bien sur le portable d’Évelyne Carohé, je suis absente pour le moment, mais… »
Elle raccrocha, désespérée.
*
La campagne sommeillait encore dans le jour à peine levé, des nappes de brume s’enroulaient autour des troncs le long du chemin de halage, et pas une ride ne venait froisser l’eau du canal dont les méandres se perdaient vers l’est, en direction de l’écluse de la Prée. Il faisait un temps idéal, sans un souffle d’air, avec un ciel gris qui ne menaçait pas et une température à ramasser les champignons. Il allait s’éclater !
Jean-Charles Offredo s’étira longuement après avoir quitté sa voiture garée sur le quai de Blain, bras et jambes largement écartés, bouche béante laissant échapper un rugissement de bien-être qui se répercuta sur la surface grise des eaux du chenal. Il était seul au monde et bon dieu qu’il aimait ça, fatigué juste ce qu’il fallait de sa soirée de la veille et des bières éclusées entre amis jusqu’à une heure tardive, il avait besoin d’éliminer et de cracher ses poumons.
Il claqua la portière sans verrouiller. Qui donc aurait l’idée de lui voler cette Renault sans âge dans cette vallée de silence ? Il ajusta le col de son jogging, enfila un bonnet de laine rose qui lui valait sûrement son surnom de Jean-Chou et effectua d’abord quelques mouvements d’assouplissement.
La soirée avait été rude et clôturait une semaine intense, Jean-Charles Offredo enseignait dans un lycée professionnel à des gamins beaucoup moins préoccupés de leur avenir que de l’éclate immédiate. Ils étaient là pour rigoler. Pas méchants, juste frondeurs. Et c’était parfois pire.
Offredo ne leur en voulait pas, à leur âge il en faisait autant, même s’il éprouvait le sentiment que son univers de l’époque ne se heurtait quand même pas au minable hachoir de la téléréalité d’aujourd’hui. Sept d’Or de la crétinerie et Gérard de la vulgarité, starisation de baudruches exhibitionnistes et nivellement par le bas-ventre. De quoi fabriquer des générations cultivées comme une armée de tondeuses à gazon… Il resserra le nœud de ses baskets.
Putain de gamins ! Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que sa connerie sur des choses intelligentes… Il s’arracha de la berme où était garée la Renault, au pied de la promenade Anne de Bretagne, et se mit à courir en empruntant le circuit du Perche, à petites foulées tranquilles rythmées tout de même par une respiration un peu courte. Manque d’endurance. Il s’encroûtait. Un bon kilomètre et demi le long du canal avant d’atteindre l’écluse de la Prée. Il ralentit assez vite l’allure, se donna finalement le prétexte d’un pâle rayon rebondissant sur les eaux de l’Isac pour s’arrêter et contempler la nature.
Déserte. Magnifique. Le chenal déroulait depuis bientôt deux siècles son chapelet de deux cent trente-huit écluses depuis le canal Saint-Félix jusqu’aux eaux de la rade de Brest, ruban paresseux se prélassant ici au pied du château de la Groulais, surveillé à cet endroit par une rangée de sapins dressés pour la parade, refuge des truites, des sandres et des gardons. Un martin-pêcheur jeta un éclair bleu dans la lumière timide du petit matin et Jean-Chou Offredo le suivit des yeux avec une mine gourmande. Bon dieu qu’il était bien, l’air vif lui brossait les poumons et lui marbrait les joues, pas l’ombre d’un gouspin brein1 pour lui polluer son univers et en prime la perspective d’un repos dominical mérité… Il reprit sa promenade, en marchant cette fois, ralenti bientôt par un autre souci.
La bière est peut-être la preuve que Dieu existe et qu’il nous aime, elle n’en demeure pas moins diurétique. Jean-Chou chercha du regard un coin pour s’isoler. Il ne risquait pas d’être dérangé, il conservait néanmoins des restes de pudibonderie qui l’étonnaient lui-même. Devant lui, le chemin de halage formait un S pour atteindre le pont de pierre enjambant le Perche, juste avant sa jonction avec les eaux de l’Isac. La voie avait été élargie, des tables et des bancs de bois dressés pour le pique-nique, à hauteur d’une borne marquée 49. Jean-Chou s’enfonça dans une trouée du bosquet, se laissa porter par la pente dévalant du chemin en surplomb, jusqu’à une clairière en forme d’œuf, d’une demi-douzaine de mètres de long pour la moitié de large, nettoyée à la serpe et dont les branchages taillés s’entassaient à l’une des extrémités arrondies. Jean-Chou tira sur la ceinture de son pantalon de jogging et, les yeux braqués vers le canal dont il ne distinguait plus les eaux au travers des feuillées, en raison de la butte, se soulagea d’un trop-plein que la nuit n’avait pas suffi à éliminer.
Il remit de l’ordre dans sa tenue et pivota sur lui-même avant de regagner le chemin, examinant avec curiosité cette trouée manifestement dégagée par des bras volontaires. Une percée discrète dans le bosquet, à l’abri du regard des promeneurs. Il fronçait les narines en humant l’air, l’atmosphère avait des relents nauséabonds, une vague odeur de putréfaction. Un animal mort traînait quelque part.
Jean-Chou foula l’herbe humide, d’autres étaient venus là avant lui, la terre n’avait pas encore eu le temps de digérer un tas de reliefs de civilisation, mégots de cigarettes blondes, paquet de Lucky Strike froissé, et même magma caoutchouteux dont il identifia sans peine l’usage. Un lieu de rendez-vous. Pour une jeunesse désargentée. Voire échangiste, s’énerva l’enseignant… Les putes n’étaient pas légion le long du canal, au moins pour ce que croyait en savoir Jean-Chou Offredo.
Il appuya sa basket droite sur le tas de branchage et opéra une pression pour vérifier que rien n’était dissimulé là-dessous. Il crut que son cœur explosait.
Ceux qui étaient venus là n’avaient pas abandonné seulement quelques reliefs de leurs ripailles, ils y avaient aussi abandonné l’une des leurs après l’avoir maladroitement cachée sous ce buisson improvisé. L’esprit en panique, Jean-Chou Offredo écarta une partie des feuilles calcinées par la pluie et le froid, avant de se redresser, la main sur la gorge.
Le corps de la femme était étendu à même le sol, sur son côté gauche, le visage tourné vers les broussailles et non vers la clairière. Elle était recroquevillée, presque en position fœtale, les genoux remontés vers les seins que dissimulaient les bras serrés. Elle était entièrement nue et de ce qu’il voyait d’elle, l’arrière de son crâne, le côté de son visage, Jean-Chou déduisit qu’elle devait avoir une quarantaine d’années.
Elle était là depuis plusieurs jours, des rongeurs s’étaient attaqués à son avant-bras dont ils avaient déchiqueté la chair. Jean-Chou sentit son estomac remonter, une nausée impérieuse le figea sur place, mâchoire bloquée, front inondé. Il eut tout juste le temps de détourner la tête avant de se plier en deux, secoué de hoquets, les yeux brouillés de larmes, le nez coulant.
Bordel de merde ! Il avait mal aux tripes, c’était de la bile qu’il vomissait, les spasmes lui tordaient les entrailles. Il eut la tentation de se jeter dans le paravent de broussaille, le corps toujours tordu, et de plonger en direction du chemin de halage où il se mettrait à courir comme un fou. Sa voiture était à deux kilomètres, il était en pleine campagne déserte et il n’avait pas emporté son téléphone.
Pauvre femme… Crever dans ce bosquet-décharge, à deux pas d’une nature grandiose. Qui était-elle ? Jean-Chou Offredo parvint à calmer les contractions douloureuses qui lui serraient le ventre et se redressa enfin avec effort. Il avait le visage trempé. Il s’essuya longuement, se moucha, avala des goulées d’air frais qui ne chassèrent pas le goût rance de ses amygdales.
Il ne voyait rien autour du cadavre, ni vêtement ni papier, tout avait été emporté. Et de quoi était-elle morte ? Il n’osait pas se pencher, la peau grise de la femme présentait des marbrures dont Jean-Chou était bien incapable d’identifier la nature. Une jolie fille, brune aux cheveux mi-longs, les paupières fermées masquant la couleur des yeux. Elle entrouvrait les lèvres dans un rictus crispé.
Jean-Chou plia les genoux, alerté. Un objet dépassait de la rangée de dents, une chose immonde qu’on avait enfoncée dans la bouche de la malheureuse, une excroissance noire vers laquelle Jean-Chou tendit un doigt circonspect.
C’était mou et pelucheux. Du tissu. De la laine. Une chaussette !
Il osa une pression qui fit bouger le corps, laissa son regard se hasarder sur la peau nue, les flancs un peu épais, le ventre arrondi par la position, les cuisses souillées et zébrées de coupures, brûlées, noircies. Cette femme avait été torturée.
Il se remit debout, définitivement secoué, et tourna le dos pour escalader la butte vers le chemin le long du canal en crochant dans la terre, sans prendre garde aux ramures qui lui griffaient le visage. C’était maintenant qu’il regrettait sa solitude, il aurait aimé apercevoir la silhouette rassurante d’un pêcheur taquinant le gardon ou la proue d’une péniche filant en direction de Redon. Mais il n’y avait rien, rien ni personne, juste un léger voile de brume accroché aux berges. La maison éclusière ! Il ne la voyait pas mais il la savait là, à deux cents mètres au-delà du coude. Il se mit à courir en zigzag, traversant le petit pont, aperçut enfin la passerelle verte de l’écluse de La Prée, les murs blancs de l’habitation, les couleurs celtes des deux drapeaux flottant dans le vent mou, au sommet du mat dressé dans le jardin. Il tambourina en vain à la porte. Personne. Le canal était fermé à la navigation à compter d’octobre.
Ses jambes flageolaient sous lui. Jean-Chou Offredo repartit dans l’autre direction en essayant de courir mais il en était incapable, il allait s’étaler le long de la terre durcie par la froideur nocturne. Il se mit à marcher courageusement, réchauffant ses muscles, accélérant son rythme au fur et à mesure de sa progression, apercevant enfin sa vieille Renault fatiguée. Pourquoi n’avait-il pas emporté son téléphone avec lui ? Bordel de merde ! Il l’avait gagné, son repos dominical mérité !
Il se jeta sur le siège et claqua violemment la portière, prenant alors seulement conscience qu’il avait eu peur. Une trouille exagérée. Ses doigts frissonnaient encore en cherchant le contact, il tourna la clé et se détendit un peu au bruit familier du moteur. Il respirait. Il avait honte maintenant, honte d’avoir paniqué en laissant derrière lui le contenu entier de son estomac. Bon Dieu ! C’était qui, cette femme ? Et que faisait-elle là ?
Il fouilla fébrilement dans la boîte à gants, trouva le paquet de cigarettes qu’il cherchait. Pas des Lucky Strike mais des Benson dorées. Encore heureux ! De toute façon elle était morte depuis plusieurs jours.
Il aspira goulûment la fumée qu’il avala pour chasser le goût de bile qui lui recouvrait toujours le fond de la gorge, souffla un long jet en direction du pare-brise. Ça allait mieux. Il avait été secoué mais ça allait mieux… Il s’observa dans le miroir du rétroviseur, constata que ses joues retrouvaient des couleurs, que ce n’était plus deux minces traits exsangues qui pinçaient le filtre de sa Benson.
Il ne subsistait plus que ce ridicule bonnet rose qu’il arracha pour redevenir Jean-Charles Offredo, enseignant au lycée professionnel, en charge d’une flopée de sales gosses auprès de qui il allait passer pour un héros.
Il enclencha la marche arrière.
1. Sale gosse.
Chapitre 3
— Un peu plus loin…
Le gendarme opina au volant de son fourgon qui remontait à faible allure le chemin de halage. Il savait où il allait. La description fournie par le professeur était suffisamment précise, il y avait belle lurette que la brigade avait été informée de l’existence de cette clairière où se réunissaient des jeunes de la commune qui préféraient la solitude aux terrasses des bistros. Une sorte de coffee-shop en plein air, sur les rives du canal. Ils ne faisaient de mal à personne et, pour ce qu’on en savait, ils ne dealaient pas. Alors la brigade se contentait de surveiller de loin… Le fourgon longeait la voie d’eau qu’il laissait sur sa droite, en direction de l’écluse de La Prée, l’écluse numéro 10 qui ouvrait vers l’amont. Le chemin était désert.
— Là-bas…
La borne 49. Jean-Charles Offredo, assis à la droite du chauffeur, tendait un index oiseux que l’autre ignora. Il avait faim. L’émotion passée, son estomac vide s’était mis à réclamer avec insistance. Ça s’entendait.