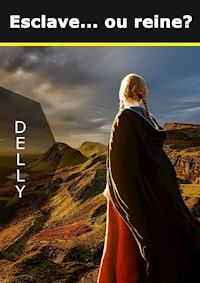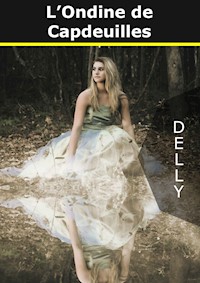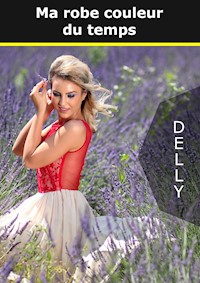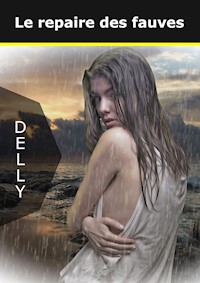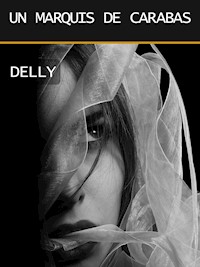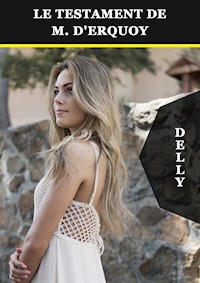2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Tugdual Meurzen est un jeune peintre mais déjà on apprécie son talent, son parfait «métier»... Un mot qui le laisse insatisfait, irrité. Ses toiles, il le sent, manquent de liberté, d'âme. En vérité, Tugdual étouffe entre une mère abusive et une soeur à l'esprit sec. Pourtant, dans cette lumineuse Provence où tous trois font un bref séjour, Tugdual se reprend à espérer. Il a fait la connaissance de Sormagnes, le sculpteur, et de sa petite-fille, Dionysia, au pur et grave visage éclairé par un regard d'aigue-marine. Sensible au drame qu'elle devine, elle accepte de poser pour un portrait. Et dès les premières esquisses, un nouvel artiste se révèle deux coeurs se découvrent. Mme Meurzen va tout tenter pour reprendre son fils. Lui rappeler un ancien, un fatal serment...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Le fruit mûr
Pages de titreRomanPremière partieIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIDeuxième partieI - 1II - 1III - 1IV - 1Page de copyrightDelly
Le fruit mûr
Roman
Première partie
I
Le jour perdait sa lumière frémissante, que le soleil au déclin emportait avec lui. Tugdual Meurzen, derrière la vitre d’une porte-fenêtre, la voyait quitter lentement le petit jardin touffu, qui restait éclairé cependant, mais d’un reflet pâle et froid de foyer trop lointain. Il s’imaginait voir frissonner les palmes des phœnix, les feuilles légères des mimosas, et même les rudes pointes aiguës des aloès. C’était l’heure dangereuse de ces rives de soleil – l’heure que Tugdual aimait pour sa mélancolie.
Derrière lui, une voix demanda :
– Vas-tu sortir maintenant, Tug ?
Il se détourna et regarda la mince figure de femme, légèrement flétrie, qui se détachait sur le coussin de toile bise d’une chaise longue. Deux yeux d’un vert pâli s’attachaient sur lui, sur son visage aux traits forts, un peu rude, et triste, fermé, trop pensif.
– Oui, à l’instant, ma mère. Vous faut-il quelque chose ?
– Non, merci, mon enfant. Mais pars vite, et ne tarde pas trop à revenir. Je ne comprends pas ton idée de sortir à cette heure... As-tu commencé l’esquisse de ta Madone ?
– Pas encore. Je ne suis pas pressé, car je sais que l’exécution ne répondra pas à ce que je souhaite, comme toujours.
La voix du jeune homme frémit de souffrance, à ces derniers mots. Mais Mme Meurzen ne s’en aperçut pas. Elle dit d’un ton fâché :
– Tu es le seul à trouver cela. Tous ceux qui voient tes œuvres s’accordent à reconnaître ton très haut talent.
Un sourire d’amertume douloureuse entrouvrit les fortes lèvres d’un rouge ardent,
– Oui, un très beau talent... Oui, en effet...
Tugdual fit quelques pas dans la pièce, un petit salon meublé de rotin et de cretonne claire. L’ombre de la nuit toute proche semblait descendre déjà dans ses yeux tristes, qui avaient la nuance des feuilles rousses détachées par l’automne des ramures où la sève s’endort. Ses épaules robustes se courbaient un peu sous le veston ample et commode qui donnait à cette vigoureuse stature masculine une apparence aisée, simple, correcte cependant, car les détails dénotaient l’homme soigneux.
Il s’arrêta près de la porte en disant :
– Eh bien, à tout à l’heure, ma mère.
– N’oublie pas ton pardessus !
Il fit un geste affirmatif et sortit. Dans le vestibule, il se heurta à une femme jeune, mince – une réplique de Mme Meurzen, avec trente ans de moins. C’était sa sœur Josèphe, son aînée. Ils échangèrent quelques mots, tandis que Tugdual mettait son pardessus. Puis le jeune homme sortit dans le chemin étroit qui longeait des plantations d’oliviers. Il se mit à marcher vite, d’un pas nerveux, mai rythmé. Son regard cherchait les derniers reflets de la lumière sur le feuillage cendré, autour de lui. Il les regardait mourir sur les pins qui couvraient la colline, et s’évader lentement en laissant une clarté rose, au couchant.
Dans l’air calme, une fraîcheur glacée s’insinuait. On la sentait s’élever du sol, tomber du ciel pâli, envelopper les feuillages encore tièdes de toute cette lumière qui s’éteignait. Et le silence, la solitude se faisaient dans la campagne tranquille sur laquelle se répandait le parfum délicat des eucalyptus qui formaient, à gauche, tout un petit bois, près de l’olivaie.
Tugdual s’engagea dans un sentier pierreux, qui montait en traversant une pépinière plantée en gradins. Tout en haut, deux bassins de pierre étalaient leur nappe d’eau que le couchant teintait de rose brillant. À côté, une petite maison se dressait, toute grise, couverte de longues traînes de rosiers et presque encastrée dans un vieux mur fleuri au-dessus duquel se dressaient des cimes d’arbres.
Dans ce même mur, un peu plus loin, une grille apparaissait, toujours ouverte. Le regard de Tugdual plongea au passage dans l’ombre verte d’une étroite allée en dôme, et distingua les murs roux d’une maison très vaste, un peu massive. Le jeune homme continua de longer le mur, pendant un moment. Puis il s’arrêta et respira largement la senteur fraîche des pins qui commençaient ici d’escalader la colline.
Il redescendit en flânant. Près des bassins, il s’arrêta encore pour regarder l’ombre s’étendre sur l’eau immobile. Un chien brun, sortant de la petite maison, aboya. Une voix d’homme l’appela, de l’intérieur. Puis d’autres voix, un rire léger troublèrent le silence recueilli. Sur le chemin qui montait, des pas faisaient glisser, s’entrechoquer les pierres déchaussées par les pluies d’automne. Deux femmes parurent. Elles passèrent près de Tugdual, en lui jetant un coup d’œil discret. Il vit un visage brun et rieur, un autre visage au teint d’ambre pâle, et deux yeux tranquilles et superbes, profonds comme l’onde.
Il continua de descendre. Mais il ne regardait plus le coucher du jour. Il pensait à ces yeux, à peine entrevus, et qui, seuls, l’avaient frappé dans cette figure de femme. Il se disait : « Je voudrais les revoir. Ils m’ont paru très beaux. Peut-être m’inspireraient-ils ? Peut-être y trouverais-je un peu de cette lumière que je cherche sur tous les visages, et que je n’ai pu découvrir encore ? »
Quand il fut près de la petite villa de pierre blonde et rose dont il était le tout récent locataire, Tugdual s’arrêta et s’appuya à la murette couverte de feuillage qui enclosait le jardin. Il resta un long moment ainsi, un peu frissonnant, regardant la nuit venir et s’enivrant de son rêve d’artiste, de son rêve merveilleux que ses pinceaux seraient demain incapables de traduire, et qui s’évaderait d’ailleurs tout à l’heure, près de sa mère et de sa sœur.
II
Tugdual descendit le lendemain matin au Golfe-Juan. Il erra quelque temps sur le petit port, regardant la houle bleue aux éclairs d’or sur laquelle dansaient quelques barques. Puis, en flânant, il se dirigea vers Juan-les-Pins. Derrière lui, il entendait un bruit de pas, des voix d’enfants, et une autre, une voix d’homme lente et sonore. Les promeneurs se trouvèrent bientôt à sa hauteur. Deux enfants le dépassèrent, et la voix masculine prononça :
– Meurzen ?... je ne me trompe pas ?
Il tourna la tête, et vit près de lui un homme jeune, très grand, dont les yeux souriaient tandis que les lèvres restaient sérieuses et fermées.
– Ah ! Heurtal !... Je ne vous savais pas ici.
Ils se serrèrent la main avec une cordialité tranquille, tandis que René Heurtal expliquait :
– Je suis installé depuis trois semaines à Juan-les-Pins, avec les enfants. C’est pour ma petite Camille, qui a toussé tout l’hiver dernier.
Il désignait la toute petite fille blonde qui courait près de son frère, le long du rivage.
– Vous restez avec eux ?
– Pas tout le temps, c’est impossible. J’ai pris un congé de deux mois. Après cela, je les laisserai avec ma sœur aînée qui viendra à ce moment me remplacer... Et vous, Meurzen, que faites-vous ici ?
– Ma mère ne peut se remettre de la congestion pulmonaire qui a failli l’emporter l’année dernière. J’ai loué une petite villa, en haut, par-delà Vallauris. Cela s’appelle le bastidou Saint-Jean.
– Oui, je connais. C’est gentil. Vous êtes le voisin de Calixte Sormagnes,
– Calixte Sormagnes ?... Il habite par là ?
– Tout près, à la maison du Sarrazin qui appartient de temps immémorial à sa famille, car il est de par ici.
– J’ignorais... Cette maison du Sarrasin, n’est-ce pas une grande bâtisse rousse, entourée d’un petit parc ?
– Précisément. Il y passe tous les hivers, avec sa petite-fille. C’est un très vieil ami pour moi, ainsi que vous le savez. Je vais fréquemment le voir depuis que je suis ici. Voulez-vous que je vous présente ? C’est un homme charmant, et très sociable.
– J’accepte volontiers. Je suis un sauvage et je déteste les nouvelles connaissances. Mais Sormagnes, le maître sculpteur, c’est autre chose. J’admire dans ses œuvres ce qui manque à tant d’autres, ce qui fera demeurer perpétuellement tant d’artistes dans les limbes de leur médiocrité : le rayon d’idéal, la vie profonde de l’âme transparaissant sur la toile, le marbre, ou dans les harmonies de la composition musicale.
– Oui, Sormagnes est un artiste complet. Mais il a été admirablement inspiré par sa femme d’abord, une Grecque intelligente et fort belle, puis, quand il fut devenu veuf, par sa petite-fille, Dionysia, vivant portrait de l’aïeule. Avez-vous vu sa Jeune fille rêvant, au dernier Salon ?
– Oui. C’est un chef-d’œuvre. Et quel délicieux visage de femme !
– Dionysia a été son modèle, pour cette statue et pour d’autres. Quand il fit celle-là, elle avait seize ans et venait d’être fiancée.
– Elle est mariée ?
– Non, elle l’a été... ou plutôt elle a failli l’être. Après le mariage à l’église, tandis qu’on entourait et complimentait l’épousée, le jeune homme – c’était son cousin, un Hellène du nom de Stéphanos Damapoulos – s’enfuyait en laissant une lettre dans laquelle il disait que, forcé par son père à ce mariage, il trouvait indigne de continuer à jouer près de Dionysia la comédie de l’amour, tandis que tout son cœur appartenait à une autre femme, dans son pays. Il déclarait renoncer à l’héritage de son père, accepter de ne plus revoir les siens, plutôt que de devenir l’époux de sa cousine, « car, ajoutait-il, je la trouve trop digne de tendresse et de respect, pour la tromper ainsi ».
– Et alors ?
– Eh bien, alors, le mariage fut annulé, en dépit des fureurs du père Damapoulos, qui voulait partir à la recherche de son rejeton et le ramener repentant, entre deux gendarmes probablement, aux pieds de Dionysia. Celle-ci était très riche, comprenez-vous ?... Il dut mettre du temps à se consoler de cette grosse déception – d’autant mieux que Stéphanos, paraît-il, épousa sa bien-aimée, qui n’avait pas le sou.
– Comment Mlle Sormagnes prit-elle l’aventure ?
– Elle ? Pauvre petite, elle l’aimait ! Son premier amour, tout simple, tout candide... Oh ! elle fut très courageuse, très fière. Personne ne la vit pleurer, en dehors de son aïeul, son seul protecteur, car elle était orpheline. Personne ne reçut de confidences. Elle continua sa vie de jeune fille, près du grand-père dont elle est la joie. Mais elle n’est pas mariée encore. Il y a huit ans que Stéphanos est parti, et elle refuse toutes les demandes, dont quelques-unes des plus flatteuses, car, sans parler de sa beauté, elle est remarquablement douée au point de vue intellectuel, ainsi que vous pourrez en juger.
– L’aime-t-elle donc encore ?
– Je ne sais. Peut-être. Il était charmant, très artiste, d’une grâce câline, un peu mélancolique. On le disait malheureux chez son père, esprit étroit et autoritaire. La compassion féminine avait probablement frayé la voie à l’amour, ainsi qu’il arrive souvent.
Il s’interrompit, en étendant la main :
– Voilà mon logis.
Une villa apparaissait sous les pins. Elle était petite, basse, toute rouge et blanche dans la clarté vibrante de l’heure déjà chaude. Heurtal expliqua :
– C’est un peu étroit, mais fort gentiment aménagé. Puis la situation est parfaite. Les enfants sont tout le jour dans les pins, et respirent en même temps l’air salin.
Tugdual jeta un coup d’œil sur la petite fille blonde qui revenait vers eux, en tenant par la main son frère plus jeune.
– Elle a bonne mine, je trouve, cette enfant.
– Oui, déjà l’amélioration se fait sentir... Viens ici, Camille. Tu as trop couru, je le crains...
Sa forte main musculeuse tâta le cou, les joues de la petite fille.
– ... Va trouver Mme Lhomme, pour qu’elle te change. Va, ma chérie.
Le regard de Tugdual s’attacha discrètement sur ce brun visage d’homme, énergique et froid à l’ordinaire, mais qui, en ce moment, s’émouvait de tendresse paternelle. Heurtal, s’en apercevant, dit avec un calme forcé :
– Vous pensez que ce n’est pas moi qui devrais m’occuper de cela ?... qu’une autre devrait être là...
Tugdual lui prit la main.
– Je ne voulais pas vous en parler...
– Je vous remercie de cette discrétion. Beaucoup ne l’ont pas... Deux ans, Meurzen, deux ans déjà que mes pauvres petits n’ont plus de mère, qu’elle les a quittés, la misérable.
Une lueur de haine passa dans le bleu vif des yeux.
Tugdual demanda :
– Où en êtes-vous ?
– Mais à la séparation, toujours. Je ne demanderai jamais autre chose. Comprenez-moi, Meurzen, je ne suis pas un croyant ; ce n’est donc pas chez moi une question d’obéissance et une interdiction de l’Église. Mais sur ce point-là, je me trouve d’accord avec elle, complètement. Le divorce est une loi de destruction sociale ; il désagrège la famille, il est le triomphe de l’individualisme, c’est-à-dire la ruine de la société. Cela, je le pense depuis des années. Eh bien, si je suis un honnête homme, je dois appliquer mes principes à moi-même, maintenant que le jour est venu. Après avoir déclaré indispensable à la dignité humaine l’union indissoluble, quelle que soit l’indignité de l’un des époux, je ne puis reprendre ma liberté. Car j’affirme que l’individu est dépendant de la société, et qu’il n’a pas le droit de jeter le trouble dans celle-ci, en multipliant les foyers à côté, en discréditant le mariage, réduit à n’être plus qu’un contrat temporaire résiliable à la volonté d’un des conjoints.
Il s’interrompit un moment, et son regard pensif suivit la voile blanche d’une barque poussée par la forte brise d’ouest.
– ... Quand j’étais plus jeune, je disais aussi, comme les autres, que l’être humain a le droit de trancher le lien conjugal, dès qu’il y trouve souffrance ou désillusion. Mais depuis, j’ai réfléchi, et j’ai vu... Non, ce droit, nous ne l’avons pas, car la famille est indivisible, et nous lui sommes solidaires. Dans toute la plénitude de ma raison, et de ma liberté, je me suis uni à cette femme, que je n’aimais pas à la passion, mais que je croyais sérieuse et bonne, et pour laquelle j’ai été un mari fidèle. C’était fini, c’était pour la vie, tant que nous resterions vivants tous deux. Et rien, rien au monde ne pourrait faire que la vraie famille, ce ne soit plus nous : elle, moi, nos enfants. Les autres, les deux foyers que nous pourrions constituer, chacun de notre côté, seraient des rejets poussés sur le vieil arbre de la race, dont ils aspireraient la sève, et qu’ils tueraient lentement. Le principe du divorce est séduisant, il paraît logique ; en pratique, il est destructeur et mène à l’anarchie morale.
Tandis qu’il parlait, Tugdual approuvait d’un signe de tête, d’un bref monosyllabe, ou même seulement par un regard sympathique attaché sur Heurtal. Quand celui-ci se tut, il dit :
– Vous savez que ce sont là mes idées. Mais je me souviens en effet que ce n’étaient pas les vôtres, à l’époque où nous nous sommes connus.
– Oui, oui, je vous le dis, j’étais jeune, je croyais qu’il ne pouvait pas exister de barrières morales pour ce que l’on appelle le droit à la vie. Et c’est la vie elle-même qui m’a instruit – la vie des autres, que j’ai pu étudier autour de moi, la vie du passé, avec ses leçons traditionnelles, et la vie de demain...
Sa main s’étendit vers la villa, où disparaissaient en ce moment les deux enfants.
– ... Leur mère existe toujours, indigne, c’est vrai... mais quand même leur mère. Il y a des choses qu’on n’efface pas, qui nous suivent jusqu’à la tombe. Si je fais entrer une seconde épouse à mon foyer, rien ne pourra faire qu’il n’y ait en un coin du monde une autre femme qui s’est appelée Mme Heurtal, qui a donné la vie à ces enfants, qui a sur eux un droit moral – celui que, fussions-nous criminels, nous conservons toujours sur les êtres nés de notre chair et de notre sang. Ainsi, en dépit de toutes les lois, nous restons liés par l’existence de nos enfants. Et c’est encore pourquoi je juge impossible, presque révoltante, l’idée d’un second mariage.
Il s’interrompit de nouveau. Son visage restait calme, sa voix nette et tranquille. Tugdual pensa : « Je voudrais savoir s’il a aimé, si sa résolution a été éprouvée. »
Les deux hommes se séparèrent avec cordialité. Tugdual remonta lentement vers le bastidou. Sa pensée restait toute occupée de René Heurtal. Ils s’étaient connus huit ans auparavant, à Rome, où tous deux venaient terminer leur formation artistique. Sérieux, travailleurs, de nature un peu fermée, ils s’étaient liés, non très intimement, mais assez pour s’apprécier et s’estimer. Deux ans plus tard, Tugdual apprenait le mariage du jeune graveur. Il le revit plusieurs fois à Paris, fut présenté à sa femme, une brune aimable, d’intelligence alerte, qui semblait sérieuse, toute occupée de son foyer. Heurtal, dont le talent s’affirmait, réalisait déjà de beaux revenus. Il paraissait, sinon très heureux, du moins paisiblement satisfait. Ce fut pour Tugdual une vive et pénible surprise d’apprendre que la jeune Mme Heurtal, après quatre années de mariage, avait abandonné son mari et ses enfants, dont le plus jeune, le petit Maurice, atteignait à peine un an.
Deux ans s’étaient écoulés depuis lors. En revoyant René Heurtal, l’hiver précédent, Meurzen ne lui avait pas dit un mot de ces événements pénibles, qu’il n’eût pas aimé, lui, à voir rappeler par un étranger. Aujourd’hui, Heurtal en avait parlé de lui-même. Peut-être savait-il que l’on faisait courir le bruit de son divorce, et voulait-il profiter de l’occasion pour le démentir catégoriquement.
« C’est une belle nature, probe et sensée », pensait Tugdual. « Mais il doit souffrir, car je l’ai deviné affectueux, sous sa froideur apparente. »
Il atteignit le bastidou, qui chauffait sa façade claire au soleil de midi. Josèphe, sur le seuil, l’attendait. Elle portait une robe de serge blanche, très bien faite. Ses cheveux, d’un doux châtain clair, étaient coiffés avec soin. Elle avait de jolis traits, un teint délicat, l’allure élégante. Cependant, elle manquait de charme. Et dans toute cette lumière vibrante, dans l’ardente beauté de l’heure ensoleillée, son visage n’avait pas un frémissement, le vert pâli de ses yeux restait froid, sans un reflet d’âme.
– Tu rentres tard, Tug.
– Oui. J’ai rencontré Heurtal. Il est à Juan-les-Pins, avec ses enfants.
– Il ne songe pas encore au divorce ?
– Mais non. Il ne l’admet pas.
– Je pensais qu’il l’admettrait pour lui.
– Non, car c’est un honnête homme qui ne transige pas avec ses principes. J’aime cette nature. J’espère que nous nous verrons souvent... À propos, il m’a appris le nom de nos voisins, dont tu t’informais hier. C’est Calixte Sormagnes, le sculpteur, et sa petite-fille. Il m’a promis de me présenter.
Josèphe eut une légère moue dédaigneuse.
– Je n’aime pas les connaissances de villégiature. D’ailleurs, nous sommes venus ici pour trouver la tranquillité.
Il dit froidement :
– Personne ne vous forcera à nouer des relations avec les Sormagnes. Il ne s’agit, pour moi, que d’une visite d’artiste à artiste.
Il entra dans la maison, à la suite de sa sœur. La chaude clarté du jour s’étendait librement dans les pièces aux larges ouvertures. Et cependant, il parut à Tugdual qu’elle s’était amoindrie, qu’elle n’était plus qu’une lumière pâle, sans chaleur, comme le regard de Mme Meurzen et de Josèphe.
III
– Parlez-nous un peu, René, de ce jeune peintre breton dont vous nous annoncez la visite pour aujourd’hui ?
Heurtal eut son fugitif sourire des yeux, en répondant à cette question de Mlle Sormagnes :
– Vous verrez là un être original, et fort intéressant, Dionysia. Il n’a rien d’un mondain, lui-même se qualifie – un peu trop sévèrement – de sauvage. Cependant, il charme, et il retient, un peu à la manière de son pays. Il est d’ailleurs fort distingué, très sérieux – et triste, affreusement triste.
Dionysia dit avec surprise :
– Pourquoi cela ?
– Je ne sais... Ou plutôt, j’ai seulement une intuition du motif de cette mélancolie persistante que je lui ai toujours connue. La question de race mise à part – et elle n’est cependant pas négligeable, car elle explique le reste, peut-être – je crois que Meurzen souffre d’avoir vu le rêve idéal de son esprit méconnu, poursuivi, annihilé par l’influence tyrannique de sa mère et de sa sœur.
– Qu’appelez-vous le rêve idéal de son esprit ?
– Oh ! ma chère amie, si vous me demandez une définition, je suis perdu ! Vous savez que je m’embourbe toujours là-dedans.
Un sourire, doux et amusé, entrouvrit les lèvres d’un superbe dessin, se répandit dans les yeux aux profondes splendeurs d’eau tranquille, sur lesquels s’étendait l’ombre des longs cils bruns.
– Essayez. Votre Breton mélancolique m’intéresse par avance.
– Comme tous ceux qui souffrent. Vous avez un vrai cœur de femme, Dionysia... Eh bien, voici ce que je m’imagine, au sujet de Meurzen... Avez-vous vu quelqu’une de ses œuvres ?
– Oui, sa Vierge au chardon, au dernier Salon. Il a beaucoup de talent.