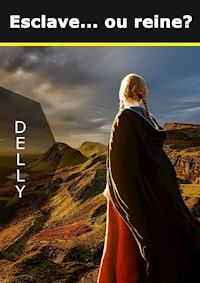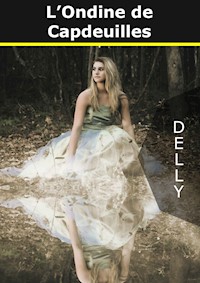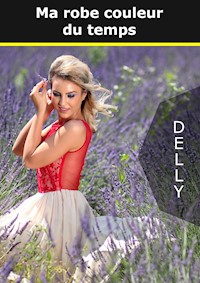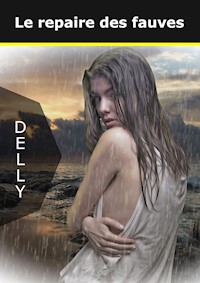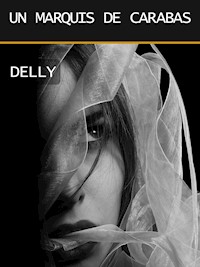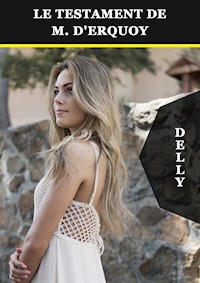2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
« Vous êtes catholique, fervent pratiquant de votre religion, monsieur de Malay. Lysis, ma soeur que vous voulez épouser, est païenne. Elle doit le rester. C'est à cette condition que je vous accorde sa main. De plus, votre mariage ne sera pas célébré à l'église. Une simple cérémonie civile légalisera la situation ». Jean de Malay ne peut accepter ces conditions qui lui sont imposées par Irène Dormier ; celle-ci a élevé Lysis et son frère Hélos dans le plus profond paganisme. Elle rejette la pratique de toute religion, contestant qu'elle puisse être un soutien aux heures de faiblesse et une consolation dans les inévitables épreuves de l'existence. Plutôt que de renier sa foi, Jean préfère rompre avec Lysis. C'est la séparation, mais la vie remettra plus tard en présence les deux jeunes gens dans des circonstances tout autres. Et Irène, à l'approche de la mort, sollicitera d'eux le pardon de ses erreurs et même... d'un crime.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Lysis
Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIPage de copyrightLysis
Delly
I
Jean de Malay s’en allait d’un pas alerte à travers champs, avec ses chiens sur les talons. C’était un beau garçon, nerveux et souple, robuste sous une apparence élégante. Son visage aux traits fermes, un peu bruni par l’air vif, exprimait la joie de vivre, d’être jeune, sain, de conscience tranquille et d’âme enthousiaste. Au passage, les paysans occupés à leurs travaux le saluaient avec une familiarité respectueuse.
– Bonjour, monsieur Jean !
– Bonjour, Mousseaume... bonjour, Maellet. Beau temps pour travailler, aujourd’hui ?
– Sûr, monsieur Jean ! Et le blé sera superbe, cette année.
Jean jetait un coup d’oeil connaisseur sur les vagues d’épis qui ondulaient très loin, jusqu’au pied des coteaux couverts de vignes. Il était le plus grand propriétaire terrien de la contrée et s’occupait de faire valoir ce domaine transmis jusqu’à lui par ses ancêtres. Un régisseur dirigeait sous ses ordres les ouvriers agricoles. Mais Jean avait coutume de tout voir de près par lui-même et ne laissait à personne le soin d’encourager moralement les paysans qui vivaient autour de la Varellière.
Car il avait une âme profondément religieuse et très attachée à tous ses devoirs, ce charmant Jean de Malay dont les yeux d’un brun doré, gais ou pensifs selon les heures, mais toujours si expressifs et si vivants, eussent fait tourner bien des têtes, s’il l’eût voulu. Sa mère avait cultivé avec soin les qualités précieuses en germe dans cette jeune âme et, avant de quitter ce monde, l’admirable chrétienne qu’elle était avait pu contempler en lui l’épanouissement de cette œuvre d’éducation à laquelle étaient consacrés tous ses jours avec le souci des pauvres et l’accomplissement de ses devoirs de châtelaine.
– Marie-toi maintenant, mon cher enfant, lui avait-elle dit tendrement en caressant la tête blonde appuyée contre elle, tandis que Jean étouffait ses sanglots.
Il ne demandait pas mieux, car il se sentait fait pour fonder un foyer, pour entourer d’affection une épouse et des enfants. De plus, il souhaitait vivement voir se perpétuer la vieille race vendéenne dont il sortait. Mais il était difficile, non qu’il recherchât la fortune ou une grande beauté. Désintéressé par nature, il jouissait en outre d’une aisance assez large pour se permettre de ne pas regarder à la dot. Quant à la beauté, il en faisait un cas assez mince dès qu’elle n’était pas accompagnée de ce charme fait de la délicatesse d’âme et de la distinction d’esprit, qu’il était accoutumé de trouver chez sa mère, sa grand-mère et ses sœurs.
– Je veux découvrir quelqu’un qui vous ressemble, bonne-maman, déclarait-il à l’aïeule en l’embrassant, lorsqu’elle le pressait de choisir.
Mais il n’avait pas trouvé encore.
Quant à un mariage de convenance avec une jeune fille qui ne lui plût qu’à moitié, il n’eût jamais voulu en entendre parler.
– Après tout, tu as le temps, mon chéri ; tu n’as que vingt-huit ans, disait sa sœur Madeleine qui, elle, venait de coiffer Sainte-Catherine en déclarant gaiement qu’elle attendait toujours le Prince Charmant de ses rêves.
Jean ne se tourmentait pas. Il pensait que Dieu, voyant sa bonne volonté, saurait bien mettre sur sa route la compagne destinée à le suivre dans les bons et les mauvais jours. Aussi, ce matin, aucune pensée fâcheuse ne venait-elle troubler son contentement devant le charme de cette matinée estivale, devant l’annonce d’opulentes moissons.
Cependant, un pli léger se forma sur son front lorsqu’au tournant d’un chemin il vit se profiler, entre deux bouquets d’arbres, la forme grise d’un petit manoir auquel s’accolait une tourelle.
« Elles sont arrivées hier, d’après Mariette, songea-t-il. Quel ennui d’avoir ces étrangères si près de nous ! »
Tout en avançant, il continuait de regarder le manoir. Celui-ci s’appelait la Marbotterie. Il appartenait à la famille de Carbonnes, de vieille souche vendéenne comme les de Malay auxquels elle était alliée. Louis de Carbonnes avait épousé une jeune fille très riche, très mondaine, qui voulait vivre à Paris l’hiver, sur les plages à la mode l’été, et dédaignait la vieille demeure familiale. Comme, avec ce train de vie, les revenus suffisaient à peine, elle avait décidé son mari, cette année, à louer la Marbotterie. Jean l’avait appris chez eux, à la fin du séjour de quatre mois qu’il faisait chaque année à Paris pour se retremper de plus près dans le courant intellectuel et artistique et apporter l’aide de son dévouement, de son ardente jeunesse, de sa parole entraînante à certaines œuvres sociales de la capitale.
C’était chez les de Carbonnes aussi qu’il avait connu la nouvelle locataire de la Marbotterie. Au cours d’une soirée qui réunissait dans leurs salons des représentants de vieilles familles françaises, des écrivains, des artistes de second ordre dont, à défaut d’autres, aimait à s’entourer Mme de Carbonnes, Louis avait présenté M. de Malay à une jeune femme petite et mince, vêtue d’une sorte de tunique à l’antique. Dans un fin visage très blanc brillaient des yeux noirs qui semblaient absorber toute la vie autour d’eux.
– Mon cher ami, tu as entendu parler, naturellement, de Mme Dormier, un de nos premiers sculpteurs féminins ? C’est elle qui a loué la Marbotterie pour l’été.
Certes, Jean connaissait de réputation Mme Irène Dormier. Il avait même admiré, au dernier Salon, une statuette imitée de Tanagra, petite chose exquise de grâce et de beauté frêle. Très sincèrement, il en complimenta l’artiste.
– Oui, elle est jolie, ma petite joueuse de flûte, déclara Mme Dormier. C’est mon chef-d’œuvre. Mais j’avais en ma jeune sœur le plus délicieux modèle qui se pût rêver.
Ils s’étaient entretenus quelques instants de questions d’art, puis Mme Dormier avait quitté de Malay en disant avec un de ces petits gestes gracieux qu’elle prodiguait :
– Nous aurons le plaisir de voisiner, cet été. Ce sera délicieux !
Tel n’était pas l’avis de Jean. Mme Dormier semblait une personne aimable, de conversation agréable, mais sa coquetterie provocante, ses allures fort libres déplaisaient à M. de Malay. De plus, Louis de Carbonnes lui avait appris qu’elle se vantait d’être païenne, de tendances panthéistes très accusées. Puis, encore, il ignorait si cette étrangère était honorable, bien que Mme de Carbonnes s’en portât garante – ce qu’elle faisait pour tout le monde un peu hétéroclite qui fréquentait son salon.
Jean restait donc un peu perplexe sur la possibilité de relations entre elle et les dames de la Varellière – sa grand-mère, Madeleine, si sérieuses, si croyantes, et qui évitaient toujours les contacts pouvant froisser leur délicatesse d’âme et d’éducation.
« Après tout, songea-t-il, elles seront quittes pour lui rendre sa visite et ne plus la recevoir ensuite, au cas où elle leur déplairait trop. »
Il avait pris un sentier qui le rapprochait de la rivière dont l’éclat argenté luisait par instants, entre les feuillages. En approchant d’une maisonnette, il salua la vieille femme assise devant la porte.
– Bonjour, mère Michelette !
– Oh ! bien le bonjour, monsieur Jean.
Elle levait sur lui un regard qui souriait dans le visage d’une laideur repoussante. Cette femme était, pour Jean, la personnification de la douleur sanctifiée, consolée par la religion. Sa vie n’avait été qu’une suite de misères, de rebuts, de malheurs atroces. Maintenant vieille, seule au monde, rongée par son mal incurable, elle vivait dans cette petite maison due à la charité de la mère de Jean et où Madeleine de Malay venait la visiter et la soigner.
Jean, qu’elle avait vu tout petit, était son favori. Lui la vénérait pour ces souffrances si admirablement supportées, pour cette résignation simple et gaie qu’il lui avait toujours connue.
– Vous avez du soleil plein les yeux, monsieur Jean !
Il rit joyeusement à cette phrase qu’aimait à lui dire la mère Michelette, dans son admiration naïve.
– C’est la jeunesse, mère Michelette. Avez-vous vu ma sœur, ce matin ?
– Bien sûr ! Toujours mignonne, Mlle Madeleine. Mais elle ne se marie pas, dites donc, monsieur Jean ? Et vous non plus ? Vous êtes si gentil, pourtant !
Jean rit de nouveau en déclarant qu’il s’en allait parce qu’elle lui faisait trop de compliments. Amicalement, il serra la vieille main ridée et reprit sa route, le long du sentier qui montait maintenant en surplombant la rivière.
À sa droite, une voix féminine s’éleva tout à coup :
– Ne te penche pas tant, Lysis !
Le joli nom grec frappa agréablement l’oreille de Jean. Curieux tout à coup, il s’avança un peu, en écartant doucement le feuillage des arbustes qui poussaient au bord du sentier.
En face de lui, de l’autre côté de la rivière, finissait le parc de la Marbotterie. Deux femmes s’y trouvaient ; dans l’une, assise et occupée à dessiner, il reconnut Mme Dormier. L’autre se tenait debout sur un tronc d’arbre mort, tout au bord de la rivière. Vers l’onde d’un vert pâli, elle penchait un peu son front dont la blancheur ressortait comme celle d’un marbre très pur près de ses cheveux bruns qui tombaient en boucles légères. Jean eut un sursaut d’admiration. Il avait devant les yeux la statue tanagréenne d’Irène Dormier. Mais combien le modèle semblait plus charmant encore, dans sa vivante beauté ! D’ici, il pouvait distinguer ses traits purs, qui ne semblaient pas complètement formés encore, sa taille souple qui se devinait un peu frêle sous la robe blanche très simple. Elle ne devait pas avoir dépassé dix-sept ans. Jean voyait palpiter de longs cils bruns sur des yeux qu’il ne pouvait apercevoir, car ils étaient baissés sur la rivière.
Mais il s’avisa aussitôt qu’il était indiscret et, se reculant, reprit sa route, en songeant qu’il n’était pas étonnant qu’Irène Dormier eût fait ce chef-d’œuvre avec un pareil modèle.
En cinq minutes, il atteignait l’avenue qui conduisait à la Varellière. Celle-ci était une vaste construction solide, brunie par les ans. Son seul aspect, de noble simplicité, rappelait l’existence familiale des ancêtres de Jean, ces de Malay dont leurs paysans disaient : « Ce sont nos bons messieurs. » Ensemble et partageant les mêmes privations, les mêmes périls, maîtres et tenanciers avaient lutté pour leur foi et pour leur roi. Tour à tour, Charette, pourchassé par les républicains, s’était réfugié dans une ferme du pays et à la Varellière. Dans l’une et dans l’autre, « le roi de Vendée » avait trouvé le même accueil, le même dévouement absolu. Et lorsqu’il était tombé plus tard entre les mains de ses adversaires, le vieil Henry de Malay, cloué sur son lit par la paralysie après avoir vu mourir ses trois fils, « ses beaux Chouans » comme il les appelait orgueilleusement, s’était dressé par un suprême effort en s’écriant :
– Ah ! Si nous avions été là !
Tous ces souvenirs, et ceux des nobles femmes dont les vertus s’étaient épanouies entre ces vieux murs, embaumaient la demeure familiale d’un parfum de vertu héroïque et sereine. Jean l’aimait profondément, sa Varellière ; il ne se sentait vraiment tout à fait lui-même qu’à son ombre, dans l’ambiance ancestrale maintenue par son aïeule et sa mère. Non qu’on y dédaignât les commodités modernes et qu’on en fermât la porte aux nouvelles du jour, mais une saine raison, une prudence délicate en éloignaient les effluves dissolvants de certaines opinions et habitudes contemporaines pour y maintenir intactes les traditions, l’intégrité de la race.
En se retrouvant un peu plus tard avec sa grand-mère et sa sœur dans la salle à manger, pour le déjeuner, Jean narra les menus incidents de sa matinée, sans omettre le petit accès de curiosité qui lui avait fait apercevoir Mme Dormier et sa sœur.
– Lysis ? C’est joli, ce nom, dit Madeleine. Mais elle doit être singulièrement élevée, cette pauvre petite, d’après ce que tu nous as dit de sa sœur.
– C’est à craindre. Je ne crois pas du tout que ce soient des relations qui vous plaisent. Mais rien ne vous obligera à les continuer. Puis il est très possible que Mme Dormier m’ait dit cela un peu en l’air et qu’elle ne se soucie guère de faire des visites, car elle vient ici pour se reposer dans le calme de la campagne, après un hiver trop mondain.
– Oui, mais la jeune fille trouvera peut-être cette existence triste. Enfin, nous verrons ! conclut Mme de Malay en secouant sa tête fine qu’encadraient deux beaux bandeaux blancs, où Jean mettait souvent des baisers en disant avec sa gaieté charmeuse :
– Bonne-maman, je veux que ma future femme ait un jour des cheveux comme les tiens.
II
Quelques jours plus tard, en revenant d’une visite au château de Balbennes, Jean rencontra, à l’entrée de l’avenue, Mme Dormier et sa sœur qui se rendaient à la Varellière.
– Ah ! Tant mieux, c’est vous qui allez nous introduire ! s’écria la jeune femme en lui tendant la main.
Il balbutia une phrase aimable, sans trop savoir ce qu’il disait. Deux grands yeux bleus, d’un bleu d’eau profonde, se posaient sur lui. Ce n’était pas leur rare beauté qui le troublait à ce point. Mais il se demandait s’il ne rêvait pas, devant la lumineuse candeur, l’exquise pureté d’âme que semblaient révéler ce regard et tout l’ensemble de cette physionomie, car il s’était figuré tellement autre la sœur d’Irène Dormier !
– Lysis, le vicomte de Malay, ma sœur, Mlle Orlannes.
Le teint blanc de Lysis devint très rose, tandis qu’elle répondait au salut de Jean. Secouant enfin son étonnement, M. de Malay déclara qu’il serait charmé de faire les honneurs de la Varellière aux amies de ses cousins de Carbonnes. Il mit dans ces paroles un peu plus de chaleur qu’il n’eût pensé le faire quelques minutes auparavant. À première vue, Mlle Orlannes lui semblait devoir plaire à sa grand-mère et à Madeleine. De fait, il constata qu’il ne s’était pas trompé, tandis qu’un peu plus tard les deux sœurs se trouvaient assises dans le grand salon de la Varellière, où Mme de Malay et sa petite-fille les recevaient.
Lysis était une jeune fille un peu timide, très gaie, toute simple et candide, parlant peu, mais avec tact et intelligence. De temps à autre, elle couvait d’un regard de tendresse profonde Mlle Dormier qui tenait avec brio le dé de la conversation. Il fut surtout question d’art, de littérature, et Irène eut le bon goût de ne pas heurter sur ce point les idées de ses interlocuteurs en s’en tenant à des considérations générales. Sans être sympathique aux châtelaines de la Varellière, elle ne leur déplut pas outre mesure, ainsi qu’elles le déclarèrent à Jean, après le départ des visiteuses.
– Mais la jeune fille est charmante, de toute façon, ajouta Madeleine. C’est une petite merveille de grâce virginale et de distinction.
Jean approuva.
– Tu as trouvé les termes exacts, Madeleine. C’est inouï de penser qu’elle est la sœur de Mlle Dormier et qu’elle a été élevée par celle-ci.
Irène leur avait appris que Lysis avait un frère jumeau, Hélos. Comme ses hôtes s’étonnaient de ces noms grecs, elle avait déclaré :
– Je suis une admiratrice enthousiaste de la Grèce antique, comme l’était mon père. Quand ces deux enfants naquirent, coûtant la vie à leur mère – celle-ci était la seconde femme de M. Orlannes – nous nous promîmes de les élever selon nos idées, dans le culte de la beauté que comprenaient si bien les Grecs. Mon père mourut peu après, mais j’entrepris seule cette œuvre d’éducation et j’y ai réussi, je crois. Hélos et Lysis sont de vrais Hellènes, ils le sont d’autant mieux qu’un peu de sang grec coule dans leurs veines par leur mère, descendante d’une vieille famille provençale de race très pure.
« Tous deux, depuis leur enfance, ont vécu à Corfou, élevés d’après mes directives par une femme de grande intelligence et d’esprit fort cultivé, qui a terminé sa tâche près d’eux juste au moment où sa santé l’obligeait au complet repos.
Quand les châtelains de la Varellière se rendirent, quelques jours plus tard, chez leur nouvelle voisine, ils virent Hélos Orlannes, un jeune homme d’apparence un peu frêle dont le visage, d’une matité pâle, s’éclairait de longs yeux noirs ardents. Il ne ressemblait pas à sa sœur, mais il avait, comme elle, la grâce innée des attitudes, de la démarche, du moindre geste. Lysis apparut vêtue d’une robe blanche en forme de tunique qui dégageait son cou et ses bras, d’une forme parfaite. Jean dut s’avouer qu’il n’avait rien vu de plus ravissant que cette enfant. Oui, une enfant vraiment, si naturelle, si délicatement gaie, si visiblement innocente et inconsciente de l’effet qu’elle pouvait produire. Elle se tint presque constamment près de Madeleine, qui semblait lui plaire particulièrement et à qui elle demanda avec grâce l’histoire de la Marbotterie. C’était celle de la chouannerie tout entière, car les de Carbonnes, comme les de Malay, avaient lutté intrépidement près de Charette, de Cathelineau, de La Roche-jaquelein. Madeleine prononçait avec une religieuse ferveur les grands noms de l’épopée vendéenne. Mais elle ne trouvait pas d’écho chez les étrangers. Irène et Lysis écoutaient avec intérêt, mais visiblement sans comprendre les sentiments de leur interlocutrice. Celle-ci et Jean et Mme de Malay les sentirent, à ce moment, loin, très loin d’eux. Ce fut, pour Jean, une tristesse dont l’intensité l’aurait surpris, s’il avait pris le temps de l’analyser.
Par contre, la conversation ayant dévié vers l’antiquité, le frère et la sœur se montrèrent documentés à fond sur ce sujet, enthousiastes des civilisations d’autrefois, de celle de la Grèce surtout. Irène avait dit vrai : elle avait fait d’eux des enfants de la vieille Hellade, des adorateurs de la beauté plastique et des divinités païennes. Leur culture intellectuelle, déjà poussée très loin, rappelait celle des jeunes Hellènes d’autrefois. Irène, autant que possible, en avait écarté l’influence latine, déformatrice de la beauté pure, prétendait-elle.
Jean discuta courtoisement avec elle sur ce point, tandis qu’ils faisaient tous une promenade dans le parc très touffu et accidenté. Mais il s’aperçut vite que Mme Dormier n’était pas femme à démordre d’une idée.
– Vous êtes un barbare latin ! lui déclara-t-elle nettement. Un très beau barbare, il est vrai, et c’est ce qui vous vaut mon indulgence. Dans la Grèce antique, on vous eût divinisé. Phidias aurait fait de vous son chef-d’œuvre. Ah ! Qui nous rendra les merveilles de l’art grec, ses lignes pures, sa beauté sobre.
Ses yeux s’animaient, semblaient s’agrandir au point que Jean ne voyait plus qu’eux dans ce mince visage savamment fardé.
– ... Regardez ceci. Évidemment, c’est joli, c’est élégant. Mais auriez-vous l’idée de dire que c’est beau, purement beau ?
Elle se détournait en désignant du doigt la Marbotterie, gracieux logis que recouvraient en partie la verdure et les fleurs.
– La beauté se manifeste sous différentes formes, madame. Vous ne refuserez pas d’en gratifier nos admirables cathédrales, par exemple ?
– Vos cathédrales ? Ce sont de magnifiques monuments barbares, que je n’ai jamais compris.
– Oh ! Par exemple !
– C’est ainsi, je suis irréductiblement antique et païenne. L’idée qui a fait ériger ces monuments me reste étrangère. Tenez, dans cette demeure, pourtant charmante, j’étouffe, je ne me sens pas à l’aise. Ce pays est joli, mais il n’a pas de luminosité, pas d’ardeurs ni de parfums. Paris m’attire par sa civilisation raffinée, ses fêtes de l’esprit et des yeux, mais je l’abhorre pour ses laideurs, son ciel morne. Je n’ai un peu d’amour pour lui qu’en certaines journées printanières ou automnales, lorsque je parcours le Bois dans la beauté lumineuse d’une matinée, d’un après-midi sans nuages. J’ai eu ainsi, parfois, la sensation d’être sous un autre ciel, dans une autre atmosphère. Mais là où je vis vraiment, c’est dans nos contrées méridionales. Je possède là-bas, au-dessus de Cannes, une petite villa, l’« Olivette », quels parfums, quelle ambiance de lumière et de vie ! C’est là que j’ai exécuté mes meilleures œuvres, ma joueuse de flûte en particulier.
Jean, très intéressé par la personnalité qui se dévoilait, demanda :
– Mademoiselle votre sœur partage-t-elle vos goûts ?
– Absolument, de même que Hélos. Je les ai tenus soigneusement éloignés de vos idées latines. Ils ont vécu seuls, sous ma direction, avec leur institutrice qui me comprenait et m’a toujours parfaitement secondée dans mon œuvre. Jusqu’à ces derniers temps, ils ont presque tout ignoré de la vie. Une connaissance trop précoce enlaidit l’enfance et l’adolescence, même physiquement, en en flétrissant la fraîcheur. Je les ai pénétrés de l’amour de la beauté des formes harmonieuses, de la lumière. Lysis est encore un exquis petit flocon de neige, une petite chose rare et charmante. Mais elle a dix-sept ans, je vais maintenant lui révéler la vie.
Jean ne put retenir une protestation.
– Oh ! Madame, attendez encore !
Irène eut un rire amusé.
– Vous trouvez que c’est dommage ? Mais non, chaque chose en son temps. Lysis devient femme ; elle sera très belle, mieux que belle. Toutes les joies du monde et toutes les ivresses de l’amour seront son partage.
Devant eux marchaient Hélos et sa sœur, près de M. de Malay et de Madeleine. Un rire frais, un rire d’enfant, s’échappait à ce moment des lèvres de Lysis. Jean eut le cœur serré en songeant que cette innocence heureuse n’avait plus que peu de temps à vivre.
Irène continuait :
– Ces enfants ignorent tout de vos sombres croyances qui divinisent la souffrance et la misère,
Qui réprouvent les joies de ce monde. Ils adorent l’âme des choses, les parfums, les fleurs, la lumière, la beauté, la vie. Oh ! La vie surtout, la vie dans toute son ardeur, dans toute sa plénitude ! Oh ! Vous la verrez dans quelques années, ma Lysis, et vous me direz si je n’ai pas fait d’elle un chef-d’œuvre.
Jean la regardait, un peu saisi devant cette exaltation qui faisait étinceler les yeux sombres. Il objecta :
– Mais dans tout cela, que deviennent la mort, les souffrances inévitables ?
– Les souffrances ? La mort ? Mais on se délivre des premières par la seconde quand on n’a pu réussir à les éviter. La mort volontaire, une mort douce, sans angoisse, entre tout à fait dans mes principes.
– Et vous avez inculqué celui-là à ces enfants ?
La voix de Jean vibrait d’indignation.
– Certes ! Je vous scandalise, monsieur le Chouan ? Voyons, vous figurez-vous ma jolie Lysis torturée par quelque maladie incurable, souffrant sans espoir ?
– Je me figure surtout son âme, dit gravement Jean. Nous autres, nous avons en vue une existence future, après nos épreuves terrestres.
Irène laissa échapper un rire bref.
– L’âme ? J’ignore si nous en avons une. En tout cas, je ne m’en préoccupe pas.
– Vous croyez que Mlle Lysis n’a pas d’âme ?
La jeune femme rit de nouveau.