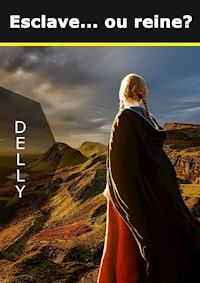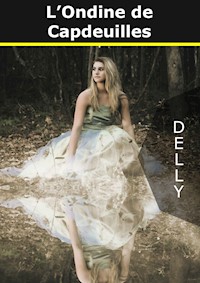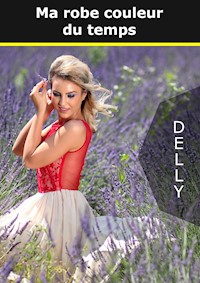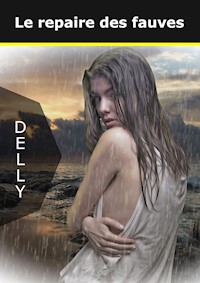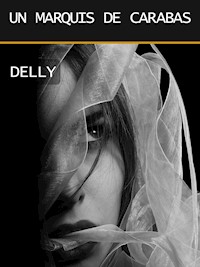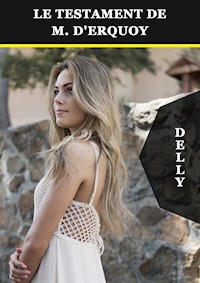2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Voici la dernière oeuvre de la célèbre romancière. D'un ton assez différent de celui de ses autres ouvrages, il nous raconte la tragique histoire de la famille Malereyne, au lendemain de la guerre de 1870. Sur cette famille pèse une sorte de malédiction, qui a voué au crime plusieurs de ses membres. Le dernier de ces meurtres sera commis par Franceline, qui tuera sa soeur jumelle Allys pour se substituer à elle auprès de son mari. Lorsque celui-ci découvrira le crime, après avoir épousé la meurtrière, il se résignera à ne pas briser son nouveau foyer, mais ce souvenir atroce continuera de peser sur les deux époux.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Malereyne
Pages de titrePremière partieIIIIIIVVVIVIIDeuxième partieII - 1III - 1IV - 1V - 1VI - 1VII - 1VIIIIXXXIPage de copyrightDelly
Malereyne
Première partie
I
La petite ville de Rocamore était bâtie sur une falaise rocheuse qui dominait la lente rivière aux belles eaux claires, vers laquelle se penchaient les saules et les yeuses. Une partie des remparts qui l’entouraient jadis subsistait encore, du côté de la basse ville, où se dressaient aussi les deux tours de la porte de l’Horloge. D’antiques demeures, la vieille église mi-romane, mi-ogivale, les halles aux belles voûtes avaient échappé aux saccages des luttes entre seigneurs rivaux, des guerres de religion, du vandalisme révolutionnaire. Très vieille cité, qu’avait précédé un oppidium romain si l’on en croyait les archéologues périgourdins. Et l’un d’eux disait même que ce sol rocheux, creusé de souterrains où se réfugiaient autrefois les habitants de Rocamore lors des sièges, devait recéler des habitats préhistoriques. Mais personne, dans la ville, ne s’intéressait à ce très lointain passé. Les gens de Rocamore aimaient leurs vieilles pierres, leurs jardins riches en fleurs et en fruits et ne s’en éloignaient guère, ou du moins pour peu de temps. Au reste leur existence, en ce milieu du XIXe siècle, ne différait guère de celle que menaient leurs aïeux des siècles précédents, sinon qu’ils utilisaient parfois le chemin de fer pour aller à Périgueux ou, beaucoup plus rarement, pour faire un court séjour à Paris ou à Bordeaux.
Dans la rue des Fontaines s’élevait un très grand logis, bâti en longueur, avec un étage surmonté de hauts toits. Ses fondations dataient des premiers temps du moyen âge, assurait-on. Sur ses murs épais, les siècles avaient passé sans aucun dommage. Sa physionomie extérieure restait la même que jadis. La porte cochère avait toujours son lourd marteau de bronze représentant une tête d’homme barbu, et plus loin le vantail d’une autre porte, sous une petite voûte cintrée, conservait ses clous soigneusement polis par la main diligente d’un serviteur.
On appelait ce logis la maison Malereyne. Il appartenait à une famille dont les origines se perdaient en un lointain nébuleux. Un jour – dans les environs de l’an 1000, disait-on – un homme était arrivé dans ce pays, portant un petit enfant. Il avait voyagé jusqu’aux contrées des bords du Danube, y avait épousé la souveraine d’un royaume barbare. Mais cette femme, cruelle et dissolue, ayant attenté à sa vie, il s’était enfui, emportant son fils. Celui-ci, en grandissant, avait révélé chez lui la nature maternelle. On l’avait surnommé « le fils de la mauvaise reine » et ce nom, Malereyne, était devenu celui de ses descendants. Ces Malereyne du temps passé avaient acquis de grands biens, par le négoce, par de riches mariages et aussi, prétendait-on, par de fructueuses affaires réalisées avec les gens de guerre après le pillage des villes assiégées. Dans Rocamore, ils étaient des personnages, exerçaient des fonctions honorifiques. Aujourd’hui encore, la famille Malereyne occupait le premier rang dans la petite cité.
La maison de la rue des Fontaines était divisée en deux logis. Dans l’un – celui où l’on accédait par la porte cochère – habitait Mlle Victoire Malereyne avec la veuve et le fils d’Augustin, l’aîné de ses neveux. L’autre appartenait à une seconde branche de la famille, les Malereyne de Corbac, ainsi surnommés comme possesseurs, depuis le XVIe siècle, d’une seigneurie dans le Sarladais. M. Jérôme de Corbac y résidait avec sa femme, née Fanny de Carsignan, appartenant à une vieille famille noble du Rouergue.
Il existait au premier étage, dans le fond d’un couloir, une porte faisant communiquer les deux maisons. Au cours des temps, il était survenu plus d’une fois un refroidissement dans les rapports entre cousins, voire même quelque brouille plus ou moins grave. La porte restait alors obstinément close. En dehors de ces périodes qui ne duraient guère, les Malereyne ayant au plus haut point l’esprit de famille, les deux logis avaient coutume de voisiner par cette voie, ou par les jardins que séparait seulement une grille légère.
Or, ce matin de mai 1872, le marteau retentit sous la poussée d’une main vigoureuse. Jude, le domestique, ouvrit et dit paisiblement :
– Ah ! c’est Monsieur David.
Jude ne s’étonnait jamais de rien. Il avait un placide visage, des yeux sans expression sous des paupières sans cils, un grand front dénudé, un peu bosselé. Il était au service des Malereyne depuis quarante ans et obéissait aveuglément à Mlle Victoire seule, tenant pour négligeable Mme Augustin Malereyne, la veuve.
– Eh oui, c’est moi, Jude ! dit l’arrivant. C’était un homme jeune encore, d’assez petite taille, mais svelte, bien pris dans un élégant costume de voyage. Ses yeux très vifs dans le visage au teint de blond considéraient le domestique avec une sorte d’indulgente ironie.
– Rien de nouveau ici ? Mademoiselle ma tante est toujours ferme au poste ?
– Mademoiselle est toujours la même.
Sur cette réponse, faite avec dignité, Jude s’effaça pour laisser entrer l’arrivant.
– Servez-moi quelque chose, Jude. Je n’ai encore rien pris ce matin.
– Bien, Monsieur. M. Denys est dans la salle à manger.
Sur cette indication, Jude disparut vers l’office. David Malereyne s’avança sous la voûte, gravit deux marches et se trouva dans un vestibule voûté où s’amorçait le grand escalier de pierre sans tapis. À gauche, il ouvrit une porte et se trouva dans la salle à manger.
Elle était très vaste, ouvrant par trois fenêtres sur le jardin. Devant la grande table de chêne se trouvait assis un petit garçon de neuf à dix ans. Il se leva et vint à David en disant :
– Bonjour mon oncle.
David lui prit la main et sourit aux beaux yeux gris, calmes et rêveurs.
– Toi non plus, Denys, tu n’as pas l’air étonné de me revoir si tôt, alors que j’avais annoncé une longue absence ?
– Cousine Fanny dit que vous êtes la fantaisie même et qu’on ne sait jamais quelle idée vous passera par la tête.
Une légère rougeur colora le teint clair de David.
– Elle va bien, cousine Fanny ?
– Elle a été un peu malade, mais elle va bien maintenant. Et les petites filles aussi.
– Les petites filles ?
– Oui, les jumelles. Elles sont là depuis deux mois. Vous verrez comme elles sont jolies, mon oncle.
– Ah ! des jumelles... Oui, en effet...
Machinalement, David s’assit. Devant lui, sur la grande table de chêne bien cirée, il n’y avait qu’une tasse vide. Par une porte-fenêtre ouverte entrait un air presque froid.
– Voulez-vous que je ferme, mon oncle ? demanda Denys.
– Non, non, je suis habitué... Elle est contente, cousine Fanny ?
– Oh ! très contente ! Mais il paraît que cousin Jérôme aurait voulu avoir un petit garçon.
La ride légère qui s’était formée sur le front de David, s’accentua encore. Une sorte de rictus tordit sa bouche.
– Celui-là, quand il sera satisfait de quelque chose... Et pourtant...
Les traits fins se contractèrent pendant quelques secondes. Les doigts nerveux se mirent à tapoter la table.
– ... Il est ici en ce moment ?
– Non, il est à Corbac. Il y a quelque chose qui ne va pas.
David fit entendre un petit sifflotement d’ironie.
– C’est l’habitude. Ne nous en étonnons pas... Et ici, tout va bien, m’a dit Jude ?
– Mais non, mon oncle. Maman a été malade et elle n’est pas bien encore. Le médecin dit qu’il lui faudrait une cure à Capvern dans les Pyrénées. Mais tante Victoire trouve que ce n’est pas nécessaire.
– Ah ! Ah ! Plus forte que les médecins, plus forte que tout...
David ricanait légèrement.
– Ce ne sont pourtant pas les excès de table qui ont pu détraquer le foie de ta mère. Il n’y a rien à craindre ici sur ce point... Et toi, tu n’as pas très bonne mine, petit.
Il considérait ce visage enfantin qui lui ressemblait, avec les mêmes traits fins, lesquels eussent paru presque efféminés sans le menton et la bouche très fermes, très volontaires. Le regard seul différait : vif, hardi, parfois presque dur chez l’oncle, plein de rêve et de mystérieuse douceur chez l’enfant.
– Je me porte pourtant bien, mon oncle. Tante Victoire dit que ma santé permettra de me mettre au collège l’année prochaine, pour ma première communion.
À ce moment, une porte fut ouverte et sur le seuil parut une femme de petite taille, assez replète. Son visage à la peau encore lisse et fraîche gardait des restes d’une beauté sans grâce. Ses cheveux gris disparaissaient en partie sous une coiffure de tulle noir garnie d’un ruban gris. Sur la robe de lainage noir ornée d’un col et de poignets en fine toile blanche était attaché un tablier de soie à la ceinture duquel pendait un trousseau de clefs.
David se leva, alla vers elle, baisa la main potelée qu’elle lui tendait.
– Me voici de retour, ma tante...
– Quelle mouche t’a piqué ? Tu pars soi-disant pour un an et tu nous reviens au bout de six mois.
La voix était sèche, le regard sans aménité. Sous ces yeux bleus, semblables à une eau glacée, qui le dévisageaient, David baissait les siens, mal à l’aise comme lorsqu’il était petit garçon. Malgré son caractère frondeur, il trouvait toujours désagréable d’affronter la tante Victoire.
– Me faites-vous un reproche de rentrer plus tôt au bercail, ma tante ?
– Oh ! le bercail ne te tient guère au cœur, je crois ! Tu avais sans doute un intérêt quelconque qui te rappelait par ici.
David contint un tressautement. Il baissa un peu les yeux. Mlle Victoire était douée d’une perspicacité qui la rendait redoutable lorsqu’on avait à dérober quelque secret.
– Quel intérêt voulez-vous que j’aie, ma tante ? Mais les voyages commencent à me fatiguer...
– Ce ne serait pas trop tôt. Bien qu’à vrai dire, je me demande à quoi tu t’occuperais ici... Jude m’a dit que tu n’avais pas déjeuné ?
– C’est exact. J’ai une faim de loup.
– Nanon va t’apporter du lait.
– Et quelque chose avec, ma tante ? J’ai fait hier soir au buffet de Dijon un abominable dîner.
– Rien du tout. Tu attendras à onze heures. Un peu de diète ne te fera que du bien... Denys, n’oublie pas que tu as ce matin ta leçon de dessin.
– Oui, ma tante, j’y pense bien.
Mlle Victoire sortit, et presque aussitôt parut une femme d’une quarantaine d’années aux pâles cheveux blonds encadrant un long visage osseux. Son corps maigre flottait dans une vieille robe grise que protégeait un tablier de mérinos noir. Elle portait un petit plateau qu’elle déposa sur la table tout en disant :
– Bonjour David.
Il répondit distraitement.
– Bonjour Nanon.
D’un coup d’œil, il inspectait le plateau. Puis il saisit l’anse d’un petit pot d’argent.
– Quoi, c’est tout ce que vous me donnez de lait ?
– Il ne reste que cela, David.
La voix était monocorde et les yeux trop clairs avaient une expression de morne indifférence.
– Et pas de café ?
– Il n’en reste pas non plus.
David ricana.
– Elle a raison, tante Victoire, c’est la diète complète. Ce n’est pas dans cette maison que la ruine entrera !... Enfin !
Il s’assit de nouveau, versa le lait dans une tasse en porcelaine ancienne, y mit le morceau de sucre déposé sur une soucoupe.
– Et sans doute ne reste-t-il pas autre chose que ce croûton de pain ? demanda-t-il ironiquement.
– En effet. Clémence n’est pas encore allée chez le boulanger.
– Très bien. Mais ledit boulanger est à deux pas et elle aurait pu aller chercher quelques petits pains pour le voyageur affamé.
– Ma cousine n’en a pas donné l’ordre.
Sur ces mots, Nanon quitta la pièce d’un pas mou, glissant, qu’on n’entendait jamais. Elle était la fille d’une cousine des Malereyne qui s’était mésalliée – selon le code de la famille – en épousant un professeur de musique issu de la petite bourgeoisie. Orpheline vers sa douzième année, sans fortune, Nanon avait été recueillie par les Malereyne. Elle était un peu faible d’esprit ; du moins Mlle Victoire l’avait décrété ainsi devant l’enfant effarée, craintive jusqu’au tremblement, qui avait comparu devant elle le jour de son arrivée. Le joug qui depuis ce moment pesait sur elle n’avait pu contribuer à éveiller une intelligence déficiente. Annihilée par une crainte continuelle, Nanon accomplissait en automate, avec une adresse naturelle, les tâches que lui assignait Mlle Malereyne. Mais il était inutile de lui demander une initiative quelconque.
David Malereyne soupira en agitant la cuiller dans sa tasse.
– Ah ! on ne peut pas dire qu’on est accueilli ici comme l’enfant prodigue ! Qu’est-ce que tante Victoire pense faire de tout cet argent qu’elle économise ? Tu n’en auras pas besoin, Denys, ta fortune étant suffisante sans cela. Alors, quoi ?
Il saisit sa tasse, but d’un seul coup, s’essuya les lèvres avec une petite serviette de fine toile. Puis son poing frappa la table, faisant sursauter Denys qui écoutait rêveusement.
– Je dis, mon petit, que l’avarice est le plus abominable de tous les vices !
– Vous avez raison, mon oncle, répliqua sérieusement l’enfant. Aussi je ne serai jamais avare, je vous le promets.
David lui jeta un coup d’œil de côté, accompagné d’un sourire narquois.
– On a pourtant dû te faire la leçon à ce sujet ? T’engager à ne pas m’imiter, moi, le dépensier, le gaspilleur ?
Denys sourit aussi, un fin sourire, teinté de malice.
– Bien sûr, mon oncle. Mais il me semble que vous avez raison de ne pas conserver tout votre argent dans un coffre, sans qu’il profite à personne.
– Très bien, jeune sage ! Au moins, j’entends ici une parole sensée. Qui a dit que la vérité parle par la bouche des enfants ?
David riait. Il se leva d’un mouvement vif.
– Et maintenant, je vais au Lion couronné avaler une bonne tasse de chocolat et quelques petites choses avec. Tu pourras le dire à tante Victoire, Denys, si elle te demande où je suis.
II
Julien Malereyne était doué d’une bonne dose de volonté, mais il avait trouvé plus fort que lui en sa sœur Victoire. Dès leur jeunesse, elle l’avait dominé et plus tard, dans l’âge mûr, il n’eût pas accompli un acte de quelque importance sans lui demander conseil. C’est ainsi qu’il avait légué à son fils Augustin, outre la maison de la rue des Fontaines, la plus grande partie de sa fortune, ne laissant à David que sa part légale. Car David n’avait jamais bien accepté l’autorité despotique de sa tante, et c’était là une chose qui ne se pardonnait pas.
Mlle Victoire régnait donc dans cette maison en souveraine maîtresse, depuis près de quarante ans. Elle avait la clef des armoires et sa nièce, la veuve d’Augustin, ignorait tout des trésors en linge, argenterie, porcelaine qu’elles contenaient. Des grands dîners d’autrefois, elle ne laissait subsister que celui de Noël où étaient invités le curé, ses vicaires, les meilleures familles de la ville. En cette occasion, elle ne regardait pas à la dépense. Il s’agissait de maintenir le prestige de la famille. Les autres jours de l’année, un certain décorum existait pour les repas. Jude, en veston noir et gants blancs, servait dans des plats d’argent les mets généralement bien préparés mais en quantité insuffisante. Mlle Victoire, en robe de soie noire, un bonnet de dentelle noire sur ses cheveux, présidait ayant en face d’elle son neveu David ou, quand celui-ci était absent, son petit-neveu Denys.
Au second coup de cloche, ce matin-là, elle entra dans la salle à manger où David, près de la fenêtre, causait avec sa belle-sœur tandis que Denys, un peu plus loin, s’amusait avec un jeune chat.
– Laisse cette bête, mon enfant ; mets-la dehors. Je crois t’avoir déjà dit que je ne voulais pas la voir ici.
Le ton était impératif, mais avec une certaine atténuation qui n’existait pas quand Mlle Victoire s’adressait à quelqu’un d’autre. Denys était le seul être pour qui elle parût éprouver quelque affection, le seul qui bénéficiât d’une certaine indulgence de sa part.
On prit place à table et Jude présenta un plat de légumes garni de quelques minces tranches de viande. Nanon, entrée silencieusement, avait pris place au bout de la table. Mme Malereyne, à la droite de son beau-frère, lissait d’un geste machinal le plissé de tulle blanc qui ornait sa robe de veuve.
– Vous ne mangez pas, Josèphe ? dit Mlle Victoire d’un ton réprobateur.
– Non, ma tante. J’ai eu encore une crise de foie cette nuit, répondit une voix douce et fatiguée.
– Ne vous en tourmentez pas, cela passera tout seul, quoi qu’en prétende cet âne de Brillon. Vous faites bien de vous mettre à la diète ; c’est le mieux dans ce cas.
– Si vous pouviez nous y mettre tous, ma tante, vous seriez ravie, dit David avec un petit rire sarcastique.
– C’est un excellent remède, répliqua sèchement Mlle Victoire. Il vaut mieux que toutes les drogues des médecins. Dans le cas de Josèphe, c’est bien ce qu’il faut.
David glissa un regard dubitatif vers la jeune femme maigre, au teint un peu jaune. En dépit de son égoïsme, il avait pitié d’elle, tout en blâmant secrètement la faiblesse qui la faisait plier devant toutes les volontés de Mlle Malereyne.
Jude posait devant Denys une aile de poulet. L’enfant bénéficiait d’un régime spécial. Lui aussi regarda sa mère puis leva les yeux sur Mlle Victoire.
– Peut-être que maman pourrait supporter un peu de poulet, ma tante ? Moi, je mangerai comme tout le monde.
– Le docteur déconseille la viande pour elle.
– Mais il conseille Capvern, dit David tout en attaquant sa légère tranche de bœuf.
– Qui est-ce qui t’a raconté cela ? demanda Mlle Victoire.
– C’est Denys. Mais il paraît, ma tante, que vous avez décrété l’inutilité de cette cure.
– En effet. Josèphe peut très bien guérir ici, en suivant un régime approprié. Brillon est très fort pour faire voyager. L’année dernière il voulait envoyer à Bourbonne Mme Lechâtel. Mais elle a refusé d’y aller et elle ne s’en porte pas plus mal.
– Si, ma tante, elle souffre beaucoup et elle partira pour Bourbonne dès que la station sera ouverte. C’est Léon qui me l’a dit hier.
Denys donnait cette information de sa voix tranquille. Mlle Victoire fronça un peu ses minces sourcils blonds.
– Eh bien ! cela la regarde, si elle veut gaspiller son argent en voyages et en traitements inutiles... Jude, dites à Clémence que ces légumes sont trop beurrés. Le docteur ne permet le beurre qu’en très petite quantité pour Mme Augustin.
David eut un sourire en coin.
– Eh bien, alors, qu’est-ce qu’elle va manger, cette pauvre Josèphe ?
– Ne t’en inquiète pas, elle ne mourra pas de faim. D’ailleurs, elle n’a pas d’appétit.
– C’est vrai, je n’en ai pas, dit la voix lasse de la jeune femme.
– Ce n’est pas une raison pour vous laisser tomber d’inanition, ma chère... Jude, un peu de pain, s’il vous plaît.
Mlle Victoire eut un coup d’œil inquisiteur vers la corbeille que le domestique présentait à David. De nouveau, ses sourcils se froncèrent en voyant la main de son neveu saisir les deux morceaux de pain qui y restaient. Cependant, elle ne dit rien et se mit à découper sa viande. Il y eut un assez long silence. Puis Josèphe demanda, s’adressant à son beau-frère :
– Savez-vous que Fanny a des jumelles ?
– Denys me l’a appris.
– Elle est enchantée. Mais Jérôme l’est moins. Il désirait un fils.
La voix sèche de Mlle Victoire s’éleva :
– Ces enfants seront de petites pauvresses, car du train dont vont leurs parents, c’est la ruine à brève échéance. Corbac ne rapporte à peu près rien depuis que Jérôme s’en occupe et Fanny dépense sans compter. À tout moment ce sont des réceptions, des dîners. Et les toilettes, et ce changement d’ameublement... Une ruine, enfin, pour Jérôme, ce fou qui a épousé cette femme sans fortune.
– Il a préféré la beauté à l’argent dit David.
Sa bouche avait une crispation légère et ses paupières, pendant un instant, dérobèrent son regard.
Mlle Victoire eut une moue de mépris.
– Belle affaire ! Et puis une jolie femme est presque toujours coquette et légère ; je ne me fierais pas à Fanny.