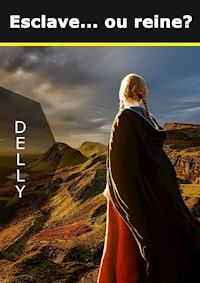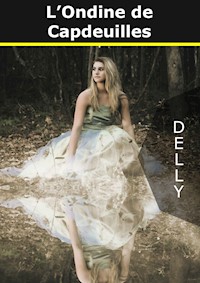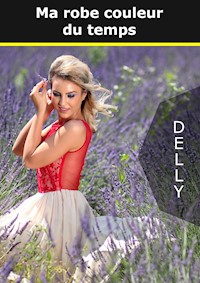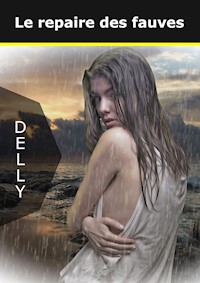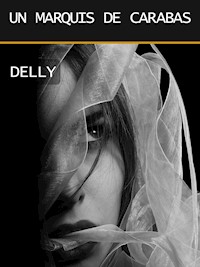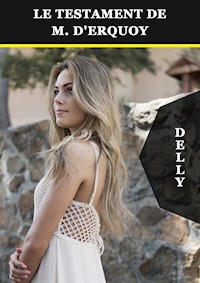2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Il serait difficile d'imaginer famille plus unie et plus heureuse que celle de maître Arzen, le no-taire de Losbéleuc, en Bretagne. Mais cette uni-on affectueuse et ce bonheur paisible risquent un beau jour d'être compromis. Est-ce par le retour des habitants de la demeure voisine, les Rodennec? N'est-ce-pas plutôt par l'arrivée d'une cousine orpheline, Moussia, accueillie comme une fille et comme une soeur après la mort de son père? Moussia pourtant se montre charmante, pleine d'attention et de dévouement. Mais son cousin Tugdual, dit Tug, observe, avec méfiance, le moindre de ses gestes... Car il pressent qu'un jour peut-être, à cause d'elle, un drame éclatera..
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sainte-Nitouche
Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVPage de copyrightDelly
Sainte-Nitouche
I
La famille Arzen
Losbéleuc est une petite ville bretonne joliment située au bord d’une rivière très claire et entourée de bois jusqu’ici épargnés par la cognée dévastatrice qui dénude impitoyablement tant de nos plus belles contrées. C’est aussi une très vieille ville, extrêmement fière de son ancien quartier, où les rues étroites n’ont pas un pavé égal à l’autre, où les maisons, datant du règne de la duchesse Anne, offrent au touriste archéologue, ou simplement curieux du passé, ample matière à étude et à observations.
L’église, très sombre, est un curieux spécimen d’architecture du temps, le pont qui enjambe la rivière en est un autre. Ici, c’est une tourelle travaillée comme une dentelle de pierre ; là, une fenêtre à meneaux qui fait tressaillir d’admiration les connaisseurs ; plus loin, une vénérable fontaine qui porte les armes de Bretagne.
Il n’est pas jusqu’à l’herbe poussant entre les pavés, jusqu’à la moisissure verdâtre couvrant certains des vieux logis, jusqu’aux délicieux jardins livrés à eux-mêmes et dévalant, en luxuriantes vagues de verdure échevelée, vers la paisible rivière, qui n’ajoutent à l’ancien quartier une note de pittoresque et d’archaïque poésie.
Losbéleuc a aussi un quartier neuf, près de la gare – une jolie gare blanche qui voit descendre peu de voyageurs, la petite ville n’offrant d’attraits qu’à ceux que le passé attire.
Le mot neuf doit s’entendre ici comme terme de comparaison, car la plupart des demeures qui composent ce quartier, pour n’avoir pas eu l’honneur de voir le règne de la bonne duchesse, n’en sont pas moins assez vénérables. Tel, entre autres, se présente le logis de maître Arzen, principal notaire de Losbéleuc, une bonne vieille maison sans prétentions architecturales, où toute la nichée trouve largement à se caser, où l’air et le jour circulent librement dans les grandes pièces auxquelles on n’a pas ménagé les fenêtres.
Une famille charmante, ces Arzen. Sept enfants, fort bien élevés par des parents très tendres et très fermes à la fois. De plus, une bonne-maman que chacun vénère.
Ajoutons-y encore la vieille Jeanne-Marie, la cuisinière, grondeuse souvent, mais qui se jetterait au feu pour « ses enfants ».
... En cette fin d’après-midi de mars, un peu pluvieuse et très fraîche, Mme Arzen et sa belle-mère travaillaient dans le salon, près d’un joli feu de bois. C’était un salon très simple, aucunement moderne. Les deux femmes l’avaient orné d’ouvrages de tapisserie et de broderie, avant que la venue successive des enfants ne leur enlevât le loisir de travaux de ce genre. Maintenant, il fallait raccommoder, rallonger, faire des costumes pour le petit Pascal qui avait huit ans, des robes pour Josèphe, la petite dernière. Le notaire possédait une sérieuse clientèle, mais l’économie était néanmoins nécessaire avec cette nombreuse famille. Les Arzen vivaient donc très simplement, ce qui ne les empêchait pas de vivre fort heureux, parce qu’ils se contentaient de leur sort, sans songer à envier la fortune d’autrui ; parce que, aussi, ils étaient tous parfaitement unis.
Dans un coin du salon, Pascal jouait avec la petite Josèphe qui venait d’atteindre ses cinq ans. Pascal était aveugle – et c’était là la dure épreuve de la famille. On n’aurait pu rêver un plus délicieux enfant. Ses cheveux blonds, qui ondulaient naturellement, encadraient un fin visage presque toujours souriant, car Pascal était la gaieté même et on n’aurait pu croire, au premier moment, que ces grands yeux bleus si beaux fussent incapables de voir. Avec cela, le petit garçon possédait le plus charmant caractère du monde, joint à un petit cœur très tendre qui s’attachait profondément.
– Pascal, mon chéri, va demander une lampe, dit Mme Arzen. Je crois qu’Armelle nous oublie.
L’enfant se leva et, sans hésiter, s’en alla vers la porte. Il l’ouvrit, fit quelques pas dans le corridor et, rentrant dans le salon, s’approcha de sa mère, dont il entoura câlineraient le cou de son bras.
– J’entends Armelle qui vient, maman.
Une lueur apparaissait dans le corridor.
Bientôt, une jeune fille apparut, portant une lampe qu’elle posa sur la table près de laquelle travaillaient Mme Arzen et la grand-mère.
– Je suis un peu en retard, dit une voix harmonieuse. Mais la pauvre Jeanne-Marie a tellement mal à la tête que j’avais entrepris de faire la mayonnaise et voilà qu’elle a imaginé de tourner...
– Qui ça ? Jeanne-Marie ?
L’interrupteur était un jeune garçon d’une quinzaine d’années, robuste et bien découplé, les cheveux roux rasés, le visage énergique, singulièrement intelligent, un peu narquois. Il apparaissait au seuil de la porte, portant d’une main une serviette d’écolier et tenant de l’autre la casquette qu’il venait d’enlever dès le seuil de la porte pour saluer sa mère et sa grand-mère.
La jeune fille eut un joli rire clair qui montra les plus charmantes petites dents du monde.
– Naturellement, dès que Tug est rentré, on est sûr d’entendre quelque malice ! Et Jean, qu’en as-tu fait ?
– Présent ! dit une voix flûtée.
Entre Tugdual et le chambranle de la porte apparut une tête blonde, un mince visage futé où brillaient des yeux rieurs.
– Montez vite vous changer, mes chéris, dit Mme Arzen. En passant, Tug, dis à Marion qu’elle a suffisamment travaillé aujourd’hui et qu’elle vienne nous rejoindre.
– J’y vais, maman. Mais elle va me faire la grimace, dame Sapience.
Tugdual, le pince-sans-rire de la famille, avait ainsi surnommé sa sœur Marion, une fillette de quatorze ans acharnée à l’étude et qui tenait toujours la tête de sa classe à la pension Cordier.
Armelle, ouvrant la porte qui communiquait avec la salle à manger, se mit en devoir de mettre le couvert. Peu après, Marion vint la rejoindre.
Les deux sœurs ne se ressemblaient aucunement.
L’aînée, fine et svelte, avait un délicieux visage rosé, aux grands yeux bleu foncé profonds et très doux, et une chevelure brun doré, souple et vaporeuse, qui faisait bien des jalouses à Losbéleuc. Marion, seule de la famille, avait des cheveux noirs et un teint de gitane. Elle était longue et dégingandée, pas belle du tout, comme le lui déclarait souvent Tug. C’était la période de l’âge ingrat. Marion avait, en outre, le caractère un peu difficile et une assez bonne dose d’amour-propre. Mais le cœur était bon et elle aimait fortement tous les siens.
À la porte du salon, la voix de M. Arzen se fit tout à coup entendre :
– Maman, Hélène, voulez-vous venir un instant dans mon cabinet ?
Bonne-maman et sa belle-fille quittèrent le salon, tandis qu’Armelle et Marion échangeaient un regard inquiet.
– Y a-t-il une mauvaise nouvelle ? murmura Armelle. La voix de papa était toute changée. As-tu remarqué, Marion ?
Marion fit un signe affirmatif. Avec des gestes plus lents, les deux sœurs continuèrent leur tâche. Puis elles revinrent dans le salon au moment où y apparaissaient Tugdual et Jean en vêtements d’intérieur.
– Tiens ! maman et bonne-maman ont disparu ! s’exclama Tug. Je voulais leur annoncer bien vite que j’avais fait une composition d’un chic !
Et il fit claquer ses doigts.
– Elles sont occupées toutes deux avec papa... Jean, va dire à Jeanne-Marie qu’elle ne se presse pas de servir.
Jean, un garçonnet d’une douzaine d’années, maigre et nerveux, feignit un air épouvanté.
– Elle va me dévorer, Armelle. Elle était déjà, ce matin, comme le pire des crins et m’a envoyé promener quand j’ai été lui demander bien gentiment un œuf à gober.
– C’est qu’elle a un grand mal de tête, mon petit. Va la prévenir et ne t’occupe pas de sa mauvaise humeur.
– Ah ! oui, il s’en moque un peu de sa mauvaise humeur ! s’exclama Tug en riant. Et moi aussi, du reste. Jeanne-Marie est une vieille bougon, mais on sait ce qu’il y a derrière ses airs méchants.
– J’aime bien Jeanne-Marie, dit gravement Pascal.
– Ah ! je crois bien, tu es son chouchou, toi, frérot !
Et Tugdual, enlevant son frère entre ses bras, lui mit sur chaque joue un retentissant baiser.
– Et moi ! Et moi ! cria la petite Josèphe en accourant, son nez levé et ses boucles blondes flottant autour d’un visage mutin.
– Deux baisers pour toi aussi, Josie ! pas de jaloux ! D’abord, ça n’existe pas chez nous, cette espèce-là.
– Non, grâce à Dieu ! dit Armelle tout en s’asseyant et en attirant à elle un ouvrage commencé.
Les minutes s’écoulaient ; l’heure du dîner était passée, et les parents n’apparaissaient toujours pas. Armelle travaillait ; Marion, qui évitait autant que possible l’ouvrage à l’aiguille, qu’elle n’aimait pas, feuilletait un livre déjà lu vingt fois ; Tug taquinait sa petite sœur ; Jean faisait à Pascal le portrait de son professeur d’allemand.
Enfin, M. Arzen et sa femme apparurent. Ils semblaient tous deux tristes et soucieux.
– Allons, à table, enfants ! dit le père.
Jeanne-Marie apporta la soupière.
Mme Arzen servit la soupe, une pleine assiette pour chacun. Mais le père prévint :
– Très peu pour moi, Hélène.
Et, voyant les regards inquiets qui se levaient vers lui après s’être arrêtés sur la place de l’aïeule, il dit avec tristesse :
– J’ai reçu tout à l’heure une dépêche m’annonçant la mort de votre oncle Gustave. Bonne-maman et moi allons partir tout à l’heure pour Paris.
L’oncle Gustave !... Personne ne le connaissait. Les aînés savaient seulement que c’était un frère cadet de leur père, cerveau brûlé, qui, sous prétexte de vocation artistique avait déserté de bonne heure le foyer familial et avait épousé, à vingt-cinq ans, une Russe, artiste lyrique de second ordre dans un théâtre parisien. Sept ans plus tard, sa femme était morte, lui laissant une petite fille. Mais jamais il n’avait cherché à se rapprocher de sa famille. À l’époque de son mariage, son frère aîné lui avait adressé des reproches qu’il n’avait jamais pardonnés. Sa mère elle-même ne recevait jamais de ses nouvelles, et bien souvent la pauvre bonne-maman avait versé des larmes brûlantes en priant pour le fils prodigue.
Maintenant, elle n’aurait plus que la triste consolation de l’embrasser sur son lit de mort.
– Pauvre bonne-maman ! dit Armelle les larmes aux yeux. Quel pénible voyage pour elle !... Et pour vous aussi, papa.
– Oui, car je n’ai jamais cessé d’aimer ce malheureux ingrat. Comment est-il mort ? Qui l’a entouré à ses derniers moments ?... Et quelles nouvelles tristesses, peut-être, nous réserve sa fille ? Elle a dû être singulièrement élevée, la pauvre enfant !
– Quel âge a-t-elle, papa ?
– Dix-huit ans, il me semble, comme toi, ma chérie... Jeanne-Marie, apportez-moi vite des légumes, un peu de fromage. Il faut encore que je donne mes instructions à Camélieu avant de partir. Armelle, regarde donc l’heure exacte du train... Jean, tu iras chercher ma valise.
– Je te la préparerai, ne t’occupe de rien, Robert, dit Mme Arzen. Et je vais monter pour aider la pauvre maman.
– Je vais y aller, voulez-vous, maman ? proposa spontanément Marion, qui n’aimait pourtant guère à se déranger.
– Non, mignonne, car j’ai à parler à bonne-maman... Tâche de manger un peu, Robert, tu auras besoin de forces, là-bas, pour t’occuper des tristes détails.
– Oui, je vais me forcer... Tug, je te charge d’écrire à François pour lui faire part de ce deuil qui nous frappe.
Lorsque maître Tug, ce soir-là, fut remonté dans la chambre qu’il occupait seul depuis que François, l’aîné, était à l’École navale, il s’assit devant sa table, prit une large feuille de papier et commença en plein milieu :
« Mon vieux frère,
« C’est une lettre de faire part que je t’envoie ce soir. L’oncle Gustave est mort ; papa et bonne-maman sont partis tout à l’heure pour Paris. Je suis triste à cause d’eux, car, autrement, l’oncle Gustave, c’est l’inconnu pour nous. La pauvre bonne-maman a bien du chagrin. Nous voudrions la voir revenue, bien tranquille, au milieu de nous. Mais il y a son autre petite-fille, là-bas, qui va peut-être lui donner du tracas.
« Je lâche ma plume, j’ai trop sommeil. Du reste, tu sais que je ne suis pas épistolier pour deux sous. Je laisse à dame Sapience le soin de te trousser un petit poulet soigné, à la Sévigné. Toujours fourrée dans ses livres, notre Marion. Bonne fille quand même, mais susceptible !... Enfin, chacun a ses défauts, n’est-ce pas, mon vieux ?
« Bonsoir, je t’embrasse. »
II
Le nez de Tug
En face du logis notarial s’élevait une maison de la même époque, d’assez belle apparence, qu’un étroit jardinet fermé d’une grille rouillée séparait de la rue. Elle appartenait à un des médecins de Losbéleuc, le docteur Dornoy, condisciple et ami de M. Arzen, auquel l’unissait un lointain lien de parenté. Marié à la fille d’un magistrat de Vannes, il était devenu veuf peu après la naissance de son dernier enfant, le petit Robert, filleul du notaire. Une de ses tantes, Mlle Lazarine Dornoy, était venue s’installer chez lui pour tenir son ménage et élever ses trois enfants. La première partie du programme avait toujours été admirablement remplie, la direction d’une maison n’avait pas de secrets pour Mlle Lazarine ; mais il en était tout autrement de l’éducation des enfants, Tante Lazarine était bonne, certainement, mais un peu sèche, autoritaire et cassante, très arrêtée dans ses idées. Avec Pierre, l’aîné, gros garçon flegmatique, cela marchait encore assez bien ; mais Michelle et Robert – Michon et Bobby dans l’intimité – n’étaient pas d’une nature aussi facile à manier. Depuis quelques mois surtout, Bobby, très fier de ses six ans et de ses premières culottes, devenait fort indépendant. Mlle Lazarine en accusait l’exemple de Michelle et les conseils de Tugdual et de Jean... Car les petits Dormoy étaient sans cesse dans la maison d’en face. Mais la réciproque n’était pas fréquente. Mlle Dornoy ne permettait pas les jeux bruyants ni ceux qui risquaient de salir ou déranger quoi que ce soit dans la maison admirablement tenue. Aussi Tug prétendait-il que, dès l’entrée, un énorme poids de glace lui tombait sur les épaules.
– Venez vous décongeler chez nous, mes pauvres vieux, disait-il à ses amis. Si nous n’étions pas là, on vous trouverait un de ces jours transformés en momies.
Pierre, Michelle et Bobby ne se faisaient pas faute de profiter du voisinage. Une fraternelle amitié régnait entre eux et les jeunes Arzen, De leur côté, bonne-maman et sa belle-fille, voire même Armelle depuis qu’elle devenait jeune fille, s’efforçaient de remplacer près des pauvres enfants la mère disparue, en leur donnant discrètement de bons conseils ou en leur adressant des reproches qui, s’ils n’avaient pas la froide sévérité de ceux de tante Lazarine, produisaient pourtant presque toujours meilleur effet.
Cinq jours après le départ de M. Arzen et de sa mère, toute la bande était réunie dans le jardin, sous la surveillance d’Armelle qui travaillait à l’abri d’un petit kiosque rustique, car le soleil de cet après-midi de mars était fort brûlant. Tous avaient congé aujourd’hui et en profitaient largement. Le vieux jardin à l’ancienne mode retentissait de rires et d’interpellations joyeuses.
– Enfin ! je me repose ! J’ai trop chaud, Tug, dit Michelle en se laissant tomber sur un banc. Viens-tu aussi ?
Tugdual ne se fit pas prier. Il s’entendait toujours admirablement avec Michelle, dont la nature vive et décidée s’accordait avec son caractère résolu.
Pendant quelques instants, la fillette demeura silencieuse, en éventant avec son chapeau son petit visage mince, qu’éclairaient des yeux bruns d’une rare intelligence. Près d’elle, Tug, du bout d’un bâton, traçait des lettres sur le sable de l’allée.
Michelle, se penchant, lut tout haut :
– Moussia... C’est le nom de ta cousine, je crois ?
– Oui, répondit Tug d’un ton bref.
– Es-tu content de la connaître ?
– Pas du tout !
Michelle le regarda en ouvrant de grands yeux.
– Comme tu dis ça ! Pourtant, ta grand-mère et ton père disent qu’elle est très gentille, très bien élevée.
– C’est possible, mais il y a mon nez.
– Comment, ton nez ? dit Michelle avec effarement.
– Mais oui, j’ai un nez extraordinaire, un flair, si tu aimes mieux. Cette Moussia ne me dit rien qui vaille.
– Par exemple, c’est trop fort ! Sans la connaître !
– Mais mon nez, mon nez, Michon, mon infaillible nez !
Michon éclata de rire à ce nez merveilleux, irrévérence dont ne parut pas se choquer ce bon garçon de Tug.
– Qui vivra verra ! conclut-il philosophiquement. En tout cas, je suis content de voir revenir papa et bonne-maman. Camélia aussi est content, parce qu’il va pouvoir partir pour le mariage de sa sœur.
– Tiens, le voilà justement, Camélia !
Dans une allée s’avançait un petit homme d’une quarantaine d’années, au front dégarni, au visage rond et au teint frais. Derrière les verres d’un lorgnon clignotaient des yeux noirs souriants. Ce personnage, répondant au nom de Luc Camélieu, était le principal clerc de M. Arzen, qui avait en lui la plus grande confiance. C’était, du reste, un excellent homme, très aimé des enfants, pour lesquels il se montrait d’une inépuisable complaisance.
Tug l’avait surnommé Camélia, encore moins par analogie avec son nom qu’à cause de son teint rosé, prétendait le malicieux garçon.
Bobby et Josèphe allèrent au-devant de lui.
– Est-ce que vous apportez des grenouilles, monsieur Camélieu ? cria le petit garçon.
– Mais non, pas aujourd’hui, mon petit. C’est chez moi, près de Josselin, que j’en trouverai. Aujourd’hui, je n’apporte qu’une nouvelle.
Michelle, Tugdual, Pierre et Jean s’approchèrent, curieux ; Marion elle-même, qui lisait, assise sur un banc, releva la tête.
– Une bonne nouvelle ? dit Michelle.
– Bonne... ça dépend. Si ces gens-là sont de relations agréables, ce sera bien. Sinon...
– Quelles gens ? interrompit Tug.
– Eh bien ! les propriétaires de la maison des Oiseaux !
– Ils viennent l’habiter ?
Une même consternation apparut sur les visages.
– Mais oui. Le domestique de M. de Rodennec, celui qui l’a suivi à son départ d’ici et ne l’a jamais quitté, vient de venir chercher la clé pour constater les réparations à faire. Son maître, infirme, a été pris tout à coup de l’idée de revoir son pays et de revenir y mourir. Il arrivera dans une quinzaine de jours, ayant fait le voyage sur son yacht avec sa femme et son fils unique. Hé ! hé ! s’ils confient le soin de leurs affaires à notre étude, ça fera de fameux clients ! Déjà riche avant de partir, M. de Rodennec est devenu là-bas un vrai nabab.
Il se frottait les mains, tout joyeux à l’idée que cette aubaine pourrait échoir au « patron », car ce brave Camélieu n’était pas du tout dans les idées du jour et considérait comme siens les intérêts de celui qui l’employait. Déjà, il contemplait en pensée les actes superbement rémunérateurs qui se passeraient dans l’étude Arzen : le contrat de mariage du jeune homme... et puis des affaires à régler après la mort de M. de Rodennec. Car il prévoyait tout, ce Camélieu.
Mais les enfants ne voyaient pas si loin. C’était, chez eux, une vraie consternation, et voici pourquoi : le petit parc de la maison des Oiseaux n’était séparé du jardin des Arzen que par une haie, dans laquelle Tug et Jean avaient depuis longtemps ménagé un passage. Livré à lui-même, frais et touffu à ravir, et traversé par un bras de la rivière, ce parc était un lieu idéal pour les ébats de cette jeunesse. Que de bons souvenirs il rappelait ! François en avait fait le sujet de sa première poésie ; Tug et Jean ne comptaient plus les parties qui s’y étaient jouées avec leurs camarades les jours de congé ; Armelle en aimait le pittoresque abandon, l’ombre si délicieuse pendant l’été. On ne risquait pas d’y être dérangé par le propriétaire : celui-ci avait quitté la Bretagne après avoir perdu sa femme et un tout jeune enfant ; il avait voyagé et s’était remarié aux Indes à une Hindoue de haute caste dont il avait eu un fils. Jamais il n’était revenu dans son pays. M. Arzen gardait les clés de la maison et lui expédiait les intérêts rapportés par une grande ferme dont il était propriétaire aux environs. Aussi les enfants s’étaient-ils accoutumés à se trouver comme chez eux dans le parc abandonné.
– Quelle tuile, mes amis ! s’exclama Tug.
Et, s’élançant vers sa sœur aînée qui avait interrompu son ouvrage pour écouter, il s’écria :
– Tu entends, Armelle ? Toi qui aimais tant aussi le vieux parc !
– Oui, c’est fort regrettable. Mais que voulez-vous, mes pauvres enfants, nous ne pouvons pourtant pas en interdire l’entrée à ses propriétaires ?
– Moi, j’irai quand même ! déclara Bobby.
– Et, moi aussi, j’irai ! dit comme un écho la petite voix de Josèphe.
M. Camélieu l’enleva entre ses bras :
– On enverra alors les gendarmes pour te prendre, Josie.
– J’ai pas peur des gendarmes ! J’ai peur de rien !
– Excepté des chiffonniers, hein ! ma belle ! lança Tug.
Josèphe prit un air confus et fit une petite moue en détournant la tête.
– Ça doit être des gens désagréables pour venir nous déranger comme ça, fit observer Michelle. Qu’est-ce que te dit ton nez à leur sujet, Tug ?
– Il ne me dit rien pour le moment, ma chère. S’il m’indique quelque chose, je te ferai part de mes observations.
Bobby, emmenant Jean à l’écart, lui chuchota à l’oreille :
– Dis donc, si on leur mettait dans le parc des bêtes très méchantes ? Ils auraient peur et s’en iraient bien vite.
– Oui, mais quelles bêtes ?
– Des serpents avec des lunettes, comme ceux qui étaient sur l’image que Marion m’a montrée l’autre jour. Et puis, des lions et des gros singes...
– Où iras-tu chercher tout ça, gros nigaud ? Si seulement j’avais quelques belles paires de rats qui leur détaleraient dans les jambes ! Ah ! notre parc ! Quel malheur !
Tug, le front plissé, tournait autour d’un sycomore, dans une attitude à la Napoléon.
Michelle le regardait avec curiosité. Bientôt, elle n’y tint plus et s’approcha de lui.
– À quoi penses-tu ? demanda-t-elle.
Il s’arrêta, lui saisit le bras et, mystérieusement, chuchota :
– C’est elle qui nous amène cet ennui.
– Qui ça, elle ?
– Eh ! la cousine russe ! Elle a le mauvais œil.
– Tug, tu es fou !
– Les fous sont souvent les plus sages, Michon. En tout cas, j’ouvre l’œil, moi, et le bon !